1000 ans d’ pouvwêr politike aus mwins d’ feumes / 1000 ans de pouvoir politique aux mains de femmes
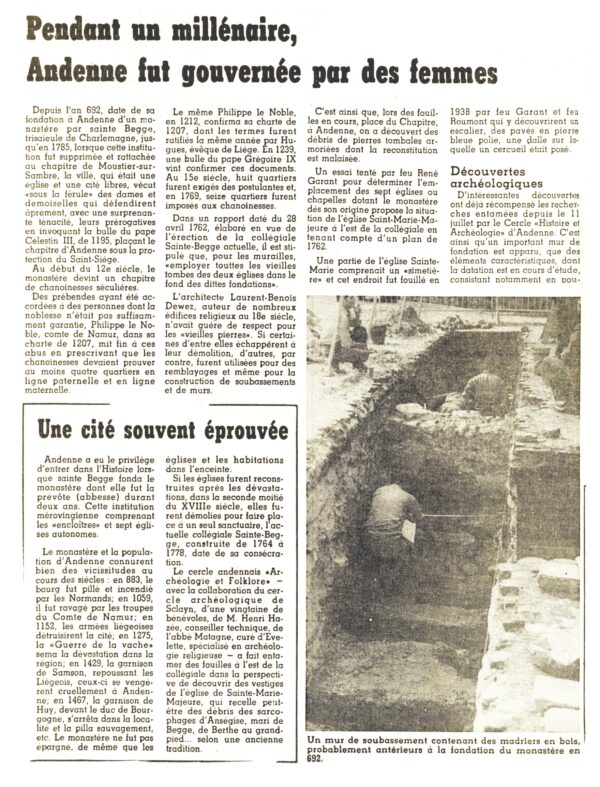
Pendant un millénaire, Andenne fut gouvernée par les femmes
(LB, s.d. (1990s))
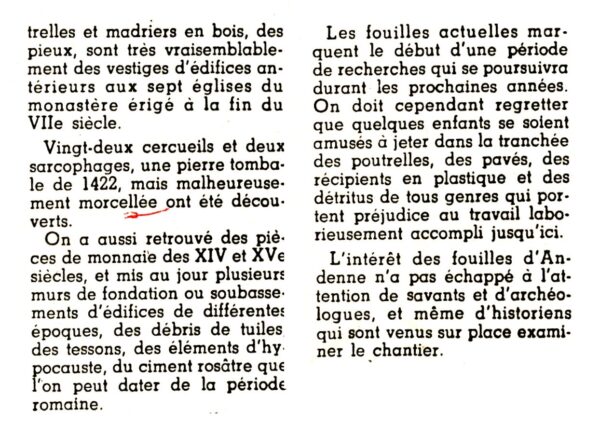
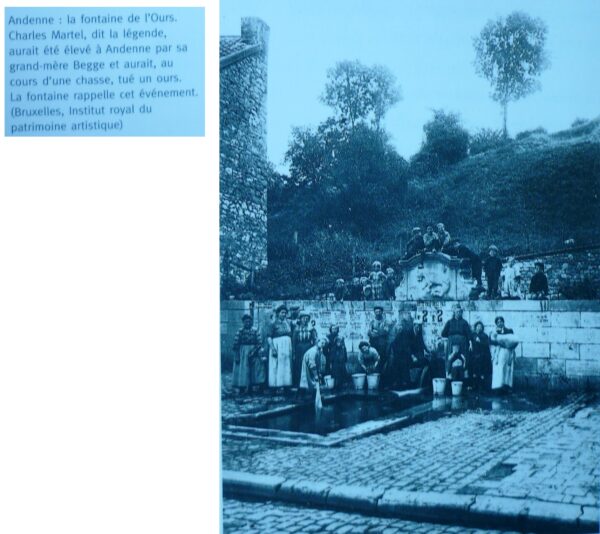
à l' Fontin.ne di l' Oûrs' (à la Fontaine de l'Ours)
(s.r.)
Li têre à l’ dièle dins l’ réjion d’ Andène / La terre plastique dans la région d’Andenne
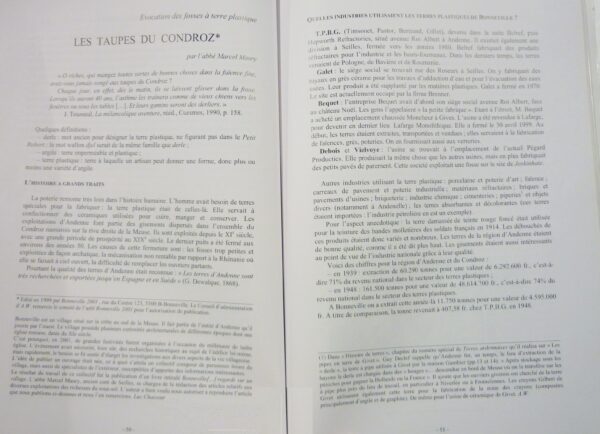
Abbé Marcel Maury, Les taupes du Condroz, L’extraction de la terre plastique à Bonneville, in: Ardenne wallonne, 1999
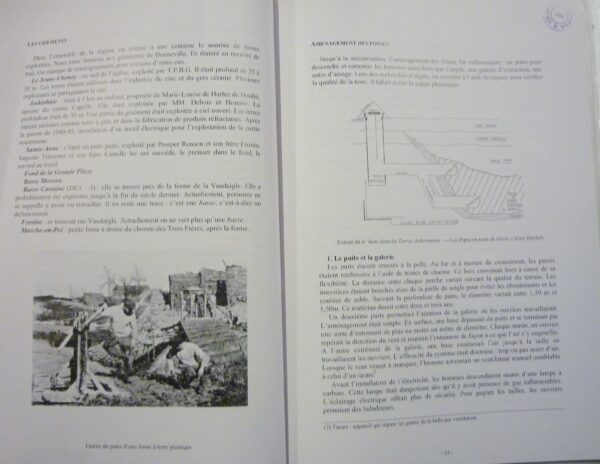

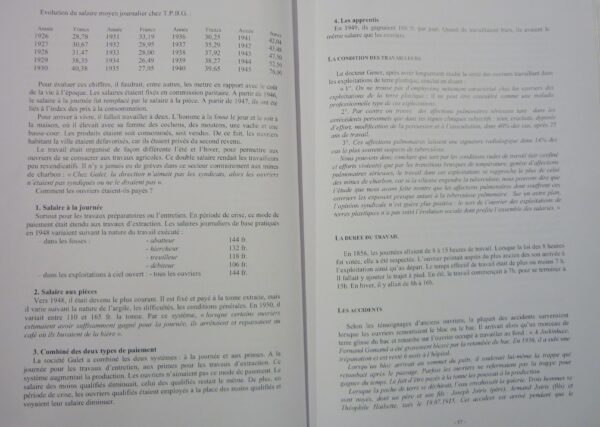
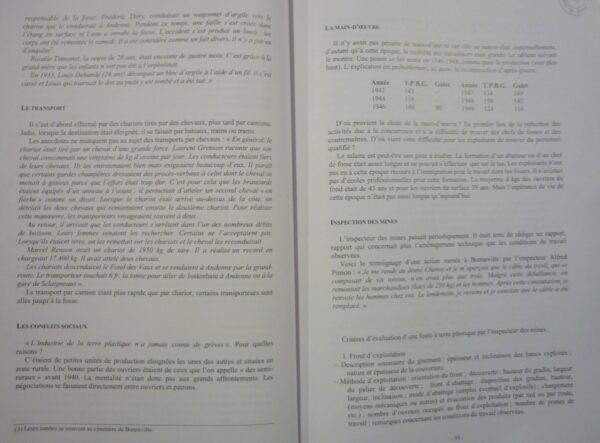
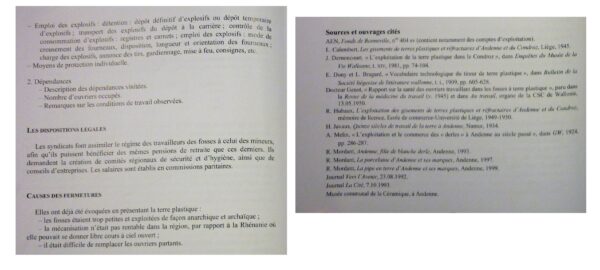
Li têre à l’ dièle èt l’ fabricâcion d’ pupes à Andène / La terre plastique et la fabrication de pipes à Andenne
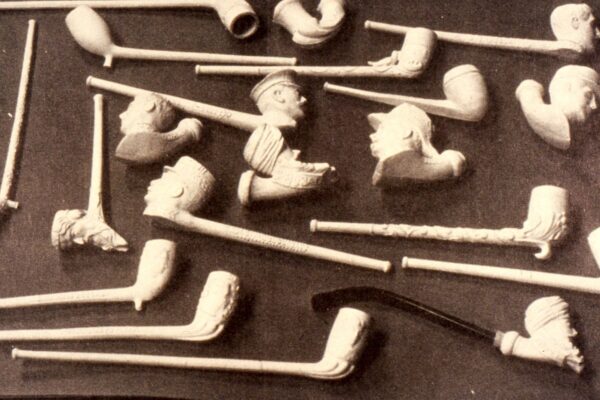
Andène (Andenne) - puperîye (fabrique de pipes)

(in: Pourquoi Pas?, 27/07/1978, p.53)
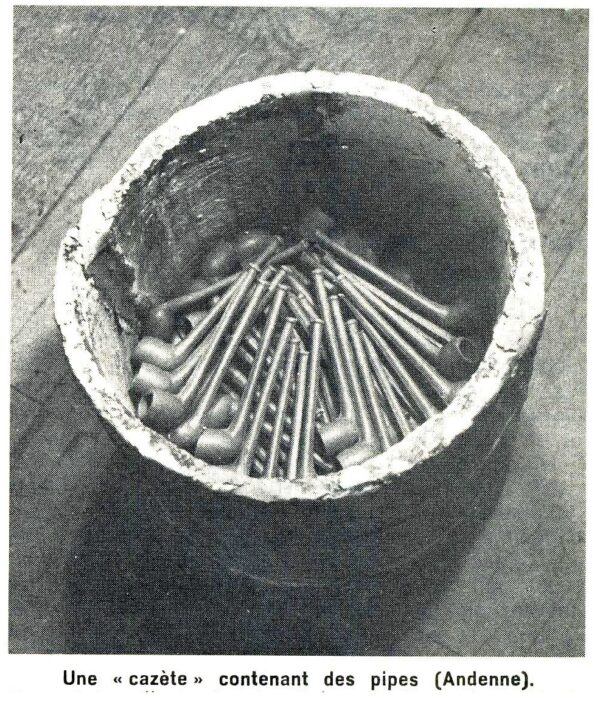
(in: Pourquoi Pas?, 27/07/1978, p.54)

(in: Krupa, éd., Musée de la Vie Wallonne, s.d.)
L’extraction de la terre plastique dans le Condroz, in : EMVW, 157-160, 1975, p.74-105
Introduction
Historique
Le modelage de la terre glaise fut une des toutes premières industries créées par l’homme partout où l’argile affleure la surface du sol, ou se rencontre à une faible profondeur. De très bonne heure, il se mit à la pétrir de ses mains, à la travailler, de manière à lui donner des formes particulières suivant son gré, puis il la fit durcir et se consolider au soleil d’abord, par cuisson ensuite.
Les gisements de terre glaise sont nombreux dans le Condroz, surtout dans la région d’Andenne où ils ont été exploités très tôt. Des fouilles ont permis de mettre au jour des poteries datant de l’époque gallo-romaine. Certaines pièces même se trouvaient encore dans le four qui avait servi à leur cuisson quelque quinze siècles auparavant. Voici comment E. J. Dardenne décrit cette découverte dans les Annales de la Société Archéologique de Namur 1: « … vers 1820, on découvrit à Andenelle, au lieu-dit « Trou d’en haut », un four de potier rempli de poteries antiques… ». Selon lui, les bâtiments du potier auraient été détruits au début du Ve siècle de notre ère, lors de la grande invasion franque. À l’époque gallo-romaine, on fabriquait aussi à Andenne des briques pour la construction, ainsi que des tuiles.
Les artisans locaux du moyen âge ont également laissé de très belles poteries, des vases, des carreaux émaillés, etc. Cette terre plastique, que l’on a appelée terre d’alun, derle (en wallon dièle), terre de potier, terre à feu, terre à pipes, etc., fut, dès les temps les plus anciens, exploitée et utilisée sur place pour la fabrication « de pos et de jusses »
1 T. 15, p. 262, Namur, 1881. Histoire de la faïence d’Andenne in Journal d’Andenne 1902-1903.
(p.75) (w. djusses, cruches)2. De bonne heure aussi, elle fut activement recherchée par les étrangers, en particulier les batteurs de cuivre de Bouvignes qui l’employaient pour fabriquer leurs creusets, et aussi par les pipiers hollandais.
Il est attesté que « la blanche derle qui se tire du ban d’Andenne est la meilleure de toutes celles qui se retrouvent et se tirent le long de la rivière Meuse entre Huy et Namur, même (…) la meilleure de toutes les blanches derles du pays et qu’elle est la plus recherchée tant parmi les marchands d’Hollande, de Liège, de Maestrick (…) » 3.
L’autorisation d’extraire la derle partout où il s’en trouvait fut accordée par le Comte de Namur, en 1328, aux batteurs de cuivre de Bouvignes et en 1466 à ceux de Namur. Toutefois, dans le ban d’Andenne, ces autorisations furent contestées par le Chapitre Noble d’Andenne, « entièrement seigneur de tréfonds et de hauteur de tout le ban d’Andenne ».
Héritier des droits de sa fondatrice Sainte Begge, il prétendit que rien ne pouvait être extrait du sous-sol sans son accord et s’opposa à certains habitants de l’endroit, propriétaires des terrains, et aux batteurs de cuivre de Namur.
Un long procès en résulta qui se termina en 1663 par une sentence du Conseil provincial de Namur. Le Chapitre fut confirmé dans ses droits et les batteurs de cuivre condamnés à verser une forte redevance pour la terre extraite pendant la durée du procès. En 1669, ce même Conseil provincial et le Grand Conseil de Malines se prononcèrent de nouveau en faveur des droits exclusifs des Dames du Chapitre contre les propriétaires de terrains. Désormais, les exploitants devraient payer au Chapitre la valeur du dixième des terres extraites. Cette décision entraîna une grande activité dans le pays : le Chapitre, la communauté, les particuliers se firent exploitants et de nombreux ouvriers trouvèrent un emploi bien rémunéré.
Géologie et chimie
Dans le Condroz, les gisements de terre plastique se situent dans les bassins de Namur et de Dinant, sur la rive droite de la Meuse.
2 A. melin, p. 134.
- L. lahayE. Cartulaire d’Andenne.
(p.76) L’ensemble forme un quadrilatère limité au nord et à l’ouest par la Meuse, à l’est par le Hoyoux, au sud par le bord méridional de la zone d’affleurement du calcaire carbonifère. Cette région, vaste de 700 kilomètres carrés environ, a une altitude qui varie de 150 à 300 mètres. Dans l’ensemble, ces ondulations, ou plutôt ces plissements sont orientés dans le sens nord est-sud ouest; ils sont donc sensiblement parallèles au cours de la Meuse entre Namur et Huy.
« La plupart des gisements se rencontrent dans les dépressions qui marquent le passage des bandes calcaires, parfois à proximité de leurs lisières, parfois à l’intérieur même de celles-ci, à des distances variables des points de contact du calcaire avec les couches schisto-gréseuses houillères ou dévoniennes. Le bassin de Namur, en particulier, possède des gisements dans le calcaire carbonifère; ils sont disposés en chapelets suivant plusieurs alignements bien définis » 4.
Les terres plastiques ont donc une origine géologique très ancienne puisque ce sont des gîtes tertiaires provenant de la désagrégation, suivie du transport et de la sédimentation des roches primaires et, éventuellement, de roches plus récentes qui les recouvraient.
Du point de vue géologique, on distingue trois catégories de gisements:
- La première catégorie est due à l’altération quasi sur place des roches houillères essentiellement schisteuses, affaissées dans le calcaire carbonifère.
- Dans la seconde catégorie, se classent les gisements de terres plastiques tertiaires. Ceux-ci consistent en une sorte de lentille dont les couches superposées d’argiles, de sables et de matières organiques ont une épaisseur maximum au centre de la formation et s’amenuisent progressivement en direction des bords.
- Les gisements composites forment le troisième type. Ils comportent, dans leur partie inférieure, un gîte de la première catégorie, et, dans leur partie supérieure, des formations tertiaires du deuxième type qui recouvrent plus ou moins les précédentes.
Les terres plastiques sont essentiellement constituées de silicates d’alumine plus ou moins hydratés, c’est-à-dire qu’elles se composent
- caleMbert, Les gisements de terres plastiques et réfractaires d’Andenne et du Condroz, Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1945, p. 36.
(p.77) de silice, d’alumine et d’eau, unies en proportions variables. Elles contiennent toujours des impuretés provenant de la roche-mère. En effet, toutes les argiles sont des sédiments issus de la décomposition de roches feldspatiques par les agents atmosphériques (eau, gaz carbonique, froid, chaleur) et par les réactions chimiques qui en résultent. Ces impuretés se composent de fer sous forme de sulfure, de carbonate ou d’oxyde, de titane, de calcium, de magnésium et enfin, de métaux alcalins comme la soude et la potasse.
Ces divers composants déterminent la classification des terres en quatre catégories:
- Les terres maigres, sableuses, peu liantes, qui contiennent ordinairement 10 à 18 % d’alumine.
- Les terres grasses, très liantes, dont la teneur en alumine varie de 28 à 33 %
(p.78) 3. Les terres demi-maigres ou demi-grasses qui présentent toute la gradation existant entre les deux premières catégories; leur teneur en alumine s’échelonne donc de 19 à 28 %.
- Les terres alumineuses qui ont des teneurs en alumine supérieures à 33 %.
D’autre part, les terres de chacune de ces catégories, peuvent être de premier, de deuxième ou de troisième choix (elles sont alors appelées crawes), selon le pourcentage d’impuretés qu’elles contiennent.
Enfin, il existe encore une autre classification des terres:
- Les terres réfractaires qui ont un point de fusion minimum de 1580°, pouvant aller jusqu’à 1700°; elles peuvent être maigres, demi-maigres ou grasses, mais sont nécessairement très pures.
- Les terres à grès se caractérisent par le fait qu’elles se vitrifient à basse température, soit 900 à 1000°. Cette vitrification, généralement provoquée par la présence d’alcalis (soude, potasse), peut être un indice de qualité puisque, après cuisson, le produit est absolument imperméable.
- Les terres à foulon sont relativement alumineuses, mais elles sont douées d’un pouvoir absorbant assez puissant à l’égard des corps gras. Pour cette raison, elles sont employées pour le raffinage du pétrole.
Notons que la couleur de la terre n’est pas déterminante pour son classement qualitatif. Un seul critère doit être retenu: une coloration jaune ou rouge, parfois bleue, indique toujours la présence de fer, sous une forme ou l’autre. Par conséquent, on classe la terre dans une qualité inférieure.
Utilisations
Parmi les diverses industries qui ont employé ou emploient encore l’argile comme base de leurs matières premières, citons les usines de produits réfractaires, de faïence, de porcelaine, de tuyaux, de récipients anti-acides, de carreaux de pavement ou de revêtement, etc… Jusqu’il y a quelques années, les glaceries, les verreries et surtout les usines à zinc l’ont utilisée en grande quantité pour fabriquer leurs creusets.
(p.79) Pendant très longtemps, les gisements de terre plastique de la région d’Andenne ont alimenté toutes ces industries, en Belgique comme à l’étranger. Mais ils se sont peu à peu épuisés, surtout à partir de 1950. L’une après l’autre, les exploitations durent fermer leurs portes et de nombreuses sociétés disparurent. À la fin de 1976, tout était pratiquement terminé. Ainsi disparut le métier de « mineur en terre plastique ».
L’extraction de la terre plastique
Une industrie aussi ancienne que l’extraction de l’argile est longtemps demeurée traditionnaliste et fermée au progrès. Les méthodes et les moyens ne se sont perfectionnés que très lentement. Cela est dû avant tout au nombre relativement élevé de gisements peu importants. Les sièges d’exploitation, bien souvent perdus dans les campagnes, étaient très disséminés et presque toujours pourvus d’installations provisoires, pour quelques mois, parfois quelques années. Les travaux d’extraction qui rendaient les terrains mouvants et peu sûrs ne permettaient pas la construction de bâtiments ou de hangars en matériaux durs. Le puits était protégé et les terres extraites stockées dans des baraques ou cabanes qui, lorsqu’elles étaient nombreuses, donnaient au site des allures de village africain.
Ces baraques avaient l’avantage de pouvoir être déplacées. Elles étaient formées de grands paillassons, hayons, appuyés l’un contre l’autre par leur partie supérieure : sortes de claies de paille entrelacée sur des traverses maintenues par deux montants, paumales.
Elles qui étaient si typiques de notre Condroz ont pourtant fini par être remplacées par des baraquements en planches et tôles ondulées (voir fig. 1).
Si beaucoup de gisements ont été découverts par accident lors de certains travaux (creusement de puits pour l’eau, pose de drains en agriculture, etc.), le plus souvent il a fallu faire des recherches dans les lignes géologiques susceptibles de contenir des dépôts argileux: aux abords des affleurements calcaires et aux endroits où les terrains restent plus humides.
(p.80) Sondages
Les sondages de recherche manuelle ne peuvent atteindre une grande profondeur (15 mètres environ); ils ne décèlent habituellement que les affleurements des gisements. Il est donc assez difficile d’en apprécier l’importance. Ce n’est que plus tard, en creusant un puits « en recherche » que l’on pourra déterminer celle-ci.
Voici ce que dit M. J. Martens à ce sujet: « Bien que des sondeuses perfectionnées aient été finalement employées, c’est encore à la tarière que se font la plupart des sondages en recherche, tant en terrain vierge qu’au voisinage ou dans les vieux gisements. Ce procédé ne peut évidemment donner de résultats précis par suite de la faible profondeur des trous et des déviations fréquentes des tarières à la rencontre d’une couche plus dure, car le sondage a alors une tendance à suivre la direction des terres les plus faciles à couper, souvent les plus grasses, ce qui fausse singulièrement les résultats des reconnaissances5 ».
Ce sondage, foradje, est effectué à l’aide de sondes constituées d’une suite de tiges d’acier à bout fileté, vèdjes ou tèréres, d’environ trois pieds de long, se vissant bout à bout au fur et à mesure de l’enfoncement. La première tige, appelée crosse, est pourvue perpendiculairement d’un bois arrondi qui sert, à l’ouvrier, de poignée pour la manœuvrer. À l’extrémité, de la crosse d’abord, puis à celle de la dernière « baguette » se visse une cuillère ou louche allongée et pointue mesurant environ 30 cm, li loce, dont un des bords bien coupants présente une petite entaille formant crochet, destiné à retenir et à ramener au jour l’échantillon de sondage appelé carote ou rututu. Pour l’ouvrier ou les deux ouvriers, forer, c’est, en tenant la poignée de bois de la crosse, enfoncer la cuillère dans le sol par secousses successives et lui imprimer quelques tours, tout en veillant, après chaque remontée d’échantillon, à verser un peu d’eau dans le trou pour faciliter la pénétration. Cette remonte s’effectue après un enfoncement quelque peu supérieur à la longueur de la cuillère. Les carotes sont soigneusement alignées sur le sol, l’une à côté de l’autre, afin de pouvoir être examinées. Lors d’un passage dans le sable, on emploie une louche dont
- 1. martens, Notes sur les gisements de terres plastiques de la région de Namur et sur leur exploitation.
(p.81) l’extrémité n’est pas pointue, mais repliée jusqu’à former un angle de presque 90°.
Les puits et galeries
À de rares exceptions près, tous les gisements du bassin d’Andenne sont exploités d’une manière souterraine, par puits et galeries. Un seul gisement, situé sur un versant à pente assez accentuée, a pu être partiellement exploité à l’aide d’une galerie à flanc de coteau 6.
Tous les gisements ayant dans l’ensemble une forme subcirculaire ou elliptique, mais toujours plus ou moins irrégulière, sont donc encaissés dans les roches calcaires. Us remplissent des poches, mais, dans la majorité des cas, ils sont séparés du calcaire par les sables qui les entourent. Ceux-ci sont souvent noyés à partir d’une certaine profondeur ; c’est, dès lors, la position du niveau hydrostatique, li nivia, qui détermine le choix de la méthode d’exploitation.
6 Ce cas est habituel dans les exploitations du bassin de Provins en France.
(p.82) Il est rare que le puits, li bure, soit directement descendu, avalé, sur le gisement même, car les mouvements du terrain occasionnés par l’exploitation des terres, risquent de provoquer sa déformation, son écrasement et, en fin de compte, son éboulement. De ce fait, on parvient très rarement à exploiter les deux flancs du gisement avec un seul puits en terre; l’affaissement du terrain qui entraîne la formation d’une mare en surface, ne permet pas la communication d’un bord à l’autre; il est donc indispensable de prévoir un puits sur chaque versant.
Généralement, le puits d’extraction sera foncé dans le sable, en dehors du gisement de terre plastique. Au niveau de celui-ci et pour y accéder, le puits se poursuit par une galerie creusée dans le sable appelée « chasse », en wallon, tchèsse. Après percement d’une épaisseur — différente selon le cas — de mauvaise terre, dègn, cette galerie débouchera dans la veine, // win.ne, et s’y avancera un peu. On pourra alors ouvrir sur les côtés une ou deux galeries qui suivront ordinairement le contour du gisement sur des longueurs assez variables, se guidant toujours sur le dègn.
Le puits dans le sable, sauvion, a de grands avantages. D’abord, il se fonce beaucoup plus facilement et plus rapidement que s’il s’agissait de terres ou d’argiles parfois rocailleuses; ensuite, il ne sera pas influencé par les mouvements de terrain; enfin, il restera plus sec et son boisage durera plus longtemps. Évidemment, plus le puits sera écarté du gisement, moins il sera sollicité, mais la « chasse » dans le sable sera plus longue et plus coûteux les travaux préparatoires à l’exploitation. Toutefois, cet inconvénient est largement compensé par une meilleure tenue, une plus longue durée du puits. Malheureusement, les sables sont presque toujours noyés à partir d’une certaine profondeur (le niveau hydrostatique), et l’on ne peut évidemment pas faire descendre le puits plus bas. On est obligé de l’arrêter un peu au-dessus de ce niveau, de construire une galerie jusqu’à la recoupe du gisement et, une fois dans celui-ci, d’y foncer un sous-puits, dit bourikèt. On peut rarement le percer verticalement, surtout dans les vieux gisements, mais, le plus souvent, il suivra l’allure inclinée et parfois variable du dègn. Il sera souvent nécessaire, pour atteindre la partie la plus importante et la meilleure du gisement, de creuser plusieurs bourikèts successifs. Il est ainsi possible d’exploiter simultanément plusieurs étages.
(p.83) À cause de la constitution géologique des terrains, il peut arriver, au moment du fonçage du puits comme à celui du percement des « chasses », que l’on rencontre des couches de machuria, c’est-à-dire de lignite brun-noir (produit combustible à très haut pourcentage de carbone). C’est dans cette matière que l’on découvre quantité de fossiles, même des troncs d’arbre, des séquoias, datant de dizaines de milliers d’années7.
Les puits
Depuis les temps les plus anciens, les puits sont circulaires. Leur diamètre est d’environ 1,65m au creusement, soit plus ou moins 1,50 m après revêtement, qu’ils soient descendus en terre ou en sable. Au début du fonçage, les premiers déblais servent à égaliser le terrain et à monter une surface horizontale sur laquelle reposera le treuil. Un seul ouvrier travaille à la pioche ou à la houe et c’est à la pelle qu’il jette les terres ou le sable à la surface. Lorsque le puits a atteint une profondeur d’environ deux mètres, les matières sont placées dans un bac qui est remonté au moyen d’un treuil à bras, li toûr. Ce dernier se compose d’un cadre, muni de deux clapets; deux montants y sont fixés dont les extrémités fourchues reçoivent les tourillons, beûssons, d’un tambour en bois auquel sont fixées une ou deux manivelles, coublètes, et sur lequel s’enroule le câble, autrefois grosse corde de chanvre, cwade di tchène, aujourd’hui et depuis longtemps en acier. Au bout du câble, un petit crochet en supporte un autre, plus grand, appelé havèt ou cro, qui sert à accrocher les bacs, batch, et aussi à poser le pied quand les ouvriers descendent dans le puits.
L’ensemble formé par les deux clapets qui s’ouvrent lors du passage d’un bac ou d’un bloc de terre et retombent d’eux-mêmes est appelé Yapâ.
Jamais on ne se sert d’un fil à plomb pour le creusement du puits; l’ouvrier dispose d’un calibre, en l’occurrence une simple baguette d’une longueur correspondant au diamètre du puits, et il règle la verticalité à l’œil d’après les derniers cerceaux placés. Des puits parfaitement verticaux ont ainsi été creusés et ils atteignaient des profondeurs de plus de 100 mètres sans accuser la moindre déviation.
5 Ce machuria a d’ailleurs été exploité en grande quantité pendant la guerre 1940-45 pour compenser le manque de charbon.
(p.84) Pour le soutènement du puits, on applique d’abord une couche de paille (de préférence de la paille de seigle peignée), dè strin, horizontalement contre la paroi au moyen de courtes baguettes verticales, coches, longues de 0,50 m environ et espacées de 15 en 15 cm; ce sont des baguettes de noisetier fendues en deux avec les extrémités taillées en pointe. Ces coches sont maintenues et fortement serrées contre la paroi par des cerceaux, des êrs, disposés horizontalement. Il s’agit, au mieux, de troncs de jeunes charmes ayant une longueur d’une dizaine de mètres et un diamètre de 5 à 6 cm au pied. Afin qu’ils se plient mieux, leur partie la plus grosse est amincie sur à peu près 1,50m, progressivement, avant la pose, au moyen du courbet, fièrmint. L’ouvrier serre l’un contre l’autre, quatre, cinq ou six cerceaux, suivant leur longueur, formant ainsi un ensemble d’environ 50 cm de haut, one vôye. Ce travail s’appelle loyî. Afin d’empêcher les cerceaux de bouger ou de glisser, on les maintient entre eux au moyen de fils de fer, cinq ou six répartis sur la circonférence du puits. Chaque vôye est également reliée de cette façon à la précédente .
Pour installer tous ces matériaux, l’ouvrier travaille de la façon suivante. Après avoir constitué une vôye, un groupe de quelques cerceaux, il approfondit le puits d’un mètre environ selon la nature du terrain, mais suffisamment pour pouvoir placer une nouvelle série de cerceaux. Sur une hauteur approximative d’un pied, à laquelle il faut ajouter la place nécessaire au groupe d’ers, il garnit les parois de paille maintenue par des coches enfoncées vers le haut sous le groupe précédent. Il fixe quelques broches de bois, brokes, sur le pourtour du puits avant de poser le premier cerceau en piquant sa pointe amincie dans la paroi et en le pliant pour lui faire épouser exactement la forme du puits, tout en l’appuyant sur les broches. Afin d’obtenir un bon serrage, l’ouvrier frappe sur le cerceau avec le dos de sa houe. Il pratique de la même façon pour les quelques ers suivants en les serrant parfaitement les uns contre les autres et en les liant ensemble à l’aide de fils de fer attachés au groupe précédent. Les extrémités inférieures des coches sont prises sous les cerceaux, de telle sorte qu’elles pressent fortement sur la garniture de paille. On obtient ainsi un soutènement qui ne laisse passer ni la terre ni le sable. Son seul inconvénient est la brièveté de son existence; en effet, bien que les ers et les coches soient en bois assez dur, ils se trouvent relativement vite hors d’usage, pourris, vermoulus et partiellement démantelés par le frottement des blocs (p.86) de terre ou des bacs lors de la remonte. Après deux ans tout au plus, parfois même un an, il faut procéder à un recerclage: on doit mettre de nouveaux cerceaux entre les anciens. Cela s’appelle « relier à simple », riloyi à simpe. L’année suivante, on est obligé de « relier à neuf », riloyî à noû, c’est-à-dire de renouveler complètement le garnissage: paille, coches et cerceaux.
De là vient qu’on a préféré assurer les puits au moyen de cadres composés de quatre bois assemblés par de simples entailles. Le coût est beaucoup plus élevé, mais l’ensemble est plus solide. Anciennement, ces cadres étaient souvent ronds et les entailles étaient faites manuellement à la scie et à la cognée; plus tard, ils eurent une section carrée ou rectangulaire et furent préparés en scierie. Lors du placement de ces cadres dans le puits en fonçage, on les empêche de glisser vers le bas en enfonçant dans la paroi quelques broches de bois, brokes. Le puits est ainsi une véritable caisse qui aura une durée de plusieurs années.
À l’origine, ce système n’était utilisé que pour des puits situés dans des terrains à forte pression — par exemple des terrains déjà dérangés par des exploitations antérieures — et pour des profondeurs moyennes. Il a ensuite été presque généralisé, même pour les puits de faible profondeur et dans des exploitations de courte durée; dans ce cas, les cadres étaient récupérés lorsque le gisement était épuisé et réemployés lors de la construction d’un autre puits.
Il peut arriver qu’au cours du fonçage d’un puits en terre, on rencontre des terres molles, voire des « boulies », bolîyes, ou des sables boulants. On fait alors un cuvelage. Il s’agit de fortes lattes en bois dur, semblables à celles d’un tonneau que l’on enfonce dans le sol et que l’on maintient par des cercles en fer. Ce travail est très difficile à réussir, étant donné la disposition spéciale des gisements; ceux-ci affectent, en effet, la forme d’une cuvette et sont constitués de couches de terre obliques qui exercent de très fortes pressions.
Les galeries
À la profondeur voulue, il s’agit de creuser une galerie dans la direction du gisement. Ce travail, qui s’effectue dans le sable, est extrêmement délicat, car on doit souvent traverser des sables très fins, secs et (p.87) qui se coulent presque comme de l’eau. Aussi est-il réservé à quelques ouvriers vraiment spécialisés et très méticuleux.
En général, la galerie est creusée à petite section (1,20 m de large sur 1,50 m de hauteur environ).
- Martens décrit très bien ce travail : « Le procédé de creusement de cette galerie, à section plus réduite que dans les terres, variera suivant la finesse et la tenue des sables. Lorsque ceux-ci coulent facilement, on fait usage de petites palplanches dites clapètes; ce sont des longues planchettes assez minces (environ 1 m), étroites (12-13 cm), pointues et taillées en biseau. On les enfonce à côté l’une de l’autre dans le sable en les appuyant sur un cadre déjà placé. Suivant la nature des sables, on enfoncera des clapètes au toit seul ou également le long des parois latérales, ce qui est exceptionnel. Quelle que soit la méthode employée, on laisse toujours le sable à front de la voie suivant son talus naturel et on creuse tout d’abord au toit l’emplacement du chapeau du cadre; on place celui-ci et, en attendant le placement des deux montants, on le maintient par un bois assez long, placé au toit suivant l’axe de la galerie, attaché vers son milieu à un cadre déjà complètement posé et, à son extrémité opposée au front, calé par un coin contre un autre chapeau. Après une avance suffisante, on entaille le talus le long des parois pour le placement des deux montants ».
Comme dans le puits, le toit de la galerie ainsi que ses parois sont garnis de paille, maintenue en place par des baguettes parallèles à l’axe de la galerie et appuyées sur les cadres. On peut poser ainsi deux ou trois cadres; les clapètes retirées mais souvent remplacées par des morceaux de planches, wâdes, pour avoir un toit de meilleure qualité, sont immédiatement réemployées au-dessus des cadres nouvellement placés. Cette façon de procéder a toujours existé et n’a jamais pu être améliorée.
La galerie creusée au départ d’un puits en terre sera aussi de dimensions réduites afin de ne pas le déforcer; cela est encore plus important lorsque deux galeries partent du puits.
Quand le sable est traversé, la galerie vient buter contre le dègn, l’enveloppe du gisement de terre plastique; cette sorte de terre est chargée d’impuretés, ce qui explique sa couleur jaune ou rougeâtre (oxyde de fer, pyrites, etc.).
Dans le dègn, la galerie s’élabore comme dans le sable par petites dimensions. Il ne sert à rien, en effet, de déplacer des matières inutilisables ; (p.88) d’autre part, il faut entamer ce dègn le moins possible, car il protège le gisement des infiltrations d’eau, des « boulies» ou des sables noyés. Ici, il n’est plus nécessaire d’employer les clapètes et l’on peut travailler à la houe: la matière est souvent assez dure. D’une manière générale, on n’utilise plus non plus la paille et les baguettes pour le garnissage.
Bientôt, on s’aperçoit que le dègne s’améliore, devient plus pur, signe que l’on va déboucher dans la veine de bonne terre, li win.ne. À ce moment, on peut augmenter progressivement les dimensions de la taille. Les mesures ordinaires sont les suivantes: hauteur 2,20m, largeur au pied 2,10m et au toit, 1,80m à 1,90m. Ces dimensions ne sont évidemment pas fixes; tout dépend du gisement: dans les couches minces ou étroites, elles seront réduites et pourront être irrégulières pour suivre le profil de la couche.
L’extraction proprement dite
Dès lors, le travail se modifie complètement : ce n’est qu’à la fin du dègn que commence la véritable exploitation de la terre plastique.
L’ouvrier mineur à la taille, le « haweur » ou haweû, a toujours suivi le même principe de travail; toutefois, ses outils se sont modifiés, améliorés au cours du temps, sa tâche est devenue plus facile et moins éreintante.
La méthode d’extraction est conditionnée par le découpage à front de taille de la terre, en gros blocs plus ou moins réguliers, en rukes. Pour ce faire, on cloisonne la taille de manière à former des piliers verticaux, piles, qui sont ensuite taillés horizontalement en blocs parallélipipédiques. Le principe est donc de tracer dans la taille des fentes verticales et horizontales, profondes de 30 à 50 cm, pour obtenir un véritable quadrillage de fentes distantes d’environ 50 cm. Les rainures extrêmes longeant les parois, maujîres, sont légèrement en oblique par rapport à l’axe de la galerie, ce qui facilite l’engagement de l’outil. À chaque avancement de la taille, la paroi présente un retrait appelé r’lé.
A l’origine, on traçait ces fentes avec une sorte de pelle à lame triangulaire d’environ 30 cm de long, et à manche perpendiculaire. C’est l’ ostèye, l’outil (cf. fig. n° 4).
(p.90) Le mineur trempait cet outil dans l’eau, et, en tenant le manche à deux mains, il enfonçait la laine dans la terre, par à-coups et en lui imprimant un balancement de gauche à droite. Ce travail, effectué dans une atmosphère relativement viciée, était pénible, chaque coup donnant un choc sur l’estomac.
Les blocs ainsi délimités par les fentes sont détachés du front de taille à l’aide d’une houe plate et large de 8 à 10 cm, li hawe, en (p.90) attaquant au toit un des piliers, pilés, médians, dit de « desserre », dissère.
Le premier bloc enlevé au sommet de la taille a une forme biseautée, d’où son nom de tchèssadje, tandis que les suivants auront une section carrée ou rectangulaire. On détache le bloc partiellement décollé en introduisant la lame de la houe dans la fente et en lui imprimant un quart de tour. Cela s’appelle le rantchî. On doit parfois exercer des pesées latérales en engageant deux houes dans l’entaille verticale. Ces blocs peuvent peser jusqu’à 100 à 150 kgs, parfois plus.
Si l’on excepte le travail dans des terres tendres ou plutôt grasses et molles, on a complètement abandonné l’ ostèye. On l’a remplacée par la « gratte », en wallon grète ou grèteûse, longue tige carrée en acier pouvant mesurer jusqu’à 1 mètre, dont l’extrémité recourbée à angle droit, présente deux tranchants de part et d’autre d’une lame longue de 10 à 15 mm et large d’autant. L’autre extrémité est pourvue d’une poignée en bois. En frottant cet outil avec force de haut en bas contre le front de taille, et en le retournant à chaque coup de manière que chaque tranchant détache un ruban de terre, on creuse de profondes rainures. Ces dernières séparent les piliers qui seront ensuite recoupés horizontalement par des entailles de même profondeur que les premières. La largeur des piliers varie suivant la dimension de la taille, mais elle est généralement voisine des 50 cm, de même que la profondeur des rainures. Comme c’est le cas lorsqu’on emploie l’outil, les rainures qui se trouvent contre les parois sont légèrement obliques et laissent un r’ié de quelque 10 cm.
Ce travail terminé, l’arrachage des blocs de la taille se fait à la houe, exactement comme dans le cas précédent. Par ce procédé toutefois, et grâce à la longueur de la gratte, on parvient à extraire plus vite et avec moins d’efforts, des blocs beaucoup plus gros, pesant jusqu’à 300 kg.
Vers 1935, un nouveau procédé importé de France facilite encore l’exploitation. C’est le procédé dit « au fil ». Il ne pourra cependant être mis en pratique dans des terres très dures ou susceptibles de contenir de vieux bois ou des objets durs.
L’outil est un fil d’acier, d’environ 1 mm de diamètre et d’une longueur de 0,80 à 1 m. Une de ses extrémités est fixée à une longue aiguille en fer, dont la pointe est percée d’un œillet d’attache pour le fil, tandis que l’autre est nouée à un manche en bois rond, pointu, de 0,70 m de long, appelé « yo-yo ». (Cf. fig. n° 4).
(p.91) Après avoir pratiqué les fentes verticales délimitant les piliers au moyen de la « gratte », on commence par abattre un de ces piliers vers le milieu de la taille. L’abatteur pique l’aiguille au-dessus de la taille, à peu près au toit. Si la terre est trop dure, il doit d’abord faire un trou; pour cela, il utilise une tige d’acier un peu plus grosse que l’aiguille, qu’il trempe dans l’eau et qu’il enfonce par chocs successifs ou même en frappant avec le dos de la houe. Il retire cette tige avant d’introduire, dans le trou ainsi fait, l’aiguille munie du fil en la poussant un peu plus profondément pour la fixer dans la terre. Le manche en bois sert alors de levier: l’ouvrier appuie son extrémité contre la taille et il le fait tourner de telle sorte que le fil d’acier s’y enroule, puis il fait avancer ce fil, qui, primitivement, longe l’aiguille, de manière à découper la terre et à y délimiter un bloc. L’aiguille étant alors retirée de son trou et plantée légèrement à côté, dans la taille, il suffira de tirer vers soi le manche en bois pour que le fil achève de découper le bloc qui tombe tout seul. Ce premier bloc aura donc une section triangulaire. Pour les blocs suivants, on procède de la même façon: on introduit l’aiguille et son fil dans la fente. Le fil est logé au fond du creux laissé par le premier bloc jusqu’à la fente voisine et est rabattu dans celle-ci par le mouvement du manche en bois. On découpe ainsi la face arrière du nouveau bloc. Il suffit alors à l’ouvrier d’ôter l’aiguille, de la piquer comme précédemment dans la taille et de tirer vers lui pour que le fil coupe la base du bloc qui tombera assez facilement; on peut aussi l’aider en introduisant la lame de la houe dans la fente.
Dans les terres grasses et peu serrées, il n’est pas nécessaire de faire les fentes à la «gratte»; simplement, on trace des lignes verticales pour se guider et l’on découpe directement au fil. On gagne ainsi un temps considérable.
Le dernier progrès en matière d’abattage de la terre a été l’emploi d’une bêche actionnée à l’air comprimé. Ce système nécessite un investissement assez important avec l’installation d’un compresseur d’air et la pose de longues tuyauteries métalliques dans le puits et les galeries depuis la surface jusqu’aux différentes tailles. Cependant, ces frais sont largement compensés par une augmentation appréciable de la production. Avec ce procédé, on n’obtenait plus de gros blocs destinés à être encore redécoupés, mais de longues tranches ou bien des morceaux difformes dans certaines terres dures.
(p.92) Le boisage
Si les galeries creusées dans le sable ne demandent pas un boisage particulièrement solide, il n’en est pas de même des galeries en terre où plusieurs facteurs déterminent, outre la distance à laisser entre les cadres, la grosseur et la nature des bois employés.
D’abord, voyons la nature de la terre. D’une manière générale, dans les terres maigres, les galeries tiennent bien, mais, dans les terres grasses qui contiennent des limés, la terre glisse entre les cadres provoquant des poussées parfois très fortes. La nature générale du sol et du terrain influence également la poussée des terres suivant que l’on se trouve dans un gisement vierge ou dans un gisement où plusieurs étages de galeries ont été percés. Il faut, en plus, tenir compte de la profondeur à laquelle on se situe, de l’humidité des terres et du voisinage éventuel de sables boulants, de « boulies », etc.
Le boisage des galeries s’effectue par cadre simple ou par cadre à semelle ou seuil. Le cadre simple se compose de trois pièces: le « chapeau » ou « tête », li tièsse, et deux montants, les copes. Au cadre à semelle s’ajoute un bois, le « seuil », li sou, qui se place sous les montants. (Cf. fig. n° 5).
On utilise le cadre à seuil quand le terrain n’est pas assez dur pour empêcher les montants de s’enfoncer dans le sol, et, en général, chaque fois que les terrains exercent des poussées provoquant le rapprochement des pieds des montants, puis, finalement, l’écroulement de la galerie.
Les bois sont toujours préparés à mesure et façonnés à la surface de manière à ne plus recevoir, éventuellement, qu’une petite retouche à la cognée lors de leur placement dans la galerie. C’est le bouleau qui est le plus souvent employé, mais d’autres essences dures servent aussi; on évite le sapin à cause de son odeur pénétrante.
Le bois de la « tête » présente une simple entaille à chacune de ses extrémités; la partie supérieure du montant, taillé en biseau, viendra s’y glisser. Le bois du seuil a deux entailles obliques, lès-acrins, destinées à recevoir les extrémités inférieures des montants, elles aussi taillées en biseau.
La pose du cadre peut se faire de deux façons. La première consiste à mettre d’abord la tête. L’ouvrier creuse au moyen de la houe un (p.94) petit trou au sommet de la paroi et il y introduit une extrémité du bois; tandis que son aide soutient l’autre bout, il fixe le pied du montant et fait glisser, en forçant, la partie supérieure biseautée dans l’entaille de la tête; il pose le second montant de la même manière.
La seconde consiste pour l’ouvrier à installer d’abord les montants. Son aide les maintiendra, ou bien lui seul les fera tenir à l’aide de légers supports, lès stipes, pendant qu’il fera glisser la tête sur les deux extrémités.
S’il s’agit d’un cadre avec seuil, on place d’abord le seuil, puis les deux montants et enfin la tête, comme dans le cas précédent.
Lorsque les terres ont tendance à pousser, on prend en plus la précaution de caler entre les seuils, au pied des montants, une pièce de bois appelée sèra.
En terrain normal, la distance entre les cadres est de 50 cm environ; en terre tendre ou dans des passages difficiles, on devra les rapprocher parfois jusqu’à les joindre. Il arrive dans certains cas, notamment pour empêcher la venue de « boulies » ou de « boulants », que l’on soit amené à garnir le toit et les parois avec de la paille, ou mieux, avec du foin ou des mousses maintenus par de petites planches, des wâdes, chassées dans l’axe de la galerie contre les bois.
Comme il y a souvent des infiltrations et des suintements d’eau, on ménage tout le long de la paroi de la galerie, une sorte de rigole, one courote, destinée à recueillir les eaux et à les mener jusqu’à la galerie en sable où elles se perdront d’elles-mêmes, ou jusqu’au puits qu’on aura eu soin de foncer plus bas que le niveau des galeries de façon à constituer un puisard, bouyou ou broutia, d’où elles seront éventuellement remontées à la surface. Cette opération se fait presque toujours au moyen d’une espèce de tonneau, badou, qui se remplit dans le fond du puits avant d’être remonté au jour, au djoû, par le treuil d’extraction. Dans certains sièges pourvus du courant électrique, on utilisait une pompe.
L’exploitation
La longueur des galeries d’extraction dépend certes de l’importance du gisement, mais aussi de la nature de la terre: dans les terres fluantes, elle sera évidemment moindre que dans les terres sèches et dures à mouvement très lent.
(p.95) Lorsqu’une galerie est parvenue à sa limite, on enlève, quand c’est possible, tout ou partie des cadres, en r’côpant la terre qui s’est insinuée entre eux. C’est le « ramassage en retour ». Le retrait des bois permettra aux terres de descendre lentement pour refermer, en fin de compte, la galerie. Au bout d’un certain temps, une nouvelle galerie pourra repasser au même endroit. Cela peut même se produire plusieurs fois, jusqu’au moment où de mauvaises terres indiquent que le bord supérieur du gisement est descendu. On ne peut cependant pas procéder à l’enlèvement des bois lorsqu’on se trouve en présence d’une galerie dont le toit est trop près de mauvais terrains (sable noyé, « boulies », etc.), ou du fond de la mare de surface. Au contraire, dans ce cas, on maintient la galerie en bon état, on renforce et on remplace les bois brisés afin d’éviter l’inondation des travaux.
Signalons encore une autre méthode d’exploitation, très dangereuse, et, par conséquent, interdite par les règlements. Travayî à chache loûde consiste à provoquer, en ôtant quelques cadres en bout de galerie, des éboulements et à ouvrir ainsi de larges cavités dans le gisement. Une technique aussi sommaire comporte des risques d’accidents pour les ouvriers et pour l’exploitation qui peut être noyée par une arrivée d’eau brutale.
Autrefois, le hiercheur, hèrtcheû, acheminait les blocs abattus à la taille vers le fond du puits au moyen d’une brouette, bèrwète, ou par glissage sur des planches disposées sur le sol et continuellement humidifiées. Par la suite, pour accroître le rendement, on installa des rails et c’est sur un petit wagonnet plat qu’on transporta les blocs, rukes, ou les bacs, batch, contenant les morceaux de terre. Avant l’entrée en vigueur du bac en bois carré muni d’une anse métallique, on employait un solide panier d’osier, pani.
Au fond du puits, le hiercheur entoure le bloc d’une chaîne qu’il suspend au crochet fixé à l’extrémité du câble. Quand il s’agit d’un panier ou d’un bac, il le pend plutôt au havèt. Alors, pour prévenir les hommes de la surface que la remonte est prête, il tire sur un filin qui longe la paroi du puits, faisant ainsi tinter une sonnette accrochée près du treuil.
Le treuil à bras décrit ci-dessus est mû par un ou deux trèyeûs. ils ont aussi pour tâche de découper les gros blocs, de trier les qualités différentes et de stocker la production dans la baraque; ils sont encore (p.96) chargés de façonner, seuls ou avec l’aide des hommes du fond, les bois destinés au boisage.
En arrivant à la surface, le gros bloc ou le bac soulève les deux clapets du treuil, clapâ, qui retombent derrière lui. L’ouvrier amène le bloc sur le sol et le débite en blocs plus petits. Cette opération s’effectue au moyen d’un fil d’acier pourvu d’une menotte en bois à chacune de ses extrémités; l’une d’elles est maintenue sous le bloc, tandis que l’on provoque la pénétration du fil dans la terre par une traction sur l’autre. Pour faire ce travail, l’ouvrier s’assied par terre: il évite ainsi de tomber en arrière si le fil d’acier vient à se rompre, comme cela arrive fréquemment.
Dans les terres dures ou lorsque les blocs remontés sont très gros, on utilise une machine assez simple: on amène le bloc dans l’angle d’un châssis métallique en équerre et on l’entoure du fil de découpage. Ce dernier est un peu plus gros que celui qui sert au découpage à la main; une extrémité de ce fil est fixée au châssis, tandis que l’autre s’enroule sur un petit tambour commandé par une manivelle et des engrenages.
Le bloc découpé et les morceaux mis en place, le trèyeû renvoie le crochet au fond, avec ou sans bac; c’est aussi à ce moment qu’il descend les bois pour le couplage. La plupart du temps, en tout cas lorsque la charge n’est pas trop lourde, il ne se sert pas des manivelles du treuil, mais il la laisse descendre entraînée par son propre poids. Il veille toutefois à freiner sa vitesse en tenant ses deux mains serrées sur le tambour ou en s’aidant d’une bande de caoutchouc attachée à un des montants et pressée sur le tambour; cela s’appelle dischinde à l’ frôye,
Le treuil à bras ne peut plus suffire pour desservir des puits profonds, surtout si l’extraction est intense, comme cela se passe de plus en plus fréquemment. Leur coût fait que l’on réduit le nombre de puits alors qu’on augmente celui des galeries. On substitue alors le cheval à l’homme pour la remonte. L’animal tourne dans un manège voisin du puits; il actionne un gros tambour fixé sur un axe vertical et sur lequel s’enroule le câble. Un tel manège pouvait même desservir deux puits à la fois (fig. 6).
Plus tard, la remonte s’est effectuée au moyen de moteurs à essence ou à mazout, actionnant un treuil muni d’un tambour sur lequel (p.98) s’enroule le câble qui descend dans le puits par l’intermédiaire d’une poulie située au-dessus d’un châssis installé sur l’orifice du puits.
Lorsque le courant électrique put être acheminé sur les lieux d’exploitation, le travail fut grandement facilité grâce aux treuils électriques, entièrement fixés sur le châssis, au-dessus du puits, grâce à l’emploi des pompes pour l’exhaure des eaux, aux ventilateurs, à l’éclairage enfin.
Le trèyeû avait donc de multiples activités. Avant tout, il devait être un homme sûr; c’est en effet de lui que dépendait la tâche délicate de la descente et de la remonte du personnel.
Pour descendre, l’ouvrier met le pied gauche dans le havèt, le câble à l’extérieur. Il se tient au câble d’une ou des deux mains. Par mesure de sécurité, il se passe une ceinture de cuir autour du corps après l’avoir enroulée d’un tour ou deux au câble. Il se guide dans le puits avec le pied droit. Il est donc ainsi complètement à la merci du trèyeû. C’est pourquoi le Règlement des Mines impose la présence de deux trèyeûs pour cette opération; s’il s’agit d’un treuil mécanique, il faut prévoir un frein automatique qui bloque le tambour en cas de défaillance de l’homme chargé de la manœuvre.
Dans le cas de sous-puits droits ou inclinés, les blocs sont remontés par un treuil à bras muni d’une seule manivelle, à cause de la dimension assez faible de la galerie.
L’aération
Les galeries étant naturellement des culs-de-sacs, l’aération y est particulièrement difficile. On est donc obligé de provoquer le renouvellement de l’air par divers moyens.
Sauf à faible profondeur (exploitation des bords du gisement), chaque puits doit obligatoirement être doublé, c’est-à-dire relié à un second puits par une galerie presque toujours percée dans le sable, terrain peu affecté par les mouvements des terrains exploités. Le second puits est aussi une sortie de secours en cas d’accident (éboulement, coup d’eau, arrivée de gaz) et enfin un moyen d’aération, l’air entrant par un puits et sortant par l’autre. C’est une aération naturelle. Il arrive pourtant, notamment par temps de brouillard ou de forte chaleur, que l’aération ait du mal à se mettre en marche. Un moyen d’y (p.99) remédier est de suspendre au câble d’un des deux puits un grand récipient dans lequel on a allumé un feu de bois assez important. Cependant, lorsqu’il est trop souvent répété, ce système a l’inconvénient de détériorer les parois du puits, surtout quand celles-ci sont garnies de paille; il peut en outre causer des incendies.
On provoquait généralement la circulation de l’air en plaçant jusqu’aux tailles des tuyaux, des bûses, en tôle galvanisée qui aboutissaient à l’air libre, au-dessus du puits, à un pavillon en forme d’entonnoir, li trétwè, et orientable selon la direction du vent. Ce système était suffisant pour des puits peu profonds. Dans les autres cas, on établissait, avec ces mêmes buses une aération forcée en se servant d’un ventilateur à main, li diâle, qu’un manœuvre actionnait en cas de nécessité.
Avec la mécanisation, les problèmes disparurent: des ventilateurs puissants étaient actionnés par l’un ou l’autre moteur.
L’éclairage
Jadis, des lampes à huile, crassèts, assuraient un éclairage très précaire. On les remplaça ensuite avantageusement par des lampes à carbure. À ce moment, la législation obligeait le chef de fosse à parcourir, avant l’arrivée du personnel, les différentes galeries, muni d’une lampe de mine de sûreté, afin de déceler la présence éventuelle de gaz inflammable. Celui-ci, qui provient en général de la décomposition de vieux bois d’anciennes exploitations, peut s’accumuler au cours de la nuit, à tel point qu’une explosion est possible s’il est mis en contact avec une flamme nue.
On n’eut heureusement à déplorer que peu d’accidents dus à quelques poches de gaz qui explosaient lorsque l’ouvrier les perçait en travaillant.
Ici aussi, la modernisation a été ressentie comme très bénéfique, puisqu’elle a permis, du moins dans les exploitations d’une certaine importance, l’installation de l’éclairage électrique.
Les rétributions
Dans les exploitations de terre plastique, la rétribution des ouvriers a toujours été convenable par rapport à bien d’autres métiers.
(p.100) La plupart du temps, le personnel d’une fosse constituait une véritable équipe. On avait par exemple, deux, trois ou quatre « haweurs », dont un était le « chef de fosse », un « hiercheur » et un ou deux « trèyeurs ». Comme on disait, cette équipe «a vait la fosse à marché ».
Durant longtemps, il fallut exploiter journellement un tonnage minimum appelé payèle. Toute la production qui dépassait ce seuil donnait droit à une prime intéressante. Mais il arrivait plus souvent que l’équipe soit simplement rémunérée au tonnage: il n’y avait pas de salaire journalier fixe, mais seulement une somme donnée pour chaque tonne exploitée; à la fin du mois, le montant total était réparti entre les membres de l’équipe en suivant une échelle bien déterminée: les hommes de fond, surtout les « haweurs » touchaient plus que ceux de la surface.
Le métier de mineur en terre plastique, tel qu’il était pratiqué dans le Condroz par un grand nombre d’hommes, a apporté une aisance appréciable à beaucoup de familles. Cette profession, exercée dans une région rurale, permettait souvent à de nombreux ménages de bénéficier d’un revenu supplémentaire grâce à une petite exploitation agricole: un peu de culture, du bétail…
N’oublions pas non plus que ces mineurs ont été assimilés à leurs confrères des charbonnages et qu’ils ont pu toucher une bonne pension de retraite en fin de carrière.
Jean dernoncourt
LEXIQUE
acrin, m., entaille dans les bois des cadres de boisage pour permettre leur
assemblage et leur maintien en place.
apâ, m., ensemble formé par les deux clapets du treuil et qui doit recevoir les
blocs de terre ou les bacs à leur arrivée à la surface.
astantche, f., digue ou barrage léger, construit avec des bois, de la paille et
de la terre plastique pour stopper une arrivée d’eau ou de « boulies » dans
une galerie.
aurzîe, f., argile ordinaire
avaler, creuser un puits, v. foncer.
badou, m., grand récipient servant à la remonte des eaux depuis le fond du puits.
barake, f., hangar recouvrant le puits; il est destiné à sa protection et au
stockage des terres extraites.
basse, f., mare formée à la surface dans l’affaissement des terrains exploités.
batch, m., bac carré en bois servant à la manutention des morceaux de terre, du sable, des déchets, etc.
bèrwète, f., brouette. Employée surtout par le hiercheur.
beûsson, m., tourbillon en fer qui se trouve à chaque extrémité du tambour du treuil et reposant dans la fourche de celui-ci.
bolant, m., matière sableuse contenant assez d’eau pour la rendre coulante.
bolîye, L, « bouli e», terre détrempée, gorgée d’eau.
bouyou, ni., puisard creusé au fond du puits pour récolter les eaux venant des galeries. Syn. broutia.
bourikèt, m., sous-puits creusé dans le sein de la veine et suivant souvent son
inclinaison.
broke, f., broche — grosse cheville en bois.
broutia, m., v. bouyou.
bure, m., puits — fosse à terre plastique.
buse, f., tuyau, tube en zinc ou en tôle placé dans le puits et les galeries en vue de leur aération. bwès, m., bois. Désigne les différentes pièces de bois formant les cadres de
boisage des galeries et spécialement les montants.
carote, L, échantillon de terre remonté par la louche de sondage, v. rututu.
chache loûde, travailler à chache loûde, c’est laisser descendre de la terre par le toit de la galerie après avoir enlevé quelques cadres.
clapète, f., longue planchette mince et pointue destinée à maintenir le sable en place lors de l’avancement d’une galerie.
coche, {., baguette, généralement de noisetier, servant à maintenir la paille
dans le garnissage du puits ou des galeries dans le sable.
cope, f., montant du cadre de boisage.
copier, mettre en place les bois constituant le cadre de boisage.
coublète, f., manivelle du treuil à bras.
courote, f., rigole ménagée le long d’une paroi de la galerie pour permettre
l’écoulement des eaux.
couyî, f., louche ou cuillère destinée au forage.
crassèt, m., ancienne lampe à huile.
crawe, f., terre plastique de qualité inférieure.
cro, ni., crochet assez large suspendu au petit crochet du câble; les ouvriers y mettent le pied pour descendre dans le puits.
crosse, f., premier élément du jeu de sondes, baguette munie d’une poignée
de manœuvre. cwacle, f., corde. dègn, m., couche de mauvaise terre enveloppant la veine de terre plastique.
d’foncé, m., à la surface, les terrains affaissés qui ont amené la formation d’une mare, basse.
diâle, m., diable. Ventilateur actionné à la main.
dièle, f., derle, terre plastique plus ou moins grasse et compacte, argileuse, que l’eau ne pénètre pas.
dièleû, m., ouvrier travaillant dans les exploitations de terre plastique.
dischinde, descendre. Dischinde on bure: faire un puits.
~ al fraye : v. fraye,
discopeler, enlever les cadres de bois lorsqu’une galerie est parvenue à sa limite d’exploitation.
disloyî, délier. Se dit lorsqu’on enlève les ers défectueux pour les remplacer par des nouveaux.
djoû, m., jour, au djoû: à la surface.
dissère ou dèssère, f., dans la taille, les piliers médians dont un sera détaché
le premier.
êr, m., longue perche, généralement en charme, qui constitue le cerceau pour le garnissage du puits.
fièrmint, m., courbet servant notamment à amincir les cerceaux. foncer, creuser un puits.
foradje, m., forage, sondage.
forer, sonder.
fosse, f., puits. Travayi à l’ fosse: travailler dans les exploitations de terre
plastique.
fossieû, m., ouvrier travaillant à la fosse, aux exploitations.
frôye, f., frottement. Dischinde à l’ frôye: laisser descendre dans le puits en
freinant avec les mains ou avec une bande de caoutchouc sur le tour.
grète ou grèteûse, f., longue baguette d’acier à l’extrémité coupante, servant
à faire les rainures dans la taille.
havèt, m., gros crochet. Syn. cro.
hawe, f., houe plate servant particulièrement à détacher les blocs de la taille.
hawer, se servir de la hawe.
haweû, m., ou « haweur »: ouvrier qui extrait la terre à la taille.
hayon, m., grand paillasson de paille à armature de bois constituant un élément de la baraque installée au-dessus du puits.
hèrtchî, amener les blocs depuis la taille jusqu’au fond du puits, par glissage, à l’aide de la bèrwète ou d’un petit wagonnet sur rails.
hèrtcheû, m., ouvrier chargé de ce travail. « Hercheur ».
limé, m., fente produite par le glissement ou le tassement des terres, principalement dans les terres grasses.
loce, f., louche, cuillère fixée à l’extrémité des baguettes de sondage pour ramener l’échantillon à la surface.
loyi, lier. Spécialement placer les ers dans le puits — cercler.
machuria, m., lignite brun-noir rencontré lors du fonçage du puits ou du percement de galeries.
maujire, f., paroi latérale des galeries.
nivia, m., le niveau hydrostatique.
noû, nouveau. Riloyi à noû: remplacer dans sa totalité le garnissage du puits.
ostèye, f., Outil. Spécialement pelle plate triangulaire servant au découpage
à la taille.
ovrî, m., ouvrier. Ovrî d’fosse : ouvrier mineur.
pani, m., panier d’osier servant autrefois à la remonte des morceaux de terre
ou du sable.
paumale, f., grande pièce de bois servant de charpente aux paillassons,
hayons,
payèle, f., tonnage de terre que doit exploiter un ouvrier ou une équipe en
une journée de travail.
pîd, m., pied, partie inférieure. Ancienne mesure de longueur (30,47 cm) toujours employée pour donner les dimensions des bois pour le boisage.
pilé, m., pilier. Se dit des parties de la taille délimitées par les rainures verticales faites à la gratteuse.
plonkî, plonger. Avancer une galerie en descendant.
pôce, m., pouce. Mesure ancienne de longueur (27,7 mm).
potale, f., petit emplacement creusé dans la paroi de la galerie pour donner un point d’appui provisoire au chapeau du cadre lors de sa pose, ou au pied d’un montant.
pougnète, f., poignée en bois à chaque extrémité du fil d’acier servant à découper les blocs de terre.
rantchi, achever de détacher le bloc de terre à la taille, en imprimant un quart de tour avec la lame de la houe.
rascoude, recevoir le bloc de terre ou le bac sur les deux clapets, clapâ, du treuil à leur arrivée à la surface.
ricôper, recouper. Exploiter les terres lorsqu’on enlève les cadres.
rilé, m., retrait laissé à chaque avancement de la taille, le long de la paroi de la galerie.
riloyî, relier, recercler avec de nouveaux cerceaux.
ruke, f., gros bloc de terre.
rututu, m., échantillon de terrain ramené par la sonde. Syn. carote.
suvion ou sauvlon, m., sable.
sèra, m., pièce de bois placée entre les pieds des montants pour les empêcher de se rapprocher l’un de l’autre.
simpe, simple. R(i)loyî à simpe, remettre de nouveaux cerceaux entre les anciens pour consolider le puits.
sou, m., seuil, pièce du cadre de boisage entre les pieds des montants pour résister à la pression des parois latérales. stipe, m., pièce de bois servant de soutien. strin, m., paille. tchèna, m., autre nom du panier en osier; v. pani.
tchène, f., chanvre. Cwade di tchène, corde de chanvre.
tchoûkî, pousser. Se dit en parlant de la poussée des terres.
tchèssadje, m., premier bloc en coin détaché à la partie supérieure d’un pilier de la taille.
têre, f., terre.
tèrére, f., litt. tarière. Baguette de sondage, dite aussi vèdje.
tièsse, f., tête. Nom du chapeau, c’est-à-dire du bois du cadre se trouvant
contre le plafond de la galerie.
tour, m., partie cylindrique du treuil, sur lequel s’enroule le câble.
trétwè, m., grand entonnoir métallique fixé aux buses d’aération au-dessus
du puits et destiné à capter le courant d’air produit par le vent.
trèyeû, m., tireur. L’ouvrier préposé au treuil et aux divers travaux de la surface: triage, stockage des terres, préparation des bois. twè, m., toit, plafond de la galerie.
twèse, L, toise, unité ancienne de longueur (1,949 m), toujours employée aux exploitations pour indiquer la profondeur du puits et la longueur des galeries.
vèdje, f., verge; baguette métallique, élément du jeu de sondes; v. tèrére.
vôye, L, voie. Se dit d’un groupe de quelques cerceaux dans le garnissage du puits.
wâde, f., garde; planchette placée entre les cadres et les parois ou le plafond pour tenir la paille, le foin ou les mousses de façon à empêcher l’infiltration de sable ou la chute de morceaux. win.ne, f., veine de terre plastique. yo-yo, m., pièce de bois ronde et pointue sur laquelle s’enroule le fil d’acier.
BIBLIOGRAPHIE
calembert, L., Les gisements de terres plastiques et réfractaires d’Andenne et du Condroz. Préface de G. Biaise. Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1945, 204p.
dony, E. et bragard, L., Vocabulaire technologique du tireur de terre plastique. BSLW, 1909, t. L., pp. 605-628.
hubeaux, R., L’exploitation des gisements de terres plastiques et réfractaires d’Andenne et du Condroz. Mémoire. École de Commerce de l’Université de Liège, 1949-1950.
lahaye, L., Cartulaire d’Andenne. Namur. Ad. Wesmael-Charlier, 1896.
martens, M. J., Notes sur les gisements de terres plastiques de la région de Namur et sur leur exploitation. Dans Annales des Mines de Belgique, Bruxelles, Impr. Robert Louis, T.43, 1942.
Jean Fraikin, in : Tradition wallonne, 2, 1985, p.107-138
Armand Tombu, Nos pupîs à l’ ovradje
1 Lès puperîyes
I faut d’djà r’monter hôt po trover quand c’ èst qu’on-a k’mincî à fé dès pupes di tère à An.nenale. Todi è-st-i qui v’là nin lon èrî d’ deûs cints-ans, i-gn-aveut d’djà on fieû d’ pupes au rivadje. I prov’neûve d’ Alemagne, corne d’alieûr lès cis qu’ont v’nu, mins brâmint pus taurd, monter dès puperîyes à Tchôkîr, è payis d’ Lîdje, et dins 1′ Limbourg, à Bréye, on p’tit viyadje à l’ frontiére dèl Holande.
Li fis, qu’ aveut porsû lès-afêres di s’ pére, si loumeûve Pétèr, come li. Mins Pétèr, ça soneûve mau aus-orèyes da nos vîs parints ; ci n’ èsteut nin on nom walon çola ! Ossi l’ aveut-on r’batisé, èt Pétèr aveut divenu Pière ; mins come i lî faleûwe on sornom corne tot l’monde ènn’ aveut onk di ç’ timps-là, on n’ l’ apèleûve jamês ôtemint qui 1′ «Pète». C’ èsteut « mon 1′ Pète ».
Li Pète dimeureûve au rivadje, à mitan vôye en ‘nn’ alant après l’ tchêrote. Si puperîye èsteut pa-drî s’ maujone, dins lès djârdins dè costé dè l’ rouwale dès baudèts.
À paurti d’ alôrs, i s’ a douvièt dès-ôtès fabrikes di pupes, principâlemint au rivadje èt « su l’ ri». I s’ ènn’ a monté ossi plusieûrs à Andène.
Nos prumèrès puperîyes n’ èstin.n qui dès p’tits-atèliers, èwoù-ce qui l’ mêsse travayeûve avou sès-èfants èt quékes-ovrîs qu’ il aveut rascrûtés à drwète et à gauche. Ci n’ èsteut wêre dès fabrikes come on ‘nnè veut asteûre, à bin lon près ! On p’tit trau po bate li tère, deûs-trwès tchambes po lès-ovrîs èt lès-ovrêres, mouleûs, rôleûses, trimeûses èt glaceûses, one-ôte po-z-èbaler lès pupes, èt one miète pus lon, li for avou on-abatu po lès dièles, èt vola l’ puperîye di d’dins l’ timps. Gn-aveut pont d’ machinerîyes po travayî lès tères, pont d’ prèsses ni nuk di tos lès-indjins qu’ on s’ siève audjoûrdu. Po lès fors, c’ èsteut ossi tot ç’ qu’ i-gn-aveut d’ pus simpe, èt on n’ conicheûve nin di ç’ timps-là lès fors à blame rivièsséye.
Lès p’tits mêsses-pupîs aurin.n iu dè mau di s’ aritchi. Is vikotin.n mins is t’nin.n à leû mèstî. Tos leûs-ovrîs ossi d’ alieûr, èt portant zèls non pus ni gangnin.n nin masse.
Avou l’ timps, dès pupîs qu’ i-gn-a avin.n agrandi one miète leûs prumîs botikes èt is s’ avin.n sitindu di p’tit-z-à-p’tit. È l’ place di cink ou chîs-ovrîs come en c’minçant, dès fabrikes avin.n arivé à ‘nn’ oyu vint’ ou trinte, èt pus taurd, gn-a min.me iu one, « à l’ Baye» come on d’jeûve, qu’ ènn’ aveut près d ‘cint cinkante. On pout dîre qui, là trwès quârts di siéke, i p’leûve iu di 200 à 250 ovrîs èt ovrêres dins lès puperîyes d’ An.nenale.
Li mèstî d’ pupî n’ èsteut nin ci qu’ on pôreut dîre on fwârt mèstî. Mins si l’ ovradje n’ èsteut nin dès pus malaujîs, po l’ mwins’ po lès pupes unîyes, i faleûve portant èsse fwârt awejî d’ sès mwins èt travayî prôprèmint : lès bôleûs n’ aurin.n jamês soyu fé grand-tchôse di bon.
Lès pupes si fièt avou dè l’ dièle come on ‘nnè tire, dispôy là dès cints-ans, dins brâmint dès viyadjes d’ autoû di-d-ci, à Coutisse, Bounevîye, Groyine, Mozèt èt 1′ rèsse.
2 Li dièle
Li dièle dè l’ réjion d’ Andène, qui convint po lès pupes, èst blanke quand èlle èst cûte. Lès rodjès pupes èstin.n faîtes avou dè l’ fine tère qui lès mêsses pupîs riçcuvin.n d’ Alemagne, èt qui cûjeûve d’ on bia rodje.
Lès dièles sont crausses ou mwinres. C’ è-st-au mêsse-pupî à trover ci qui lî convint 1′ mia èt à fé lès mèlanjes qu’ i faut po-z-ariver à oyu one tère qui s’ travaye aujîyemint, sins s’ finde èt sins s’ kitaper è for.
Nos vîyès puperîyes ni fyin.n por insi dîre qui lès pupes po fumer: on n’ conicheûve wêre qui zèles dins l’ timps èt èlles èstin.n à l’ môde dins faut-i dîre tos lès payis.
Quékes-atèliers travayin.n ossi po lès tirs di d’ssus lès fièsses : on loumeûve ça « fé dès bokèts ». Lès pupes po lès tirs ni d’mandin.n wêre ot’tant d’ façon qu’ lès-ôtes, come nos 1′ veûrans pus lon.
Gn-aveut dès cints modèles di pupes. Lès mêsses-pupîs fyin.n tofèr dès novias moules, vrêmint à l’ èvîye. Lès pus courantès pupes, c’ èsteut « lès-unîyes» ; dès-ôtes, qu ‘on-z-apèleûve « lès dècoréyes », èstin.n couviètes d’ ôrnèmints, di fleûrâjes, ou bin èles riprésintin.n dès bièsses ou totes sorts d’ indjins, èt min.me fwârt sovint dès grands pèrsonâjes : on l’zî mèteûve âdon on nom d’ après ci qu’ èles rimostrin.n.
Chake payis, chake contréye, pout-on dîre, aveut sès modèles préférés. Vêci, i n’ faleut qui dès pupes vèrnîyes, ôte paut, c’èsteut dès cines tirant su l’ djène, dès rodjès ou min.me dès nwâres.
Gn-aveut ossi dès pupes avou dès p’titès quèwes, lès « coûtes »; dès ôtes avin.n li quèwe longue ou d’méye longue, èt one longue pupe, « li Montwèse », par ègzimpe, aveûve one quèwe qui n’ mèsureûve nin lon èrî d’ deûs pîds.
On fieûve ossi dès tièsses qui s’ montin.n su on touyau d’ one ôte matiére, come li bwès d’ cèréjî ou bin l’ djonc, avou on d’bout d’ ambe ou d’ cwane èt min.me, à fîye, di cume. Qui èst-çe qui n’a nin conu « li Vî Jacob » qui nos puperîyes ont vindu pa cint mile dins totes lès cwanes dè payis èt à l’ ètranjer !
3 Li mêsse-pupî
Dj’ a scrît one miète pus hôt qu’ on n’ troveûve pont d’ machinerîyes di nune sôrt dins nos vîyès puperîyes. Tot s’ î fieûve à l’ mwin, ossi l’ ovradje î èsteut-i brâmint pus curieûs qui tot ç’ qu’ on pout fé audjoûrdu.
Nos-alans, si vos l’ v’loz bin, passer one pitite rivûwe dè vî mèstî d’ pupî èt veûy èchone comint qui ça roteûve dins nos fabrikes dè timps passé.
Li mêsse-pupî a stî fé on toûr aus fosses. Ci côp-ci, ç’ a stî è 1′ Trîche-aus-pékèts. Il a tchwèsi tot qu’ i-gn-aveut d’ mèyeû, après s ‘oyu assûré qu’ lès tères n’ èstin.n nin trop sauvioneûses, en ‘nnè k’hagnant inte sès dints on p’tit bokèt qu’ il a scrèpé djus d’ one ruke avou s’-t-ongue. Come li pus fine èst trop crausse, i ‘nn’ a d’mandé on trwèzin.me tchaur di pus mwinre, mins todi di prumêère qualité, po 1′ p’lu machî avou l’ ôte.
Lès tchaurs à 1′ dièle, come on ‘nnè rèscontère co saqwantes aujoûrdu, rôlin.n adon d’ au matin à l’ nêt t’t-avau nos vôyes. I n’ faleûve nin seûlemint dè l’ tère po lès puperîyes, mins lès fabrikes di fayence d’ Andène ènn’ ûsin.n brâmint ossi èt on ‘nn’ èvoyeûve à make è 1′ Holande. Lès tchaurs purdin.n dès fwâtès tchèdjes, jusqu’à cink èt chîs mile, èt come lès-abôrds dès fosses n’ èstin.n jamês dès pus-aujîyes, i faleûve co bin atèler trwès, quate èt minme cink tchivaus.
Quékes djoûs après ç’ qui 1′ mêsse a stî à 1′ fosse, li prumî tchaur arive à 1′ fabrike. Li bateû d ‘tère èst d’djà d’ âdje èt i faut portant distchèrdjî au pus abîye. I va douviè à craye lès-uchs dès tchambes an criyant : « Gn-a on tchaur ! ». Ossi vite, trwès quatre omes si lèvèt po lî aler d’ner on côp d’mwin. Is pwartèt lès rukes dizos on-abatu, li pus sovint djondant l’ for, èt qui n’ èst qu’ tot simplèmint couvièt po garanti lès tères dè l’ plêve. Èlles î pôront souwer tot doûcemint avou lès courants d’ êr èt l’ tchaleûr dè for quand on cûrè.
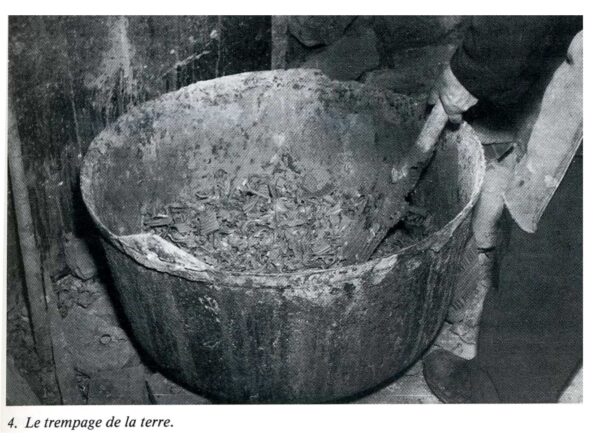
4 Li bateû
Fêt-à-fêt qui l’ tère soûwe, on câsse lès rukes à p’tits bokèts èt on lès fout dins one grande fosse di deûs fiêrs di locèt bas : li tère va d’morer là dès samwin.nes au long, èlle î poûrirè èt s’ î « r’meûrirè », s’apinsenut lès pupîs. C’ èst là qui 1′ bateû d’ tère vint qwêre ci qu’ i lî faut, dins on batch di bwès. Li tère est divenoûwe filante, èlle a « d’pus d’ cwârp » èt èle si travaye pus aujîyemint.
Li bateû vûde sès batchs su on long banc, èt quand i ‘nn’ a fêt on moncia di tote li longueû, i l’ côpe à trintches avou one ostèye di fiêr, li plène. Quand il è-st-arivé au coron dè moncia, i r’côpe totes lès trintches, qu’ ont toûrné one su l’ ôte, en c’minçant pa où-ce qu’ i vint dè fini èt i ric’mince li min.me manéje on trwèzin.me côp. Mins i faut qui 1′ tère seûye kitayîye li pus possibe èt qu’ i n’ î d’meûre nin one rukète. I faut ossi qu’ lès craussès dièles sèyèche bin machîyes avou lès pus mwinres. Li bateû côpe adon l’ moncia à p’tits balots, qu’ i candje di place on côp ou deûs en lès k’mèlant bin onk avou l’ ôte, èt i r’côpe chake côp li moncia à trintches avou 1′ plène. Ci n’ èst nin co assez: i r’fêt cor on côp ou deûs dès p’tits balots, lès toûne èt lès r’toûrner li cu-z-au hôt ou l’zî fêt fé on d’mèy toûr po-z-èsse bin sûr qu’ i gn-a rin qui n’ eûye sitî côpé èt i r’côpe pa 1′ plène. Po fini, l’ ovrî paurtadje li moncia à pus gros balots avou l’ filé (c’ è-st-on bokèt di fin fi d’ ârca avou one pougnète di bwès à chake coron), i tape èt r’taper chake balot di totes sès fwaces su s’ banc po lès fé pus ou mwins’ cârés èt po tasser l ‘tère come i faut.
Èt volà l’ matiére prète po lès rôleûses.
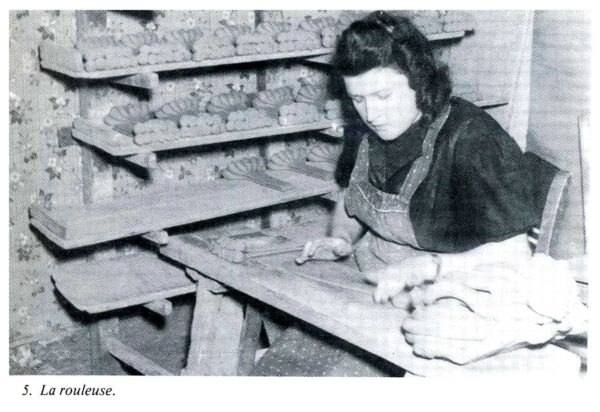
5 Lès rôleûses
Li travay dè l’ pupe kimince dé 1′ rôleûse.
Vo-le-là assîte à s’ banc, après s’ oyu mètu bin à mwin. Su 1′ costé gauche dè l’ tauve (li crapôde èst drwètîre), i gn-a on gros balot d’ tère. Èlle a d’vant sès-ouys li moule qui s’ papa va travayî d’ssus. èt en lî r’mètant, i lî a dit combin d’ grosses di rôles qu’ i lî faleûve fé.
Èlle apice one « pougnîye » di tère, avou s’ gauche mwin, èt èle li fêt rôler di d’vant èn-èrî, en lî lèyant one maclote à onk dès corons, po l’ tièsse dè l’ pupe, èt en-atènichant li rèsse qui dwèt fé l’ quèwe. Tot d’ on côp, li rôle, qui n’ èst co qu’ èbautchîye, passe dè l’ gauche mwin à l’ drwète, èt 1′ rôleûse apice one deûzin.me pougnîye di tère. Èle rôle asteûre avou sès deûs mwins, li drwète achève li role qui 1′ gauche a èbautchî.
Èt tanawète, li rôleûse présinte li role divant 1′ moule po veûy si l’ quèwe èst bin à l’ longueû èt à 1′ grocheû qu’ i faut. Quand èlle a fêt on pakèt ou deûs d’ roles, èle n’ a pus dandjî dè moule po s’ guider ; èlle a « lès mèseures è l’ ouy ». Mins divant dè l’ rimète au mouleû, èlle a portant sogne dè fé one rimârke su s’ banc po polu vèrifiyî di timps-in timps s’ èle travaye todi jusse.
Fêt-à fêt qui lès rôles sont fêtes, li rôleûse lès met su one plantche qu’ è-st-à s’ costé. Èle fêt passer à s’ drwète mwin li role kimincîye pa l’ ôte èt èle rapice ossi vite one novèle pougnîye di tère. Èt l’ ovradje rote insi tote li djoûrnéye.
Li rôleûse mèt su chake plantche doze pakèts d’ quinze roles, ci qui fêt 180 roles po-z-ariver à one grosse di 12 dozin.nes di pupes finîyes. Li difèrince, c èst po lès dèchèts. Chake pakèt a one rindjîye di chîs roles, pwis one di cink èt au-d’zeû one di quate. Lès pakèts sont mètus su l’ plantche avou les tièsses p’ au-d’foû, onk à drwète pwîs onk à gauche èt insi d’ swîte.
One boune rôleûse pout ariver à fè quatôze à quinze plantches su s’ djoûrnéye, ci qui fêt autoû di 2700 roles. Ça v’ donc à pinser lès mile èt lès mile côps qu’ èle dwèt fé aler sès brès po gangnî sès quékès mastokes, jusse sèt’ cens’ èt d’mèye po deûs grosses.
I gn-a tot-autoû dè l’ tchambe dès montants d’ bwès clawés è mur, avou dès longuès brokes èfoncéyes didins dispôy à l’ copète jusqu’à l’ valèye : c’ èst ç’ qu’ on loume « lès pirnèkes». C’ èst là-d’ssus qui 1′ rôleûse mèt sès plantches èt lès roles î vont souwer tot doûcemint on djoû ou deûs.
Quand l’ ovradje prèsse èt qui l’ mouleû ratind après lès roles, li rôleûse ni fêt sès pakèts qui d’ deûs rindjîyes, one di cink èt one di quate, po qu’ lès roles souwèche pus vite. Mins è l’ place di 15 pakèts, c’ èst 20 qu’ i faut qu’ èle mète adon dissus l’ plantche.
Rôler, c’ èst por insi dîre on-ovradje di feume. (sic) Portant, gn-a d’djà iu dès mouleûs qui fyin.n leûs roles zèls minmes. Insi à 1′ Baye, de trèvint qui dji v’ raconte, gn-aveut deûs mouleûs qu’ èstin.n dins l’cas, li p’tit bwagne Djan et l’ vî Bodok. C’ èsteut deûs vîs djon.nes-omes qui tripotin.n leû p’tit fricot à l’ fabrike èt qu’ avin.n min.me leû payasse dins onk dès batimints.
Li rôleûse n’ a pus à s’ ocuper dès roles on côp qu’ èles sont su lès pirnèkes : c’ èst l’ mouleû qu’ dwèt wêtî au souwadje. S’ i veut qu’ lès cines dè l’ rindjîye di d’zeû souwèt trop vite, i r’toûnerè l’ pakèt. Il arive min.me qu’ i dwèye ramouyî avou sès dwèts li rindjîye di d’zeû èt min.me li cine di d’zos qui djont l’ plantche, èt qui souwèt brâmint pus vite qui l’ cine d’au mitan.
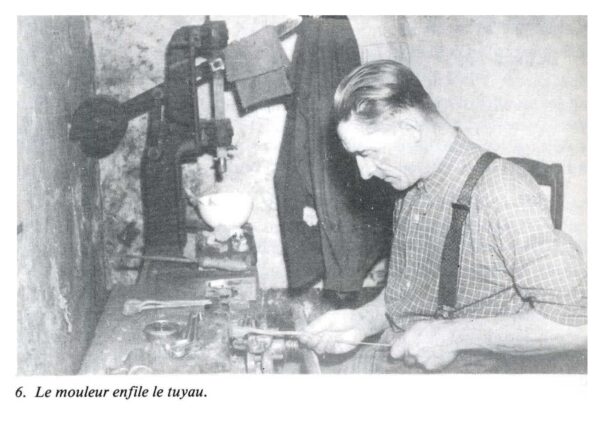
6 Li mouleû
On mouleû qui s’ lève èrî di s’ banc. I pwate li batch di pupes qu’ i vint dè fini po souwer èt i r’vint à s’ banc avou one plantche di roles. Maugré qu’ il î auye bin wêtî, gn-a saqwants pakèts qu’ sont par trop souwés. I lès drèsse, lès quèwes è hôt, dins one pitite tine d’ êwe po lès « ramouyî ». Nos vîs pupîs v’lin.n qui c ‘èsteut avou cès roles-là qu’ on fieûve lès pus bèlès pupes et qu’ èlles-èstin.n pus coriantes.
Tapans on p’tit côp d’ouy su s’ banc.
Su li d’vant, voci l’ vèrin avou one vis’ po prèsser l’ moule. Lès mouleûs gârnichèt, d’ après li spècheû dè moule, lès deûs costés dè vèrin avou dès plantchètes èt dès fouyes di cârton po qu’ ça fêye rissôrt èt d’ maniére qui quand l’ vèrin est sèré à fond, li manote dè vis’ dimeûre à plat à hôteû di leûs gngnos. Is t’nèt adon li manote à stok avou onk di leûs gngnos qu’ èst garanti avou on bokèt d’ cûr, li jènouliére. Quand l’ pupe èst « chtoupéy e», is r’ssètchèt l’ djambe qui rastineûve li manote èt l’ vis’ si dissère tote seûle.
Li moule èst douvièt su 1′ banc. C’ è-st-onk di pupe ôrdinêre èt i n’ èst qui d’ deûs pèces qui s’ assimblèt avou dès « claus ». Quand l’ tièsse è-st-ôrnéye, li « Jacob » par ègzimpe, li moule èst d ‘trwès pèces èt l ‘trwèzinme bokèt, qui fêt li d’vant dè l’ tièsse, si vint rèmantchî su lès deûs-ôtes avou dès claus. Lès moules si fièt d’ abitude di fonte, mins po lès pus complikés, on lès fêt d’ keûve, qu’ èst pus aujîye à travayî èt à ciseler.
À costé dè moule, gn-a li « chtoupe ». C’ è-st-on bokèt d’ fiêr dè l’ fôrme qui l’ fornia dè l’ pupe dwèt iu pa d’dins. Il è-st-èmantchî su one pougnîye di deur bwès qu’ a lès deûs corons vûdîs èt rimplis d’ plomb po rinde li chtoupe pus pèsant. Voci asteûre li « fiêr po-z-èfiler lès roles », qui n’ èst qu’on bokèt d’ fi d’ ârca monté su on p’tit mantche di bwès. Li fiêr è-st-one pitite miète rifoulé au coron ; c’ èst ç’ qu’on loume li « moche ». Po polu r’ssètchî aujîyemint li fiêr foû dè l’ quèwe dè l’ role, i faut qu’ i seûye rèyé. Po rèyer on novia fiêr, l’ ovrî l’ mèt su si gngno, garanti avou s’ jènouliére, èt i 1′ fêt tourner tot l’ fiant avanci, dismètant qu’ avou s’-t-ôte mwin, il aspôye dissus l’ lame d’ on vî coutia, mins qu’ a co on bon tayant.
Gn-a su l’ banc one pitite ostèye fête avou on bokèt d’ gros fi d’ ârca avou, su 1′ coron, on d’méy rond dè l’ grocheû d’ one quèwe di pupe. C’ èst l’ « chinke », qui siève à rabate lès costeures dè l’ quèwe. Dins 1′ mantche dè chinke, i gn-a come one lame di coutia, qui n’ passe qui d’ on d’méy centimète. C’ è-st-avou ça qui 1′ mouleû côperè l’ quèwe à l’ longueû qu’ èle dwèt iu, après l’ oyu « chinke».
Vos vèyoz co on p’tit rond batch di tole, d ‘on dwèt d’ hôt (ci n’ èst bin sovint qu’ one couviète di bwèsse). C’ èst 1′ « potèt » : il èst rimpli d’ coton d’ crassèt qui bagne dins one macheure d’ ôle di golzau èt d’ pètrole. Li mouleû î trimpe li chtoupe èt 1′ fiêr divant d’ s’ è sièrvu. Il î trimpe co sès dwèts po froter lès roles d’ on min.me pakèt quand i l’s-a disclapé èrî one di l’ ôte, èt afîye po-z-ècrauchi l’ moule quand lès roles sont-st-one miète croûwes èt qui l’ tère î vôreut tinre.
Asteûre qui nos conichans lès-ostèyes, nos pôrin.n wêti nosse vî Djan fé deûs-trwès pupes.
Po v’mincî, i disclape èrî one di l’ ôte lès roles di cink ou chîs pakèts èt i lès frote avou sès dwèts qu’ il a trimpé è potèt. Come i fêt fwârt tchôd, i lêt lès roles à plat su l’ plantche èt i lès rascoûve avou one frèche loke po qu’ èles dimorèche croûwes. Çola fêt, i prind one role èt, quausu sins qu’ on s’ ènn’ aporçûye, il a rauyî avou on dwèt èt s’ pôce one nukète di tère djus dè l’ tièsse, qui lès rôleûses fièt d’ abitude one miète fwate. Après oyu èfilé l’q uèwe, i mèt l’ role dins on mitan dè moule, assimbèle lès deûs bokèts èt i l’ lêt toûrner è vèrin. I done on toûr di vis’, rastind l’ manote avou si gngno èt volà 1′ moule sèré à blok. I prind li chtoupe, trimpe li bètchète è potèt èt l’ èfonce è fornia en donant deûs-trwès bons côps jusqu’à ç’ qu’ i seûye intré à rés’ d’ one bague qu’ èst mètoûwe jusse à mèseure po l’ hôteû dè fornia. Dè timps qu’ i tint li chtoupe à fond, li mouleû fêt avanci 1′ fiêr jusqu’à stok, pwis i r’ssètche li chtoupe foû dè moule. I boudje si djambe qui rastineûve li manote dè vis’, cit’-ci si distoûne èt l’ vèrin s’ tape au laudje. Li mouleû mèt l’ moule su l’ banc èt après l’ oyu douvièt, i sètche li pupe foû en l’ tinant d’ on costé pa 1′ mantche dè fiêr èt d’ l’ ôte avou si p’tit dwèt qu ‘il a tchoûkî è l’ tièsse. Li pupî rabat adon lès costeures dè l’ quèwe d’ on côp d’ chinke en t’nant l’pupe èmantchîye su 1′ fiêr èt il è côpe li coron po 1′ mète jusse à longueû. Èt po fini, i r’ssètche 1i fiêr en 1′ fiant toûrner dè timps qu’ i tint 1′ pupe pa l’ tièsse è 1′ paume di si-ôte mwin.
Li mouleû arindje sès pupes dins dès grands batchs di bwès, hôts d’ one boune mwin, lès tièsses todi aspoyîyes conte lès grands costés. Po lès longuès pupes èt lès d’méyès longues, i gn-a dès batchs èsprès avou dès rôyes fêtes dins 1′ fond po-z-î coûtchî lès quèwes.
On côp qui l’ batch èst plin, l’ovrî l’ pwate su lès pirnèkes come nos l’ avans d’djà vèyu fé pa lès rôleûses.
Po one grosse di pupes finîyes, li mouleû dwèt mète 174 pupes è s’ batch : li surplus, c’ èst po lès mwêjes qu’ on pôreut trover en trimant ou en glaçant.
Avou on moule sins grand façon, on bon mouleû pout ariver à fé di 7 à 8 grosses su s’ djoûrnéye : po lès pupes pus malaujîyes, avou l’ tièsse ôrnéye ou on pèrsonâje, c’ è-st-à pwin.ne s’ il ariverè à ‘nnè fé d’ 3 à 4 grosses.
Èt tot ça po gangnî autoû d’ deûs francs èt d’méy, en travayant dès onze èt doze eûres par djoû.
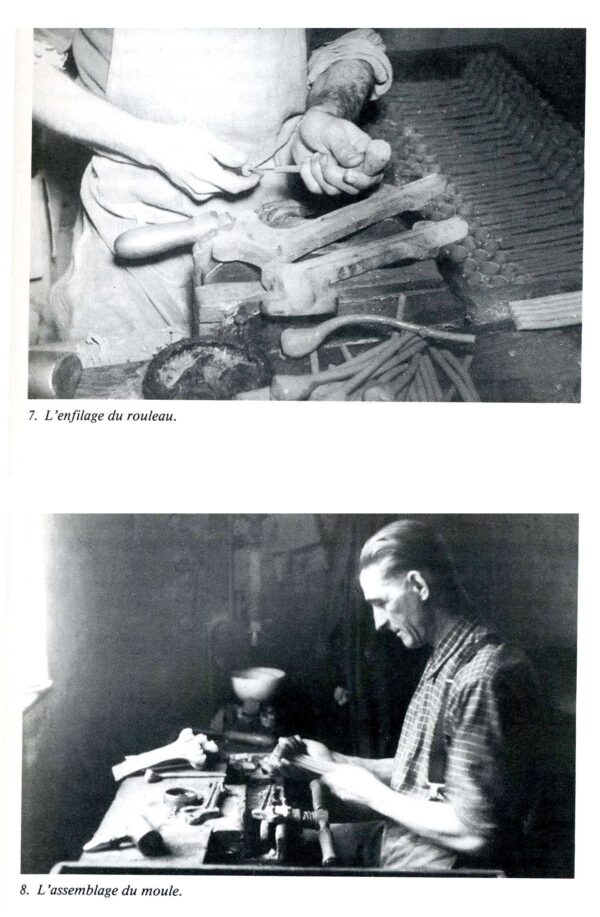
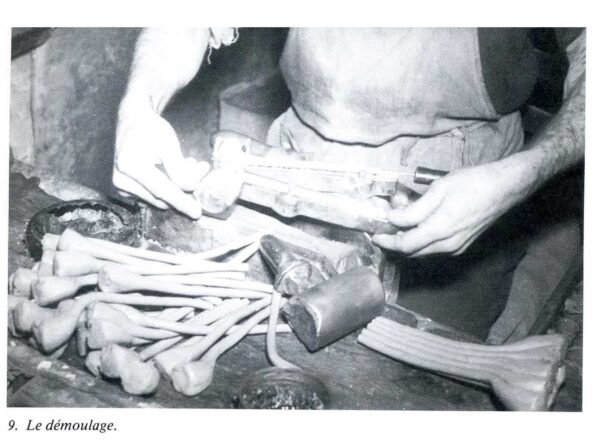
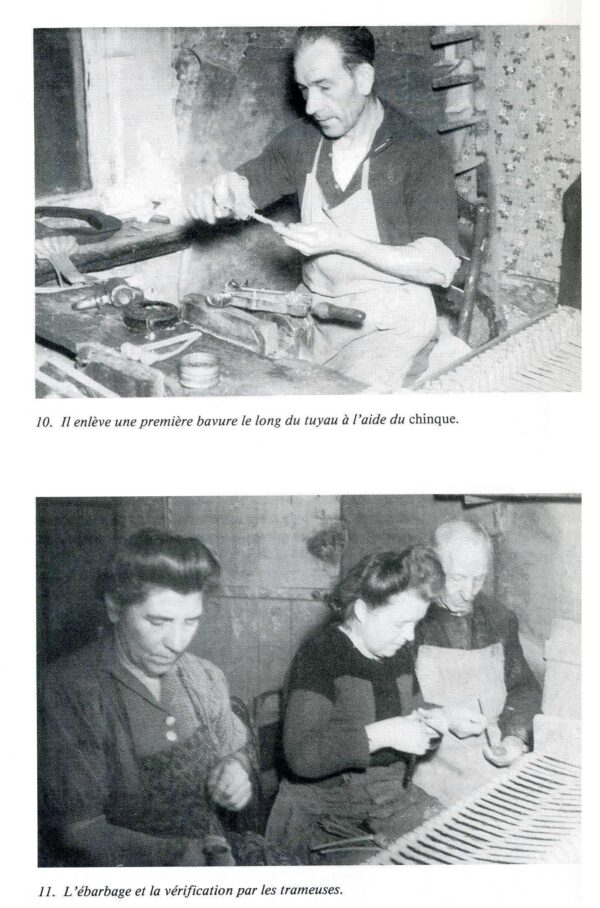
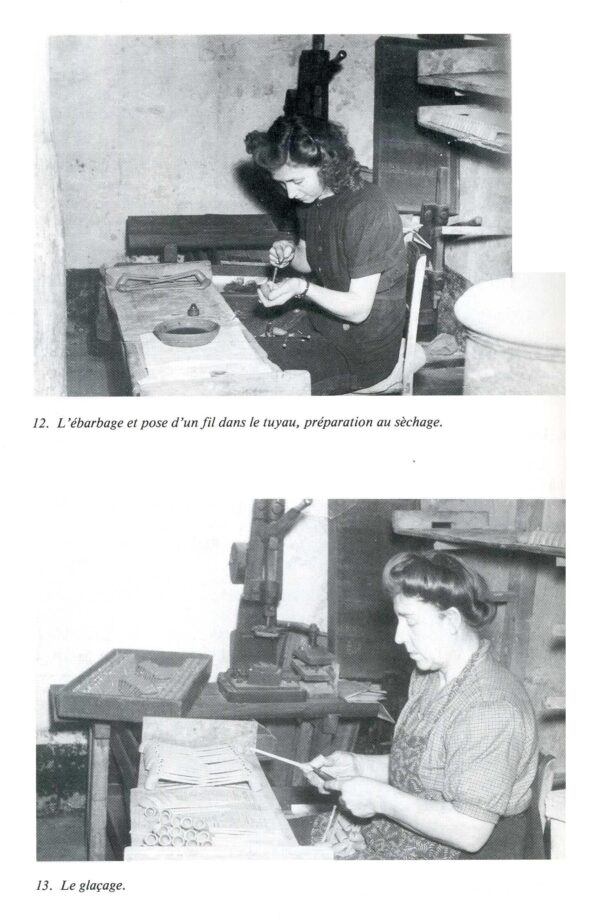

7 Li trimeûse
Quand lès pupes sont-st-à mitan souwéyes, one novèle ovrêre vint qwère lès batchs. C’ èst l’ trimeûse: c’ èst lèy qui va fé li prumère twèlète dè l’ pupe.
En-z-intrant dins l’ tièsse dè moule, li chtoupe a fêt brotchî l’ tère tot-autoû. Li trimeûse fout ç’ baveure-là djus d’ on côp d’ coutia. C’ èst ç’ qui s’ loume « côper l’ bonèt ». Èle rinètîye totes lès costeures avou one ostèye qu’ on loume li « chmoute ». C’ èst 1′ min.me jenre qui l’ chinke à paurt qui 1′ fi d’ ârca èst pus fwârt èt qu’ li d’méy rond èst fêt à l’ grocheû dè l’ tièsse d’ one pupe. Li trimeûse arondit adon come i faut li fornia en-z-î fiant toûrner one pitite fôrme di bwès qui fêt en min.me timps li bwârd plat ou bin arondi come i 1′ faut po l’ jenre di pupe. On loume ça « passer 1′ boton ». Divant dè l’ fé, l’ ovrêre dwèt trimper l’ bwârd dè fornia è l’ ôle, mins nos vîyès puperèsses avin.n pus vite fêt : èles li mouyin.n avou leû linwe !
Po r’nètî lès pupes qu’ ont dès-ôrnèmints, on portrêt, dès fleûrâjes, li trimeûse a one ôte ostèye qu’ on loume « li godron ».
O-z-a longtimps tchaufé lès fors avou dès grossès bwaches ; pus taurd, on-z-a c’mincî à s’ sièrvu d’ on craus tchèrbon qui brûle en d’nant dès longuès blames.
Lès-alandiés trawin.n à plin dins 1′ for, èt lès blames, après oyu lètchî èt èstchaufer lès pots, moussin.n foû pa li tch’minéye di d’zeû. À l’ copète di li tch’minéye, i gn-aveut on clapèt qu’ on fieûve djouwer di d’zos avou one tchin.ne.
Volà nosse for rimpli d’ pots jusqu’au d’zeû. Li cûjeû maçenéye li pwate avou dès brikes rèfractêres : i lêt à 1′ fine copète on vûde dè l’ grandeû d’ one brike; c’ èst ç’ qu’ on loume « li trau d’ vûwe », qu’ i stoperè après côp avou one brike mins sins 1′ macener.
I boute lès feus dins lès-alandiés avou dès moussâdes, pwis i c’mince à tchèrdjî tot doûce’mint, èt çola iût’ à dîj-eûres au long po qui 1′ for s’ èstchaufe p’tit-à-p’tit. Quand 1′ for èst bin tchôd, li cûjeû lêt r’toumer 1′ clapèt en n’ lèyant qu’ on passadje d’ one mwin èt i continûwe à tchèrdjî jusqu’à ç’ qui l’ for seûye divenu fin blanc, ci qu’ i pout veûy pa l’ trau d’ vûwe. Li tchaleûr divint todi pus fwate è quand 1′ for a roté insi quékes-eûres à plin feu, noste ome douve li trau d’ vûwe, èt i r’ssètche foû dè for avou on crotchèt one dès pupes qu’ il a mètu su l’ couviète d’ onk dès pots di d’zeû. Ossi vite qui 1′ pupe è-st-one miète rafrèdîye, li cûjeû l’ câsse avou sès dints po veûy s’ èlle èst cûte assez. S’ èle ni l’ èst nin co, i r’ssère li trau d’ vûwe èt au bout d’ on p’tit timps, i r’ssètche one deûzin.me pupe, èt min.me à fîye one trwèzin.me s’ i gn-a dandjî. Èt quand lès pupes sont cûtes à pwint, il arète dè tchèrdjî lès feus qui disclinèt adon tot doûcemint. À pwin.ne li for è-st-i assez rafrèdi qui po-z-î p’lu moussî, on dismacenéye li pwate èt on sôrt lès pots fêt-à-fêt qu’ iz rafrèdichèt.
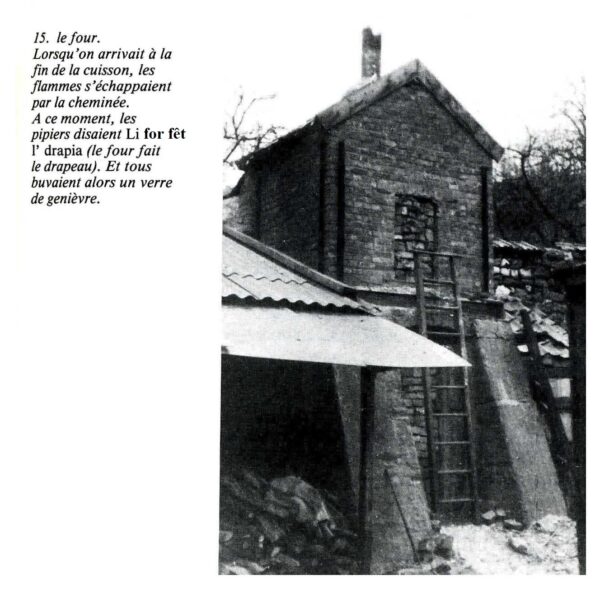
8 Li glaceûse
Li glaceûse travaye avou one ostèye d’ aci à deûs brantches qui fièt r’ssôrt, èt au d’dins di chake brantche, i gn-a one « pîre d’ agate ». L’ ovrêre polit tote li pupe à fond : èle dwèt iu 1′ mwin fwârt lèdjère, ça i n’ faut nin qui 1′ pîre lêye dès traces nune paut. Après-oyu poli lès pupes, èle lès-arindje su dès plantches pa pakèts d’ quinze. Èlle èpile lès plantches one dissus l’ ôte èt lès pupes, ci côp-ci, vont achèver dè souwer.
Quand lès pupes sont souwéyes à fond èt divenouwes blankes, on-ovrî (c’ èst l’ pus sovint li ci qui mine li for) lès-arindje dins dès pots. C’ èst dès-èspéces di batchs di tère rèfractêre, ronds ou à fîye cârés. On-z-èpile lès pots onk dissus l’ ôte è for : li ci di d’zeû èst stopé avou one couviète di tère bin frèche, dè l’ «barbotine», come on dit, po-z-èspêtchî qu’ lès blames n’ intrèche èt n’ brûlèche lès pupes.
On s’ siève sovint d’ pots cârés po cûre lès d’méyès longues : po lès cines avou lès pus grandès quèwes, lès longues, on r’toûne on pot su l’ ci qu’lès pupes sont drèssîyes didins, po rascouviè lès quèwes qui dèpassèt, èt on plake come i faut l’ djonteure avou dè l’ barbotine.
9 Li cûjeû
Vo-nos-ci arivé à l’ pus malaujîye pârtîye, li cûjadje. Li cûjeû l’ dwèt survèlier avou brâmint d’ l’ atincion po miner s’ for à bon.
Lès fors dè timps passés, on lès fieûve ronds ou bin cârés. Il èstin.n naturélemint gârnis d’ brikes rèfractêres pa d’dins èt on lès rèfwârcicheûve avou totes sôrts di fèrayes èt min.me avou dès sômîs.
Su li d’vant, li pwate, èt su lès costés, lès-alandiés avou dès pwates di fiêr, po tchèrdjî lès feus.
10 Nos pupîs et leûs cliyents
Mins tot n’ èst nin co fêt : lès pupes ni sont nin lîvréyes aus cliyents téles qu’ èles moussèt fou dè for. Li tère qu’ on lès fêt è-st-assez rèche èt èle colereut su lès lèpes. C’ èst po ça qu’ on lès passe dins on clér brouwèt fêt avou dè savon d’ Marsèye èt dè l’ blanke cire. C’ èst ç’ qu’ on loume « li trimpadje »: on lêt sgoter lès pupes pwis on lès frote avou one doûce pèce di flanèle.
Dj’ a d’visé pus hôt di blankes, di rodjes èt di nwârès pupes. Lès blankes èt lès rodjes, come dji l’ a dit, si fièt avou dès tères qu’ èlzî d’nèt cès coleûrs-là. On fêt lès nwâres avou 1′ min.me tère qui lès blankes, seûlemint on lès cût dins dès pots qu’ on rimplit avou dè l’ soyeûre di blanc-bwès.
Dès cliyents dimandin.n co bin qu’ leûs pupes sèyinche vèrnîyes. On mèt adon one coûtche di fin vèrnis avou on doûs pinçau èt on l’ sicût dins on cofe di tole avou on p’tit feu pa d’zos. Po-z-oyu li d’zeû dè fornia come brûlé, on fêt on bon feu d’zos one take di fiêr èt on mèt d’ssus l’ bwârd dè fornia en-aspoyant lès quèwes conte one baguète di fiêr po qu’ lès pupes ni toumèche nin. Po nwâri lès quèwes, on rascoûve li take avou on cofe d’ on bon pîd d’ hôt qu’ a dès ronds traus dins li d’zeû. On-z-î lêt d’chinde lès quèwes qui n’ taurdjèt wêre dè nwâri avou l’ tchaleûr dè l’ take.
I gn-a co dès-ôtes rafinemints. On-z-èmaliéye tos lès fleûrâjes èt lès garnitures d’ aus pupes ôrnéyes, lès pèrsonâjes ou tos lès sudjèts qu’ sont su lès tièsses ou su lès quèwes, avou dès vwèyantès coleûrs. On-z-a min.me fêt dins l’ timps dès mile èt dès mile di pupes qu’ avin.n’ on p’tit-encadrèmint su li d’vant dè fornia, èt on-z-î coleûve totes sôrts di p’titès-îmaudjes, èt min.me dès p’tits bokèts d’ murwè qu’ on-z-î fieûve tinre avou dè l’ plate.
Dès-ôtes modèles imitin.n lès pupes di deûs pèces, èt on dècoreûve en-ôr ou en-ârdjint one espéce di bague è 1′ place où-ce qui l’ touyau aveut l’ êr di s’ vinu èmantchî su l’ tièsse. Èt dji v’ va quétefîye èwarer en v’ dijant qu’ on trimpeûve co bin lès pupes, après qu’ èlle avin.n sitî cûtes, dins dè cru lècia nin cramé, pwis on lès fieûve passer è cofe. Çola l’zî d’neûve one bèle coleûr qui rapèleûve li clér bwès, èt l’s-amateûrs v’lin.n qu’ èlle èstin.n adon bin mèyeûses à fumer.
Vola ci qu’ c’ èsteut dè mèsti d’ pupî èt d’pup’rèsse dè timps passé. Èt tot s’ fieûve por insi dîre en famile. I n’ èsteut nin râre, aus-eûréyes, dè veûy on-ovrî moussî foû d’ one fabrike en pwartant su si spale one plantche avou on balot d’ tère ou bin on batch di pupes. C’ èsteut po one rôleûse ou bin one trimeûse qui n’ savin.n vinu travayî tot-on momint. En r’passant, l’ ome ripurdeûve one plantche di roles ou bin on batch di pupes triméyes. Èt insi, li comére qu’ aveut on racro èt qui d’veûve dimorer è s’ maujo ni pièrdeûve nin tote si djoûrnéye, qu’ èsteut d’djà si p’tite sins ça.
Lès mêsses pupîs mètin.n tot djon.nes leûs-èfants à l’ ovradje. Is d’nin.n aus gamins on p’tit moule aujîye èt is d’vin.n fé on té nombe di grosses po leû « payèle ». Si l’ èfant èsteut djinti, i travayeûve po fé one grosse ou deûs d’pus su s’ quinzin.ne èt 1′ papa l’zî payeûve adon come aus-ovrîs.
On-z-èbaleûve sovint lès pupes dins dès blankès banses d’ osère : on rascouvieûve li banse avou on bokèt d’ calicot qu’ on coseûve tot-autoû.
Po lès pupes qui d’vin.n ènn’ aler à l’ ètranjér, on s’ sièrveûve di kêsses èt on-z-î èbaleûve lès pupes dins dè l’ paye d’ awin.ne.
Il ariveûve qui lès mêsses-pupîs n’ trêtin.n nin dîrèctèmint avou lès cliyents dès payis d’ au lon. Cès-ci avin.n on-ome mètu è nosse payis po r’çûre totes lès martchandîyes qu’ il achetin.n par ci èt lès fé ariver au batia à Anvèrs’. C’ è-st-insi qu’ èmon Gaspard, onk dès fis mineûve on côp ou deûs su l’ mwès on grand tchaur di pupes à Lovin, à on-ome qu’ èsteut tchèrdjî di lès fé parvinu à l’ètranjér.
Il aleûve ossi avou s’ tchaur dins lès-Ârdènes èt min.me èmon lès Flaminds.
(p.116) On n’ fêt naturélemint nin tant d’ façon po lès pupes po lès tirs, « lès bokèts » : on n’ èlzî côpe qui 1′ bonèt èt l’ trimeûse si continte di lès chinker avou s’ dwèt. On côp qui 1′ pupe èst bin r’nètîye, li trimeûse tchoûke on fiêr è l’ quèwe po qu’ èle ni s’ kitape nin en-z-achèvant dè souwer. On n’ mèt nu fiêr po lès longues pupes èt lès d’méyès longues, mins on côp qu’ èles sont tortotes arindjîyes dins lès rôyes dè batch, on mèt dès « blos » su lès quèwes po qu’ èles dimèrèche bin drwètes. C’ èst dès bokèts d’ cârés bwès avou onk dès corons côpés à chuflèt èt qu’ on mèt insi aujîyemint à stok onk di l’ ôte sins risker di d’grèter l’ martchandîye.
Li trimeûse arindje lès pupes su dès plantches bin rabotéyes, qu’ ont deûs p’tits triviès su li d’zeû po lès p’lu èpiler one su l’ ôte. Lès pupes continuwèt d’ î souwer jusqu’à ç’ qu’ èles div’nèche à mitan deures, ou come on dit « souwéyes vètes mins nin blankes ».
(p.119) Gn-aveut co bin dès martchands qui v’nin.n qwére one tchèdje di pupes avou one atèléye : il arivin.n aviè 1′ sîse èt is passin.n li nêt dins on cina po r’paurti l’ lèdemwin à 1′ pikète dè djoû.
Nos-avin.n ossi è viyadje on-ome qui n’ fieûve qui dè tchèrî aus pupes avou on-atèléye di tchins dins tos lès-alentoûrs. Totes lès djins di mi-âdje si rapèlèt co di Manedaye èt d’ sès tchins.
Gn-aveut min.me on p’tit martchand d’ Alos’, qu’ on loumeûve vêci « Pière li Flamind» : i v’neûve après saqwants samwin.nes d’ Alos’ à An.nenale à pîd, avou dès gros sabots èt avou one tchèdje d’ agnons ou d’ gros cabus su one bèrwète ! I vindeûve si martchandîye aus pupîs pwis i r’gangneûve si payis avou one kêsse di pupes. C’ è-st-à nè l’ nin crwère !
(p.120) Nos pipiers au travail
Traduction et Notes Jean Fraikin
1 Les fabriques de pipes
II faut déjà remonter loin dans le temps pour trouver quand on a commencé à faire des pipes de terre à Andenelle. Toujours est-il que, il n’y a pas loin de 200 ans, il y avait déjà un fabricant de pipes au rivage. (1) Il provenait d’Allemagne (2), comme d’ailleurs ceux qui sont venus, mais beaucoup plus tard, installer des piperies à Chokier (3), au pays de Liège, et dans le Limbourg, à Bree (4), un petit village à la frontière de la Hollande.
- Tombu ignore l’existence de Pierre Menicken qui fut le premier pipier d’Andenne où il vint s’installer, au plus tôt, en 1757 ; cfr J. fraikin, La fabrication delapipeen terre, Liège, 1978, p. 5.
- Pipiers de Wallonie, dans Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, t. XIV (n. 165-168), 1977-1978, pp. 269-271.
- Pierre Hörter ou Hoerter dont l’atelier commença à fonctionner dès 1768, était originaire de Höhr-lez-Coblence ; cfr J. fraikin, Pipiers de Wallonie, p. 271.
- Jacques Knoedgen y fonda une fabrique en 1834; cf. op. , p. 293.
(p.121) Le fils qui avait poursuivi les affaires de son père, se nommait Peter, comme lui. Mais Peter, ça sonnait mal aux oreilles de nos vieux parents ; ce n’était pas un nom wallon, cela ! Aussi l’avait-on rebaptisé et Peter était devenu Pierre ; mais comme il lui fallait un surnom comme tout le monde en avait un de ce temps-là, on ne l’appelait jamais autrement que le « Pète », c’était chez le « Pète ». Le « Pète » habitait au rivage, à mi-chemin en allant vers la rue Chairotte. Sa piperie était derrière sa maison, dans les jardins du côté de la ruelle des Baudets.
A partir de ce moment-là, d’autres fabriques de pipes se sont ouvertes, principalement au rivage et « sur le ruisseau ». Plusieurs se sont installées aussi à Andenne.
Nos premières piperies n’étaient que de petits ateliers, où le maître travaillait avec ses enfants et quelques ouvriers qu’il avait recrutés à droite et à gauche. Ce n’était guère des fabriques comme on en voit aujourd’hui, loin de là ! Un petit trou pour battre la terre, deux, trois pièces pour les ouvriers et les ouvrières, mouleurs, râleuses, trimeuses et glaceuses, une autre pièce pour emballer les pipes, et un peu plus loin, le four avec un appentis pour les terres, et voilà la piperie de jadis. Il n’y avait pas de machine pour travailler les terres, pas de presse ni aucun de tous les engins dont on se sert aujourd’hui. Pour les fours, c’était aussi tout ce qu’il y avait de plus simple, et on ne connaissait pas de ce temps-là les fours « à flamme renversée » comme on dit aujourd’hui. Les petits maîtres pipiers auraient eu du mal à s’enrichir. Ils vivotaient mais ils tenaient à leur métier. Tous leurs ouvriers aussi d’ailleurs, et pourtant eux non plus ne gagnaient pas lourd.
Avec le temps, des pipiers avaient agrandi un peu leurs premiers ateliers et ils s’étaient étendus petit à petit. Au lieu des cinq ou six ouvriers du début, des fabriques étaient arrivées à en avoir vingt ou trente, et plus tard il y en eut même, à /’ Baye (5) comme on disait, qui en avait près de cent cinquante. On peut dire que, il y a trois quarts de siècle, il pouvait y avoir deux cents à deux cent cinquante ouvriers et ouvrières dans les piperies d’Andenelle.
Le métier de pipier n’était pas ce qu’on pourrait appeler un dur métier. Mais si le travail n’était pas des plus difficiles, du moins pour les pipes unies, il fallait être fort habile de ses mains et travailler proprement : les « bousilleurs » n’auraient jamais pu faire grand-chose de bon.
Les pipes se font avec de la terre comme on en tire, depuis des centaines d’années, dans beaucoup de villages des alentours, à Coulisse, Bonneville, Groyne, Mozèt, etc.
- Vers 1848, J.-J. Knoedgen de Hôhr installe un atelier qui, plus tard, dans le premier quart du xxe siècle, sera repris par Hillen; cfr J. fraikin, Pipiers de Belgique, dans La Vie Wallonne, t. LIV, 1980, pp. 306-307.
- A la Rampe: la fabrique de Désiré Barth était ainsi dénommée parce qu’on y pénétrait en montant un escalier dont la rampe était en fer forgé.
(p.122) 2 La derle
La derle de la région d’Andenne, qui convient pour les pipes, est blanche quand elles est cuite. Les pipes rouges étaient faites avec de la terre fine que les maîtres pipiers recevaient d’Allemagne, et qui devenait d’un beau rouge à la cuisson. (6)
Les terres sont grasses ou maigres. C’est au maître pipier à trouver ce qui lui convient le mieux et à faire les mélanges qu’il faut pour arriver à obtenir une terre qui se travaille facilement, sans se fendre et sans bouger au four.
Nos anciennes piperies ne faisaient pour ainsi dire que les pipes pour fumer : on ne connaissait guère qu’elles dans le temps et elles étaient à la mode dans pour ainsi dire tous les pays.
Quelques ateliers travaillaient aussi pour les tirs forains : on nommait cela fé dès hoquets (7). Les pipes pour les tirs ne demandaient guère autant de façon que les autres, comme nous le verrons plus loin.
Il y avait des centaines de modèles de pipes différents. Les maîtres pipiers faisaient toujours de nouveaux moules, vraiment à l’envi. Les pipes les plus
- La terre de Cologne ou plus exactement de Vallendar.
- Littéralement faire des morceaux. Les déchets des pipes à fumer étaient appelés des hoquets et on les conservait pour les vendre aux forains qui passaient régulièrement dans les ateliers.
(p.123) courantes, c’était les unies (8) ; d’autres, qu’on appelait les décorées, étaient couvertes d’ornements, de fleurs, ou bien elles représentaient des bêtes ou toutes sortes de choses, et même fort souvent des grands personnages : on leur donnait alors un nom d’après ce qu’elles représentaient.
Chaque pays, chaque contrée, peut-on dire, avait ses modèles préférés. Ici, il ne fallait que des pipes vernies, autre part, c’étaient des pipes tirant sur le jaune, des rouges ou même des noires.
Il y avait aussi des pipes avec de petits tuyaux, les « courtes »; d’autres avaient le tuyau long ou demi-long, et une longue pipe, « La Montoise », par exemple, avait un tuyau qui ne mesurait pas loin de deux pieds.
On faisait aussi des têtes qui s’adaptaient sur un tuyau d’une autre matière, comme le bois de merisier ou bien le jonc, avec un bout d’ambre ou de corne et même, parfois, d’écume. Qui n’a pas connu « Le vieux Jacob » que nos pipe-ries ont vendu par centaines de mille dans tous les coins du pays et à l’étranger !
3 Le maître pipier
J’ai dit un peu plus haut qu’on ne trouvait de machines d’aucune sorte dans nos vieilles piperies. Tout s’y faisait à la main, aussi l’ouvrage y était-il beaucoup plus remarquable que tout ce qu’on peut faire aujourd’hui.
Nous allons, si vous le voulez bien, décrire brièvement le vieux métier de pipier et voir ensemble comment cela marchait dans nos fabriques du temps passé.
Le maître pipier est allé faire un tour aux fosses. Pour cette fois, il s’est rendu à la Trîche-aus-pèkèts (9). Il a choisi tout ce qu’il y avait de meilleur, après s’être assuré que les terres n’étaient pas trop sablonneuses, en mordillant entre ses dents un petit morceau qu’il a gratté hors d’un bloc avec son ongle. Comme la plus fine est trop grasse, il en a demandé un troisième chariot, plus maigre, mais toujours de première qualité, pour pouvoir la mélanger avec l’autre.
Les chariots de terre, comme on en rencontre encore beaucoup aujourd’hui, roulaient alors du matin au soir tout au long de nos chemins. Il ne fallait pas seulement de la terre pour les piperies, les fabriques de faïences d’Andenne en utilisaient beaucoup aussi et on en envoyait énormément en Hollande. Les chariots prenaient de fortes charges, jusqu’à cinq et six mille kilos, et comme les abords des fosses n’étaient jamais des plus aisés, il fallait parfois atteler trois, quatre, et même cinq chevaux.
(8) Pipes simples sans dessin ni inscription.
(9) Lieu-dit situé à Groynne, à l’ouest d’Andenne. Un des plus grands et des meilleurs gisements de terre plastique. La plupart des terres utilisées dans les piperies provenaient de cette exploitation de la Prairie aux Genévriers.
(p.124) Quelques jours après que le maître soit allé à la fosse, le premier chariot arrive à la fabrique. Le batteur de terre est déjà d’un certain âge et il faut pourtant décharger au plus vite. Il va entrouvrir les portes des ateliers en criant: « II y a un chariot ! ». Aussitôt, trois ou quatre hommes se lèvent pour aller lui donner un coup de main. Ils portent les blocs sous un appentis, situé le plus souvent à côté du four, et sommairement couvert pour garantir les terres de la pluie. Elles pourront y sécher tout doucement avec les courants d’air et la chaleur du four quand on cuira.
4 Le batteur
A mesure que la terre sèche, on casse les blocs en petits morceaux et on les jette dans une grande fosse de deux fers de bêche de profondeur : la terre va demeurer là des semaines durant, elle y pourrira et y « remûrira » (10) disent les pipiers.
C’est là que le batteur de terre vient chercher ce qu’il lui faut, dans un bac de bois. La terre est devenue souple, elle a plus de corps et elle se travaille plus facilement.
Le batteur vide ses bacs sur un banc allongé, et quand il en a recouvert toute la longueur, il la coupe en tranches avec un outil de fer, la plane. Quand il est arrivé au bout du tas, il recoupe toutes les tranches, qui sont tombées l’une sur l’autre en commençant par où il vient de finir, et il recommence le
(10) Remûrir ou jeter son feu.
(p.125) même manège une troisième fois. Mais il faut que la terre soit hachée menu le plus possible et qu’il n’y demeure pas une seule petite motte. Il faut aussi que les mottes grasses soient bien mélangées avec les plus maigres. Le batteur coupe alors le tas en petits ballots qu’il change de place une fois ou deux en les mélangeant bien l’un avec l’autre, et il recoupe chaque fois le tas en tranches avec la plane. Ça n’est pas encore assez : il refait encore une fois ou deux des petits ballots, les tourne complètement ou leur fait faire un demi-tour pour être bien sûr qu’il n’y a rien qui n’ait pas été coupé et recoupé par la plane. Pour finir, l’ouvrier partage le tas en plus gros ballots avec le fil (c’est un morceau de fil de fer fin avec une poignée de bois à chaque extrémité), il jette et il rejette chaque ballot de toutes ses forces sur son banc pour le rendre plus ou moins carré et pour tasser convenablement la terre.
Et voilà la matière prête pour les râleuses.
5 Les rouleuses
Le travail de la pipe commence chez la rouleuse.
La voilà assise à son banc, après s’être bien installée. Sur le côté gauche de la table (la jeune fille est droitière), il y a un gros ballot de terre. Elle a devant les yeux le moule sur lequel son père va travailler, et en le lui remettant, il lui a dit combien de grosses (11) de rouleaux elle devait faire.
(11) Partout la grosse est de douze douzaines à l’exception de la Hollande où elle compte quatorze douzaines.
(p.126) Elle saisit une poignée de terre, avec sa main gauche, et elle la fait rouler d’avant en arrière, en lui laissant une grosseur à un des bouts, pour la tête de la pipe, et en amincissant le reste qui doit devenir la queue. Tout d’un coup, le rouleau, qui n’est encore qu’ébauché, passe de la main gauche à la main droite, et la rouleuse saisit une deuxième poignée de terre. Elle roule maintenant aves ses deux mains, la droite achève le rouleau que la gauche a ébauché.
Et de temps en temps la rouleuse présente le rouleau devant le moule pour voir si le tuyau est bien à la longueur et à la grosseur requises. Quand elle a fait un paquet ou deux de rouleaux, elle n’a plus besoin de moule pour se guider; elle a «les mesures dans l’œil». Mais avant de le remettre au mouleur, elle a pourtant soin de faire une marque sur son banc pour pouvoir vérifier de temps en temps si elle travaille toujours correctement.
Au fur et à mesure que les rouleaux sont faits, la rouleuse les met sur une autre planche qui est à côté. Elle fait passer à sa main droite le rouleau commencé par l’autre et elle reprend aussitôt une nouvelle poignée de terre. Et l’ouvrage continue de cette manière toute la journée.
La rouleuse met sur chaque planche douze paquets de quinze rouleaux, ce qui fait cent quatre-vingts rouleaux pour arriver à une grosse de douze douzaines de pipes finies. La différence, c’est pour les déchets. Chaque paquet a une rangée de six rouleaux, puis une de cinq et au-dessus une de quatre. Les paquets sont mis sur la planche, les têtes vers l’extérieur, un à droite puis un à gauche et ainsi de suite.
Une bonne rouleuse peut arriver à faire quatorze à quinze planches sur la journée, ce qui fait environ deux mille sept cents rouleaux. Ça vous donne à penser les mille et mille fois qu’elle doit faire aller ses bras pour gagner ses quelques sous, exactement sept centimes et demi pour deux grosses.
Il y a tout autour de l’atelier des montants de bois cloués au mur, avec de longues broches enfoncées dedans depuis le haut jusqu’en bas : c’est ce qu’on nomme les pirnèkes. C’est là-dessus que la rouleuse met ses planches et les rouleaux y vont sécher tout doucement un jour ou deux.
Quand l’ouvrage presse et que le mouleur attend les rouleaux, la rouleuse ne fait ses paquets que de deux rangées, une de cinq et une de quatre, pour que les rouleaux sèchent plus vite. Mais au lieu de quinze paquets, c’est vingt qu’elle doit mettre alors sur la planche.
Rouler, c’est pour ainsi dire un ouvrage de femme. Pourtant, il y a déjà eu des mouleurs qui faisaient leurs rouleaux eux-mêmes. Ainsi, A l’Baye, à l’époque dont je vous parle, il y avait deux mouleurs qui étaient dans le cas, Jean le petit borgne et le vieux Bodok. C’était deux vieux célibataires qui faisaient leur petit fricot à la fabrique et qui avaient même leur paillasse dans un des bâtiments.
(p.127) La rouleuse n’a plus à s’occuper des rouleaux une fois qu’ils sont sur les planches ; c’est le mouleur qui doit veiller au séchage. S’il voit que ceux de la rangée du haut sèchent trop vite, il retournera le paquet. Il arrive même qu’il doive mouiller avec ses doigts la rangée du dessus et même celle du dessous qui repose sur la planche, car elles sèchent beaucoup plus vite que celle du milieu.
6 Le mouleur
Un mouleur se lève de son banc. Il porte le bac de pipes qu’il vient de finir de sécher et il revient à son banc avec une planche de rouleaux. Quoiqu’il y ait été attentif, il y a quelques paquets qui sont vraiment trop sèches. Il les dresse, les tuyaux en haut, dans une petite cuve d’eau pour les mouiller. Nos vieux pipiers prétendaient que c’était avec ces rouleaux-là qu’on faisait les plus belles pipes et qu’elles étaient plus résistantes.
Jetons un petit coup d’oeil sur le banc.
Sur le devant, voici l’étau avec une vis pour presser le moule. Les mouleurs garnissent, d’après l’épaisseur du moule, les deux côtés de l’étau avec des planchettes et des feuilles de carton pour que cela fasse ressort et que lorsque l’étau est serré à fond, la poignée de la vis demeure à plat à hauteur de leurs genoux. Ils tiennent alors la poignée calée avec un de leurs genoux qui est protégé au moyen d’un morceau de cuir, la genouillère. Quand la pipe est chtoupéye (12), ils retirent la jambe qui retenait la poignée et la vis se desserre d’elle-même.
(12) Le fourneau ou tête de la pipe est creusé à l’aide du chtoup ou étampon.
(p.128) Le moule est ouvert sur le banc. C’en est un de pipe ordinaire et il n’est que de deux pièces qui s’assemblent avec des clous. Quand la tête est ornée, le « Jacob » par exemple, le moule est de trois pièces dont la troisième, qui fait le devant de la tête, vient s’ajuster sur les deux autres avec des clous. Les moules se font d’habitude en fonte, mais les plus compliqués sont en cuivre, qui est plus facile à travailler et à ciseler.
A côté du moule, il y a le chtoup. C’est un morceau de fer de la forme que doit avoir le fourneau de la pipe à l’intérieur. II est emmanché sur une poignée de bois dur dont les deux extrémités sont évidées et remplies de plomb pour rendre le chtoup plus lourd. Voici maintenant le « fer pour enfiler les rouleaux », qui n’est qu’un morceau de fil de fer monté sur un petit manche de bois. Le fer est un petit peu recourbé à l’extrémité ; c’est ce qu’on appelle la « mouche ». Pour pouvoir retirer aisément le fer hors du tuyau du rouleau, il faut qu’il soit rayé. Pour rayer un nouveau fer, l’ouvrier le met sur son genou, garanti par la genouillère, et il le fait tourner tout en le faisant avancer, tandis qu’avec son autre main, il appuie dessus la lame d’un vieux couteau qui a encore un bon taillant.
Sur le banc, il y a encore un petit outil fait avec un morceau de gros fil de fer avec, à l’extrémité, un demi-rond de la grosseur d’un tuyau de pipe. C’est le chinque, qui sert à rabattre les coutures du tuyau. Dans le manche du chinque, il y a comme une lame de couteau, qui ne dépasse que d’un demi-centimètre. C’est avec cela que le mouleur coupe le tuyau à la longueur qu’il doit avoir, après l’avoir « chinqué ».
(p.130) Vous voyez encore un petit bac rond en tôle, d’un doigt de haut (ce n’est bien souvent qu’un couvercle de boîte). C’est lepotet (petit pot) : il est rempli de coton de lampe à huile qui baigne dans un mélange d’huile de colza et de pétrole. Le mouleur y trempe le chtoupe et le fer avant de s’en servir. Il y trempe aussi ses doigts pour frotter les rouleaux d’un même paquet quand il les a décollés l’un de l’autre, et parfois pour graisser le moule quand les rouleaux sont un peu humides et que la terre voudrait y adhérer.
Maintenant que nous connaissons les outils, nous pourrions regarder notre vieux Jean faire deux ou trois pipes.
Pour commencer, il décolle l’un de l’autre les rouleaux de cinq ou six paquets et il les frotte avec ses doigts qu’il a trempés dans le petit pot. Comme il fait fort chaud, il laisse les rouleaux à plat sur la planche et il les recouvre avec un linge mouillé pour qu’ils demeurent humides. Cela fait, il prend un rouleau et, presque sans qu’on s’en aperçoive, il a arraché avec un doigt et le pouce un petit morceau de terre de la tête que les rouleuses font d’habitudes un peu forte. Après avoir enfilé le tuyau, il met le rouleau dans une moitié du moule, assemble les deux pièces et il le laisse tomber dans l’étau. Il donne un tour de vis, retient la poignée avec son genou et voilà le moule serré à fond. Il prend le chtoup, trempe le bout dans le petit pot et l’enfonce dans le fourneau en donnant deux ou trois bons coups jusqu’à ce qu’il soit entré au ras d’une bague qui est mise juste à hauteur du fourneau. Pendant qu’il tient le chtoup à fond, le mouleur fait avancer le fer jusqu’au bout, puis il retire le chtoup hors du moule. Il bouge la jambe qui retenait la poignée de la vis, celle-ci se détourne et l’étau s’ouvre largement. Le mouleur met le moule sur le banc et après l’avoir ouvert, il retire la pipe en la tenant d’un côté par le manche de fer et de l’autre avec son petit doigt qu’il a poussé dans le fourneau. Le pipier rabat alors les coutures du tuyau d’un coup de chinque en tenant la pipe emmanchée sur le fer et il en coupe le bout pour la mettre à bonne longueur. Et pour finir, il retire le fer en le faisant tourner pendant qu’il tient la pipe par le fourneau dans la paume de l’autre main.
Le mouleur arrange ses pipes dans de grands bacs de bois, hauts d’une bonne main, les fourneaux toujours appuyés contre les grands côtés. Pour les longues pipes et les demi-longues, il y a des bacs appropriés avec des rainures dans le fond pour y coucher les tuyaux.
Une fois que le bac est rempli, l’ouvrier le porte sur les pirnèkes comme nous l’avons déjà vu faire par les rouleuses.
Pour une grosse de pipes fines, les mouleur doit mettre 174 pipes dans son bac : le surplus, c’est pour les mauvaises pipes qu’on pourrait trouver quand on «trime» ou on glace.
(p.131) Avec un moule simple, un bon mouleur peut arriver à faire de 7 à 8 grosses sur la journée ; pour les pipes plus compliquées, avec le fourneau orné ou un personnage, c’est à peine s’il arrivera à en faire 3 à 4 grosses.
Et tout ça pour gagner aux environs de deux francs cinquante en travaillant onze et douze heures par jour.
7 La trimeuse
Quand les pipes sont à moitié séchées, une nouvelle ouvrière vient chercher les bacs. C’est la trimeuse ; c’est elle qui va faire la première toilette de la pipe.
En creusant le fourneau dans le moule, le chtoup a fait jaillir la terre tout autour. La trimeuse enlève cette bavure-là d’un coup de couteau. C’est ce qui s’appelle couper le bonnet. Elle nettoie toutes les coutures avec un outil qu’on nomme le chmoud. C’est le même genre que le chinque sauf que le fil de fer est plus solide et que le demi-rond est fait à la grosseur du fourneau d’une pipe. La trimeuse arrondit alors comme il faut le fourneau en y faisant tourner une petite forme de bois qui rend en même temps le bord plat ou bien arrondi selon le genre de pipe. On appelle ça passer le bouton. Avant d’y procéder, l’ouvrière doit tremper le bord du fourneau dans l’huile, mais nos vieilles pipières avaient plus vite fait : elles le mouillaient avec leur langue !
(p.133) Pour nettoyer les pipes qui ont des ornements, un portrait, des fleurs, la trimeuse a un autre outil qu’on nomme le gedron (“).
On ne se donne naturellement pas tant d’embarras pour les pipes de tirs, « les morceaux » ; on ne leur coupe que le « bonnet » et la trimeuse se contente de les ébarber avec son doigt.
Une fois que la pipe est bien nettoyée, la trimeuse pousse un fer dans le tuyau pour qu’il ne se déforme pas en achevant de sécher. On ne met pas de fer pour les longues pipes et les demi-longues, mais, une fois qu’elles sont toutes arrangées dans les rainures du bac, on met des blocs sur les tuyaux pour qu’ils demeurent bien droits. Ce sont des morceaux de bois carrés dont l’un des bouts est coupé en biseau et qu’on met ainsi facilement l’un contre l’autre sans risquer de griffer la marchandise.
La trimeuse arrange les pipes sur des planches bien rabotées qui ont deux petites traverses sur le dessus pour pouvoir les empiler l’une sur l’autre. Les pipes continuent d’y sécher jusqu’à ce qu’elles deviennent à moitié dures, ou comme on dit «séchées vertes mais non blanches».
- La glaceuse
La glaceuse travaille avec un outil d’acier à deux branches faisant ressort, et à l’intérieur de chaque branche, il y a une « pierre d’agate ». L’ouvrière polit la pipe à fond : elle doit avoir la main fort légère, car il ne faut pas que la pierre laisse de trace nulle part. Après avoir poli les pipes, elle les dispose sur des planches par paquets de quinze. Elle empile les planches l’une sur l’autre et les pipes vont cette fois-ci, achever de sécher tout à fait.
Quand les pipes sont séchées complètement et devenues blanches, un ouvrier (c’est le plus souvent celui qui s’occupe du four) les range dans des pots. Ce sont des espèces de bacs de terre réfractaire, ronds ou parfois carrés. On empile les pots l’un sur l’autre dans le four : celui du dessus est fermé avec un couvercle de terre réfractaire après que le bord du pot ait été garni avec un cordon de terre bien humide, de la barbotine, comme on dit, pour empêcher que les flammes n’entrent et ne brûlent les pipes.
On se sert souvent de pots carrés pour cuire les demi-longues : pour celles qui ont les plus grands tuyaux, les longues, on retourne un pot sur celui dans lequel les pipes sont dressées, pour recouvrir les tuyaux qui dépassent, et on colle comme il faut la jointure avec de la barbotine.
(13) Le godron reste un instrument inconnu et n’est signalé que par A. Tombu.
(p.135) 9. Le cuiseur
Nous voici arrivés à la partie la plus délicate, la cuisson. Le cuiseur doit la surveiller avec beaucoup d’attention pour bien la réussir.
Disons d’abord un mot des fours du temps passé. On les faisait ronds ou bien carrés. Ils étaient naturellement garnis de briques réfractaires à l’intérieur et on les renforçait avec toutes sortes de ferrailles et même avec des poutres. Sur le devant, la porte, et sur les côtés, les alandiers, avec des portes de fer, pour charger les feux.
On a longtemps chauffé les fours avec de grosses bûches; plus tard, on a commencé à se servir d’un charbon gras qui brûle en donnant de longues flammes.
Les alandiers trouaient la paroi du four, et les flammes après avoir léché et échauffé les pots, sortaient par la cheminée du haut. Au sommet de la cheminée, il y avait un clapet qu’on actionnait d’en bas avec une chaîne.
Voilà notre four rempli de pots jusqu’au-dessus. Le cuiseur maçonne la porte avec des briques réfractaires ; il laisse tout au-dessus un vide de la grandeur d’une brique; c’est ce qu’on appelle «le trou de vue», qu’il bouchera après coup avec une brique mais sans la maçonner.
Il boute le feu dans les alandiers avec des bourrées, puis il commence à charger tout doucement, et cela pendant huit à dix heures pour que le four s’échauffe petit à petit. Quand le four est bien chaud, le cuiseur laisse retomber (p.136) le clapet en ne laissant qu’un passage d’une main et il continue à charger jusqu’à ce que le four soit devenu tout à fait blanc, ce qu’il peut voir par le trou de vue. La chaleur devient toujours plus forte et quand le four a marché ainsi quelques heures à plein feu, notre homme ouvre le trou de vue, et il retire du four avec un crochet une des pipes qu’il a mises sur le couvercle d’un des pots du haut. Aussitôt que la pipe est un peu refroidie, le cuiseur la casse avec ses dents pour voir si elle est suffisamment cuite. Si elle ne l’est pas encore, il referme le trou de vue et au bout d’un petit moment, il retire une deuxième pipe, et même parfois une troisième si c’est nécessaire. Et quand les pipes sont cuites à point, il arrête de charger les feux qui déclinent alors tout doucement. A peine le four est-il assez refroidi pour qu’on puisse y entrer, on démaçonne la porte et on sort les pots au fur et à mesure qu’ils refroidissent.
D’après le nombre d’heures que le four doit marcher, vous avez compris qu’il faut parfois que le cuiseur passe la nuit.
- Nos pipiers et leurs clients
Mais tout n’est pas encore fait : les pipes ne sont pas livrées aux clients telles qu’elles sortent du four. La terre dont elles sont faites est assez rugueuse et elle collerait aux lèvres. C’est pour ça qu’on les passe dans un bain clair fait de savon de Marseille et de cire blanche. C’est ce qu’on appelle le trempage : on laisse égoutter les pipes puis on les frotte avec une pièce de flanelle douce.
J’ai parlé plus haut de pipes blanches, rouges et noires. Les blanches et les rouges, comme je l’ai dit, se font avec des terres qui leur donnent ces couleurs-là. On fait les noires avec la même terre que les blanches, seulement on les cuit dans des pots qu’on remplit de sciure de bois blanc.
Des clients demandaient parfois que leurs pipes soient vernies. On met alors une couche de vernis fin avec un pinceau doux et on cuit la pipe dans un coffre de tôle avec un petit feu par dessous. Pour obtenir le dessus du fourneau comme brûlé, on fait un bon feu en dessous d’une plaque de fer et on met dessus le bord du fourneau en appuyant les tuyaux contre une baguette de fer pour que les pipes ne tombent pas. Pour noircir les tuyaux, on recouvre la plaque avec un coffre d’un bon pied de haut ayant des trous ronds dans la partie supérieure. On y laisse descendre les tuyaux qui ne tardent guère à noircir sous l’action de la chaleur de la plaque.
Il y a encore d’autres raffinements. On émaille tous les fleurages et les garnitures des pipes ornées, les personnages ou tous les sujets qui sont sur les fourneaux ou sur les tuyaux, avec des couleurs voyantes. On a même fait dans le temps des milliers et des milliers de pipes qui avaient un petit encadrement sur le devant du fourneau, et on y collait toutes sortes de petites images, et même de petits morceaux de miroir qu’on y faisait tenir avec du plâtre.
(p.137) D’autres modèles imitaient les pipes composées de deux pièces(14) et on décorait d’or ou d’argent une espèce de bague placée à l’endroit où le tuyau semblait venir s’emmancher sur le fourneau. Et je vais peut-être vous étonner en vous disant qu’il arrivait qu’on trempe encore bien les pipes, après qu’elles aient été cuites, dans du lait cru non écrémé, puis on les faisait passer dans le coffre. Cela leur donnait une belle couleur qui rappelait le bois clair, et les amateurs assuraient qu’elles étaient alors bien meilleures à fumer.
- Pour en finir avec le chapitre
Voilà ce qu’il en était du métier de pipier et de pipière au temps passé. Et tout se faisait pour ainsi dire en famille. Il n’était pas rare, pendant les repas,
(14) Le tuyau était séparé en son milieu par une virole factice peinte. Contrairement à l’explication de A. Tombu, la bague ne se plaçait pas à l’endroit où le tuyau rejoint le fourneau.
(p.138) de voir un ouvrier ou l’autre sortir d’une des fabriques en portant sur l’épaule une planche avec un tas de terre ou bien un bac de pipes. C’était pour une rou-leuse ou bien une trimeuse qui ne pouvait venir travailler tout un temps. En repassant, l’homme rapportait une planche de rouleaux ou bien un bac de pipes trimées. Et ainsi, la femme qui avait eu un accident et qui devait rester à la maison ne perdait pas tout son salaire, qui était déjà si mince.
On emballait souvent les pipes dans des mannes d’osier blanc : on recouvrait la manne d’un morceau de calicot qu’on cousait tout autour. Pour les pipes destinées à l’étranger, on se servait de caisses et on y emballait les pipes dans de la paille d’avoine.
Il arrivait que les maîtres pipiers ne traitent pas directement avec les clients des pays lointains. Ceux-ci avaient dans notre pays un homme chargé de recevoir toutes les marchandises qu’ils achetaient par ici et de les acheminer jusqu’au bateau à Anvers. C’est ainsi que chez Gaspard, (15) un des fils menait une fois ou deux par mois un grand chariot de pipes à Louvain, chez un homme qui était chargé de les faire parvenir à l’étranger.
Il allait aussi avec son chariot en Ardenne et même chez les Flamands.
Il arrivait encore bien que des marchands viennent chercher un chargement de pipes avec un attelage : ils se présentaient à la soirée et ils passaient la nuit dans un fenil pour repartir le lendemain au point du jour.
Nous avions aussi au village un homme qui ne faisait que transporter les pipes avec un attelage de chiens dans tous les alentours. Tous les gens de mon âge se souviennent encore de Manedaye et de ses chiens.
Il y avait même un petit marchand d’Alost, qu’on nommait ici Pierre le Flamand : il venait d’Alost à Andenelle à pied, périodiquement, avec de gros sabots et un chargement d’oignons et de gros choux sur une brouette. Il vendait sa marchandise aux pipiers puis il regagnait son pays avec une caisse de pipes. C’est à ne pas croire !
(15) Probablement Gaspard Dossogne dont l’atelier cessa, en 1882, la fabrication des pipes pour celle des tuiles ; cfr H. javaux, La pipe en terre d’Andenne, Namur, 1935, p. 15.
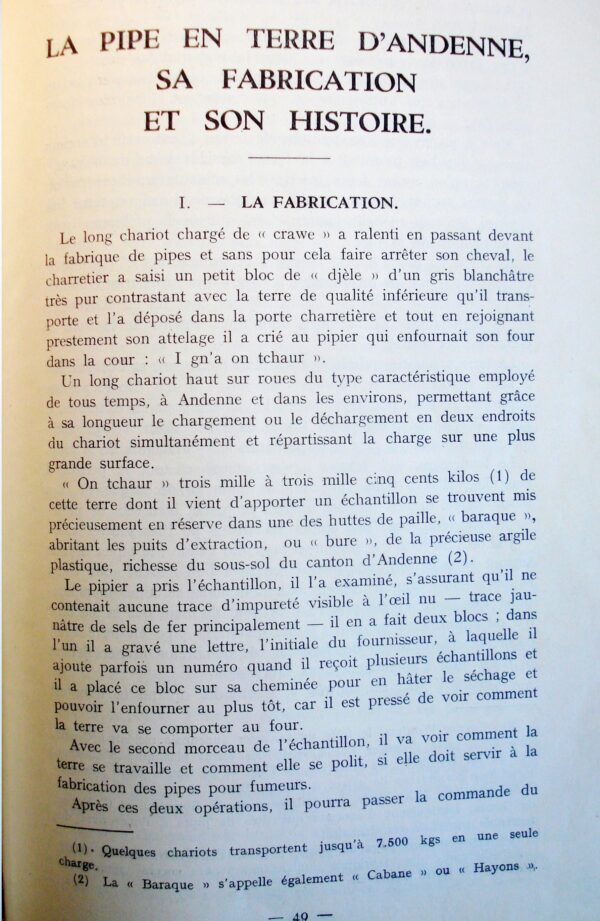
La pipe en terre d'Andenne, sa fabrication, son histoire
(in: Le Guetteur Wallon, 1934-1935, p.49-60, 86-95)

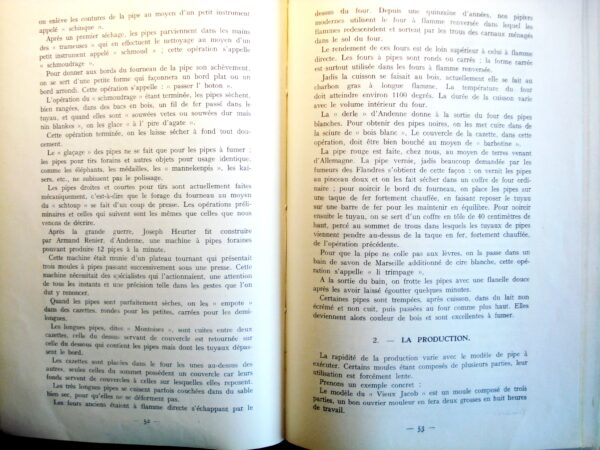
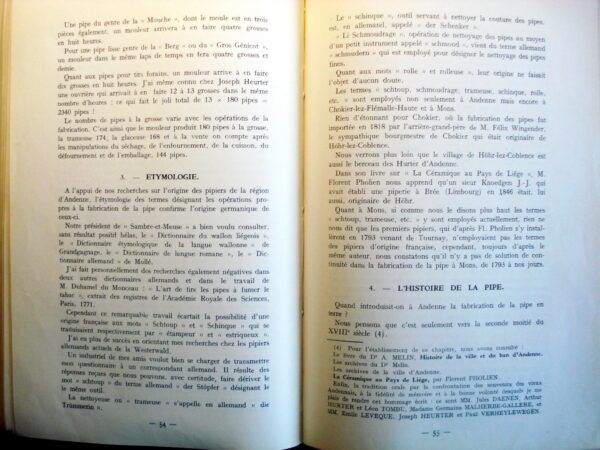
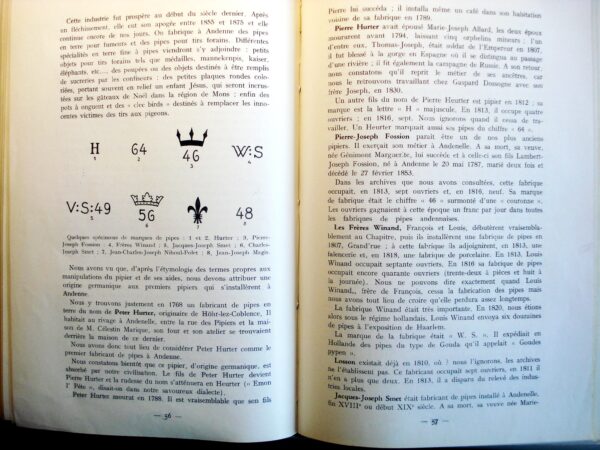


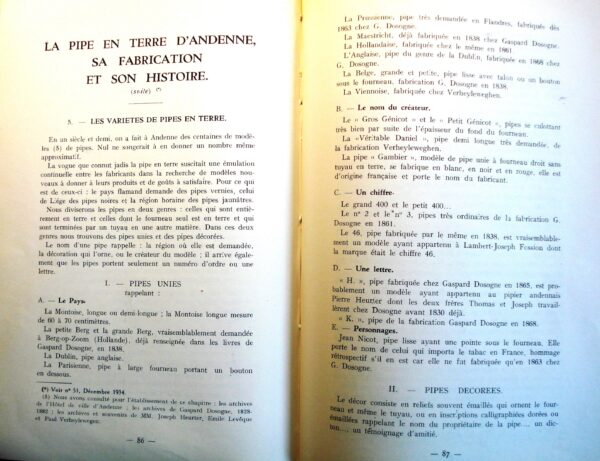
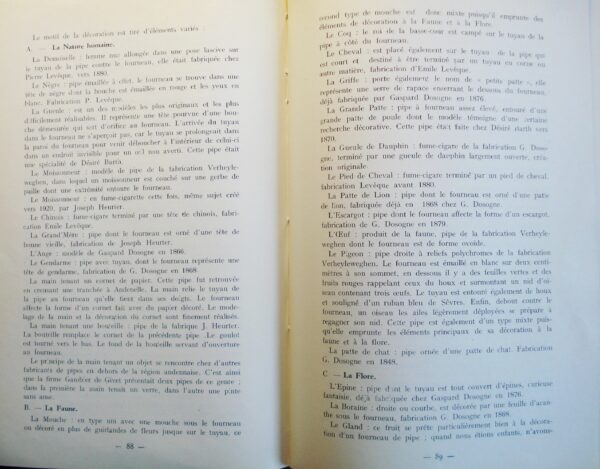
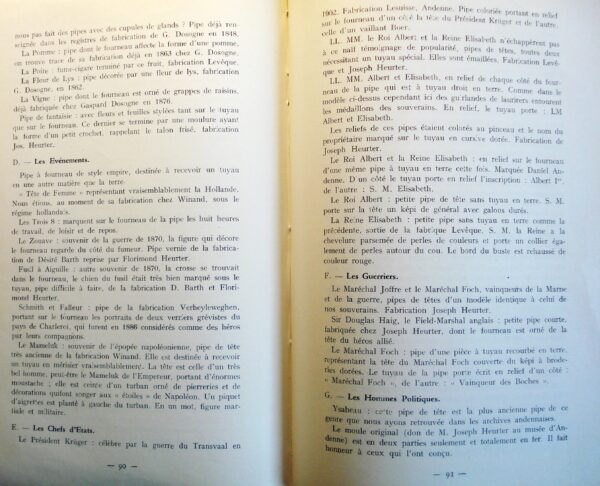

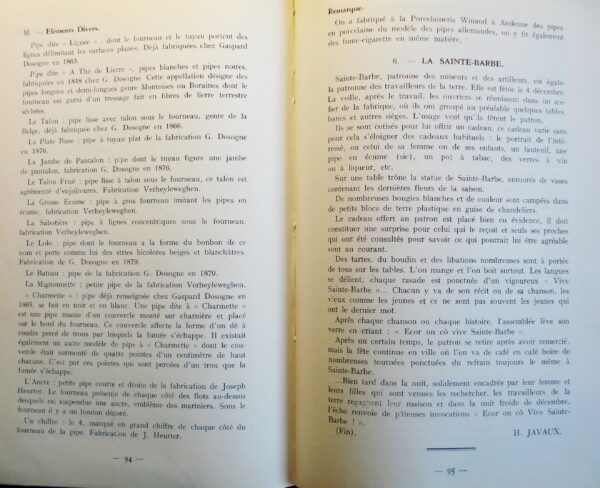
lès câriéres dins l’ comune d’ Andène / les carrières dans la commune d’Andenne
Namètche / Namèche

Sèye / Seilles
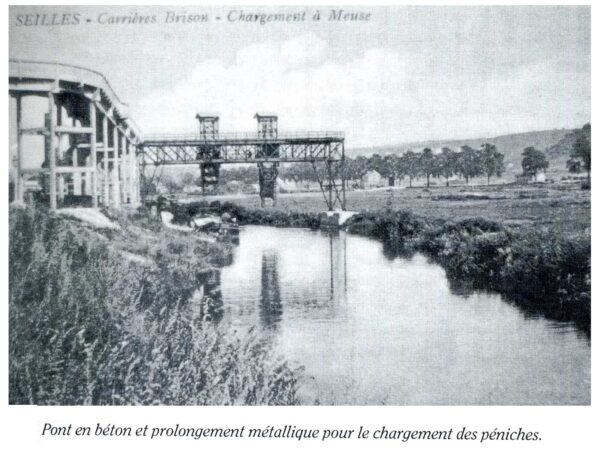
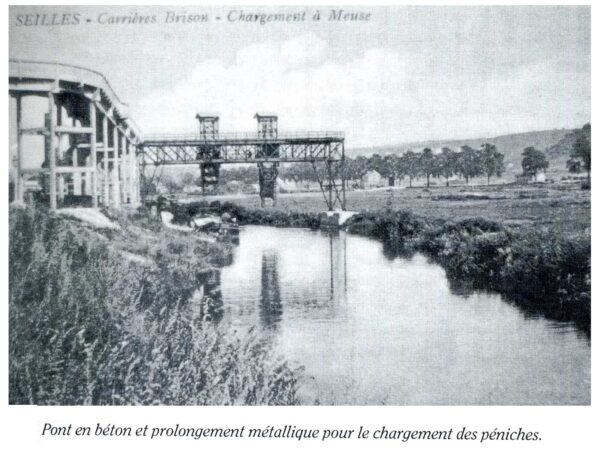
|
J. Desay
Li rotcheteû
Come li brut dè tonîre roudinant so l’ viyèdje Li mène qui vint d’ potchî, faît tronler l’ vwèsinèdje, Maîs va doner l’ bokèt di pan : A l’ ovrî vikant là dè l’ haute pareûse di pîre, Qui chake djoû rapwète ine taye sins grande manîre, Èt ‘ne douceûr âs-èfants.
Dizeû l’ hopê stâré, li meûr, lu, hâgne (1) sès plâyes. Lèyant pinde dès dintèles qui l’ ovreû n’ a nole pây S’ èles ni tomèt nin d’zos . Ossi d’vins chake tchabote, li rotcheteû plin d’ frankîse, È s’ min si fène haminde, d’ on pîd sûr, va prinde djîse, Pondou di sclats d’solo. (2)
Âtoû d ‘sès rins ratind so l’coron d’ eune longue cwède, Qu’ on camarâde tinkèye, djusse po qu’ i pôye si c’twède. Si s‘ pîd v’néve a hiper : Li rotcheteû s’ moke dè l’ sogne, i n’ veût qui l’ pîre pindowe, Ci-chal a tot momint, pout diveni l’ pîre qui towe, Pô d’ tchwè l’ pout fé lâker.
Di s’ bètchou mantche d’ acîr, i va d’vins chake crèveûre, Sayî dè trover ‘ne plèce, fé one pèsêye a mèseûre, Po basculer l’ cayewê . (3)
Il ouveûre è dandjî, sins nole plinte po sès pon.nes, I rouvèye min.me po l’s-autes qui sès-èfants sont djon.nes ; Èt l’ mwèrt avou s’ wahê. (4)
Li mwèrt qui stind sès brèsses, qui tofér èl manecèye, Què l’ sût min.me è s’ vilèsse come ine mâle kipagnèye, Qui ratind s’-t-eûre â cîr : (5) Lu s’ fèye à l’ âbitude, èt s’ rèployant vès l’ tère. Dimanerè li spirou sins qu’ on frèssou ni sére, Si bon vî coûr d’ acîr.
A ronn qui d’vins si steûle, li chance n’ areût-st-ine tètche. Qu’ ène fwèce èl tchoukereût là, wice qui l’ grand vude èl sètche, Lu qui n’ rind qu’ mèsbrudjî . Li tère rârè s’ poussîre, Diè lu r’prindrè-st-ine âme. È l’ vîgreûse Walonerèye tomereût co quékès lâmes, L’ adiè dès-aflidjis.
(1) hâguer = montrer (2) pondoû di sclas d’solo = peint de rayons de soleil (4) wahê = cercueil (3) cayewê = caillou (5) cîr = ciel
|
|
Fernand Henry
Li spinceû
Dizos l’ teût di tole ou di gngnès’, Â mitan mètou so deûs bwès, Qui chérvéve a garanti s’ tièsse, Dè l’ plêve, dè solo, dès grusês. Li spinçeû, li cou so one vîle plantche, Aveût lès djambes stindowes so s’ long, Faléve-t-i qu’ à djoke, i lès candje, Èdwèrmowes è s’ lâdje pantalon.
D’ on hopé d’ pîres mètou sins cogne, Ci-chal aveût bin vite trové Li mwèlon qui r’tournéve d’ on pogn, So l’ timps qu’ l’ ôte hatchîve li pavé. Ciète, li spincète fève tot l’ ovrèdje, Mins ses oûys, avît tos lès dreûts, Dismètant qu’ i féve ses tèyèdjes, L’ ustèye djouwéve divins ses deûts.
Li spinçeû qu’ ovréve cisse mâle pîre, Payéve tchîr çou qu’ aveût-st-apris, So l’ mârtê voléve li poussîre, D’ où-ce, tot djon.ne, i sèreût moûdri. Cisse poûssîre, po tote rik’nohance, Kitèhîve si coûr, sès peûmons, Èt lès clokes di leûs dièrin.nès transes, Sûvî s’ cwèrp â monde dès foyons. On bê djoû là, so totes lès vôyes, Nos vèyîs stindeon neûr coveteû, Chake pavêye a catchî sès rôyes, Avou lès sofrances dès spinçeûs. Ci mèstî-là fève nos tchâssêyes, Èt li grès, dès siékes a chèrvi, Il èsteût rimpli dès pinsêyes, Dès spinçeûs qui l’ a faît mori.
|
|
Fernand Henry
Li spiyeû
(Le casseur de pierres.) (in: VA, 12/06/1962)
À l’ prumîre eûre di l’ â-matin, On-z-oyéve sès clâs so l’ payêye, Li spiyeû divins tos lès timps Aléve wangnî l’ pan dè l’ nihêye. Sins noû ratena dès-eûres â lon, Li ma flahîve, po sclater l’ pîre. D’ on côp d’ brèsse, i horbéve si front, Ca l’ souweûr broûléve sès pâpîres. Tot rimplihant li lâdje goliot, I d’véve loukî si, d’zeû, rin n’ brotche. Dès pîres toumèt quékefèyes dizos, Èt polèt l’ sitârer so l’ rotche. Dès sclats côpant come dès rèseûs, Kitèyît sès mins co çint fèyes, Èt sins l’ plakante teûle à sès deûts, Li song âreût rodji s’-t-ustèye. D’ on côp d’ oûy, il aveût vèyou Li limé, li rôye d’ ine aute tinte. Si côp d’ ma n’ èsteût may pièrdou, Èt l’ acîr féve ôre come ine plinte. Parèy qu’ ine frumih’ s’ on platê, On l’ vèyéve qu’ i féve si tchèrdjèdje, Po chèvi lès fors, lès batês, Tote si vèye, a stu l’ min.me ovrèdje. Ci mèstî-là va sûr fini, Ci n’ sèrè pus qu’ ine sovenance, Li progrès vèyéve, c’ èst l’ aveni, I maîstrih tot, qwèqui nos fanse. Âtoû dè l’ mène, tot èst candjî, Ine fwète machine a stindou s’ brèsse, Èt l’ hopê d’ pîres èst vite magnî, Mins grâce à lèye, l’ ome n’ èst pus one bièsse.
|
Lès tchèrbonadjes à Andène / Les charbonnages à Andenne
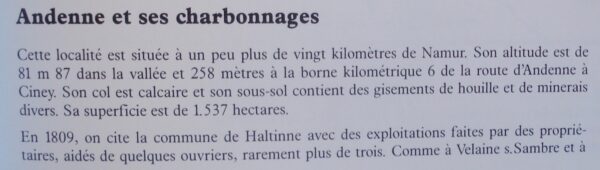
(in: René Dujollier, Les charbonnages en Wallonie, 1345-1984, éd. Erasme, s.d.)


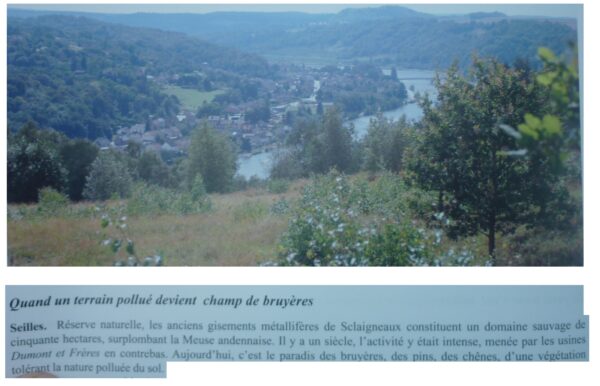
(J.-Fr. Pacco, Paysages du Namurois, éd. namuroises, s.d.)
Ôtès fosses / Autres mines
Divant, gn-aveut dès fosses di keûve à Landène. / Autrefois existaient des mines de cuivre à Landenne. (in: Archit. rurale de Wallonie, Pays de Herve, 1987)
Varia

Li martchand d' cindes (litt. le marchand de cendres)
(André Elen, Andenne au détour des rues et des chemins, s.d.)
