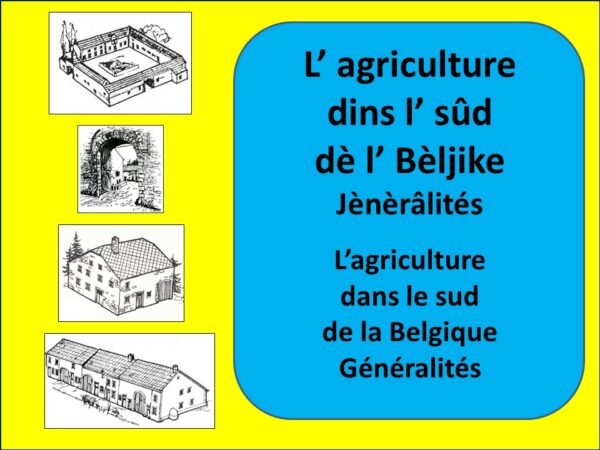
L' agriculture dins l' sûd dè l' Bèljike : jènèrâlités / L'agriculture dans le sud de la Belgique : généralités
|
Octave Grandjean (nov. 1947), Notes sur l’agriculture à Rogery-Bovigny (1850-1950), in : GSHA, 15, 1981, p.31-39
Les prairies
Reportons-nous encore vers 1860-1870, et nous pourrons constater que le sol occupé par des prairies naturelle, où l’arrosage pouvait se faire, fournissait le principal appoint en foin destiné au bétail local. On le considérait en ces temps comme terrain de première valeur au point que, dans les partages de famille, on n’hésitait pas à sectionner selon le nombre d’enfants afin qu’aucun d’eux ne fût lésé et que tous pussent compter à peu près sûrement sur une récolte régulière en foins. D’ailleurs, les soins particuliers qu’on leur accordait, non pas tant en fumure qu’en toilette, avaient leur importance lors de la récolte. Quant aux prairies artificielles, elles se présentaient dans l’état le plus lamentable : terres véritablement en jachères, succédant à un certain nombre de récoltes épuisantes, sans fumure nouvelle, ni en fumier, ni en engrais minéraux, parce qu’inconnus en ces temps-là. De ce fait, plusieurs années leur étaient nécessaires pour la formation d’un gazon très maigre et de mauvaise qualité, les « fleurs » ne contenant au début que pâquerettes, « fleurs de St-Jean », chicorées sauvages, jeunes pousses de genêts et quantité de mauvaises herbes ne laissant que peu de place aux graminées spontanées. Et ce qui portait à son comble la pauvreté du sol, c’était, avec l’enlèvement de (p.35) la première coupe, l’éloignement des troupeaux, soit ovins, soit bovins, jusqu’à l’époque des maigres regains afin de se ménager encore, quand c’était possible un mince surcroît de réserves pour les longs hivers. Les déjections animales n’étaient point étendues, les refus conséquemment nombreux, les touffes de genêts se montrant partout, la mousse ne tardant guère à se montrer et, dès lors, les rendements soit en herbe, soit en foin, réellement insuffisants. Aussi n’étaient-ils pas rares les troupeaux conduits dans les bruyères, dans les bois ou le long des chemins, afin d’y chercher de quoi suppléer à l’insuffisance rencontrée dans les pâtures proprement dites. Parfois même, hommes et femmes allaient-ils recueillir à la main ou à la dérobée l’herbe ronde, la fétuque des bois, pour parfaire la ration nécessaire.
Dans de telles conditions, on comprend aisément quelle devait être la rusticité du bétail, son peu de développement et son maigre rendement tant en viande qu’en lait. Mais, vers l’aube du vingtième siècle, quels changements de tactique, quelles améliorations apportées ! Et ce sont surtout les prairies artificielles qui subiront ces changements, car, par contre, il faut noter le délaissement des « prés » petit à petit jusqu’à l’abandon, pour ainsi dire, sinon pour l’enlèvement de ce qui continue à pousser spontanément. A noter aussi que, de plus en plus, on a abandonné l’irrigation qui ne produisait qu’un foin ligneux de très grande taille, mais peu riche en éléments nutritifs surtout que sa récolte était souvent postérieure à la rentrée des foins artificiels. Ce fut donc à la création de prairies artificielles que la population apporta tous ses soins. En remplacement des « fleuris » improductifs, l’introduction du trèfle rouge vint augmenter la production fourragère. On y adjoignit aussi, après quelque trèfle hybride servit à provoquer un gazon mieux fourni. On en vint enfin, sur Ifc conseil des agronomes, à semer d’autres graminées fourragères, surtout en vue de créer des prairies durables pour pâturages.
Mais si l’amélioration de la flore résulte d’un semis de graminées de meilleure qualité, la quantité de la récolte retira son plus grand changement du fait de soins plus spéciaux accordés aux prairies et d’une fumure jamais accordée auparavant.
On se rappelle, non sans un certain sourire, les temps où un épandage de fumier sur prairies était considéré comme dépassant la saine raison. On ne parlait point non plus d’engrais, en ces temps pas si éloignés. Mais, dans le premier quart du XXe siècle, les prairies partagèrent, avec les cultures, les fumures de la ferme, tant naturelles qu’apportées. Une couverture de fumier, un épandage de scories ou de potasse, étaient complétés parfois, chez les producteurs aisés, par un appoint d’azote minéral ou souvent même, après la généralisation des fosses à purin, par de l’azote liquide. Peu d’ans suffirent pour donner alors à notre terroir un aspect tout différent : les surfaces emblavées de céréales diminuèrent d’année en année, la verdure des prairies s’accroissant sans cesse non cependant au point d’éliminer complètement (p.36) les premières, mais suffisamment pour faire classer notre sol dans les régions herbagères par la trop célèbre C.N.A.A. de la guerre 1940-1945. Cependant, si les rendements considérables tant en herbages qu’en foins obtenus dans la période d’entre les deux guerres, se rapprochaient notablement de ceux des régions de Hervé et consœurs, il faut noter que notre sol, nanti d’une fumure moins ancienne, demandait continuellement un entretien plus coûteux en matières fertilisantes.
Un parallèle bien compris entre les deux positions indiquées montre sans peine que le fermier hervien passe plus souvent commande chez les marchands d’aliments concentrés et le nôtre, chez les fabricants d’engrais chimiques. Mais, en revanche, la grande profondeur de terre arable de notre sol nous a épargné la grande disette d’eau qui a si terriblement desséché les prairies dans beaucoup de cantons herbagers l’été 1947.
Les cultures
Parallèlement au développement des prairies, ou plutôt le précédant d’une vingtaine d’années, une amélioration notable se manifesta aussi dans les rendements des terres à labour. Les terres presque vierges nouvellement défrichées, tout comme d’ailleurs les anciennes campagnes, dès qu’elles sentirent la fumure aux engrais chimiques, donnèrent des rendements nettement meilleurs, non de 30 à 40 quintaux à l’hectare comme dans certaines contrées, mais tout de même de 2.500 à 3.000 kg aux 100 ares. Il est vrai que les variétés d’avoine en ces temps étaient très rustiques et que I’ « avoine commune » et la « noire » étaient infiniment plus volontaires que nos variétés actuelles. Dans de telles conditions, il est facile de supputer les rendements inférieurs que l’on obtenait. Mais, avec l’emploi des engrais et la mise en culture des terres nouvelles, on vit généralement de magnifiques récoltes : les granges en regorgèrent, la rentrée sous toit devint impossible et les meules se multiplièrent dans les campagnes. Il est vrai de constater que les grosses batteuses mécaniques ne fonctionnaient guère chez nous. Les cultivateurs devaient par des moyens plus lents, passer des jours et des jours d’hiver au battage. Mais alors personne ne pensait plus à la fabrication de la « farine d’avoine » pour les crêpes ou usages similaires, et c’est le bétail, aussi bien les bovidés que les chevaux, qui la consommaient tout entière Elle était servie tantôt sous sa forme naturelle, tantôt séparée de la paille, tantôt moulue ou même simplement aplatie. Grâce aussi à l’abondance de ce grain, l’élevage du bétail, surtout bovin, réalisa de grands progrès, et l’on remarqua l’avidité des marchands pour l’obtention de nos bêtes locales qui donnaient d’excellents résultats par suite de leur alimentation principalement à base d’avoine.
De ces temps également, date la multiplication des chevaux employés aux labours, fort peu à l’élevage, mettant de plus en plus à l’écart l’usage du bœuf de (p.37) trait. Quant à la vache de trait, son emploi chez nous fut de tout temps minime. A la période d’entre-deux-guerres, la grande culture diminua sans cesse pour s’orienter vers les pâturages.
Il reste une dernière céréale : l’orge. Sa culture, inconnue anciennement, ne s’est introduite qu’assez tard et tout d’abord dans les terrains appauvris où l’avoine ne payait plus les frais de culture. En ces derniers temps cependant, on en a encore augmenté considérablement les emblavures, étant donné sa culture moins coûteuse, ses rendements élevés et surtout son emploi dans l’alimentation porcine, en notable progrès aussi. Mais avec l’orge comme avec le froment, il fallait compter sur la dureté du climat et les essais en escourgeon donnèrent rarement satisfaction. On se limita donc aux orges de printemps.
La culture du blé n’est apparue que très rarement, sa réussite dans notre sol étant très aléatoire et sa mouture ne trouvait pas dans les moulins des environs un outillage convenable. Certaines personnes ne dédaignaient cependant pas le pain de blé, n’y trouvant que le seul désavantage d’une cuisson souvent répétée pour éviter le dessèchement. On est cependant généralement d’avis que nos récoltes donnent plus de rendement en paille qu’en grain et cela surtout quand l’usage de la potasse était peu intense ou le redevint par des restrictions en temps de guerre.
Pour ce qui concerne les céréales cultivées, on rencontre à l’heure actuelle (1947) du froment, du seigle, de l’orge et de l’avoine ; à y ajouter des pommes de terre et des betteraves fourragères. Quant aux plantes industrielles, elles ne furent mises en culture que par pis-aller : le lin autrefois, par très petites parcelles pour les besoins en toile de chaque famille, le tabac en période difficile d’approvisionnement sous le régime des timbres. Autrefois, le seigle était la première de toutes les céréales, celle donnant le maximum de rendement, soit en terres labourées, soit en terrains essartés. Il constituait la principale nourriture de l’homme et donnait, au témoignage de feu le docteur Lomry, sa résistance physique particulière à l’Ardennais ! « Mange toujours ton pain de seigle et laisse au Flamand son pain blanc », boutade qui n’est cependant que partiellement vraie actuellement, nos ménages délaissant de plus en plus le pain « noir » de seigle pour le pain « blanc » de froment.
Toutefois, un mélange de 25 % de seigle au froment constitue le meilleur pain pour le campagnard à l’appétit toujours en éveil dans ses durs travaux. Il est donc à noter cependant qu’on n’abandonne pas volontiers complètement la culture du seigle, même encore de nos jours, tant à cause de sa rusticité que pour (p.38) les grands services que sa paille rend dans les besoins de la ferme.
Chez nous, il n’y a pas tellement d’années que le froment n’était cultivé que très timidement, et encore, ne semait-on pour ainsi dire que des froments de printemps. L’évolution s’est manifestée également ici avec l’amélioration des sols causée par une fumure plus riche, soit en fumier, soit en engrais verts ou chimiques. On a vu se multiplier les champs de froment, quoique cependant très modérément. On a dû tenir compte pour cette culture que nos hivers sont souvent rigoureux et détruisent les emblavures d’automne et n’employer généralement que du « froment de mars » dont la réussite est plus certaine même si son rendement est inférieur à celui du froment d’hiver. Encore cherche-t-on les variétés les plus rustiques : le « petit roux » en tout premier lieu, les variétés de « froment blanc » donnant paille à volonté mais mûrissant chez nous trop tardivement ou pas, sauf aux étés exceptionnellement chauds comme en 1921, 1929 et 1947. Il en est encore qui en critiquent la qualité de sa farine, ce qui est partiellement vrai, mais partiellement aussi imputable au travail de meunerie. Si nous passons aux cultures d’avoine, nous pourrons voir vers 1860 un autre but de travail que celui que l’on envisage de nos jours. L’avoine, en ces années lointaines, était cultivée comme céréale panifiable, destinée à suppléer à l’insuffisance du seigle. Tout le grain de qualité, sauf la réserve employée aux semis, était destiné à l’alimentation humaine, et ce n’est que le petit grain et la « close-paille » — grain arrosé sans farine — que l’on donnait au bétail, et cela plus spécialement encore aux bêtes de trait, à l’époque des travaux pénibles.
La méthode d’assolement était la suivante : l’avoine succédait à l’emblavure du seigle et, selon les présomptions de plus ou moins de richesses du sol, une succession de deux, trois, quatre récoltes se rencontrait sur un même terrain jusqu’au jour où la pauvreté du rendement forçait à laisser le sol en jachère. Les plantes-racines ne furent jamais, chez nous, l’objet de culture sur une grande échelle.
La simple betterave fourragère ne tarda pas à être remplacée par la « demi-sucrière » constituant un aliment plus riche. Sa production tout entière était utilisée pour l’alimentation locale. La pomme de terre, exploitée au début du XIXe siècle, en partie pour la consommation, a vu aussi diminuer sa culture, surtout après la production de l’herbe. Tel était anciennement, tel est à peu près vers 1950, l’aperçu de nos cultures. N’oublions cependant pas que si le progrès avec ses rendements plus élevés avait produit un bétail plus nombreux et plus beau, une fumure plus abondante, la seconde guerre mondiale et les jours qui l’ont suivie ont marqué une régression qui exigea (p.39) plusieurs années d’efforts avant le rétablissement de la situation de naguère. Puisse la liberté rendue au commerce des produits agricoles et à celui des fertilisants, jointe à une bonne politique agricole, ramener la fertilité d’autrefois et même l’augmenter.
|
|
in : Marylène Foguenne, Fils d’Ardenne, Souvenirs d’une vie au Pays de Bastogne, 1930-1950, éd. Eole, 2003
Le travail à la ferme : l’hiver
Les derniers semis d’hiver terminés, le travail à la ferme se trouvait réduit. Lorsque les journées n’étaient pas trop mauvaises, nous en profitions pour effectuer les travaux de réparation les plus divers : les clôtures, outils, machines… Les vaches étaient rentrées dans les étables et nous devions, chaque jour, les nettoyer, les nourrir. En automne, lorsque les granges étaient remplies, nous laissions des meules de céréales à l’extérieur que nous couvrions avec de la paille de seigle. Elles restaient dehors quelques mois, le temps de trouver de la place dans la grange. Au fur et à mesure que nous les rentrions, nous devions à nouveau les battre à la main. La paille de moindre qualité servait de litière pour les bêtes. Tous les jours, nous devions la changer et sortir le fumier. La paille de meilleure qualité, nous l’utilisions pour nourrir les vaches. Ainsi, chaque jour, nous la coupions à la machine (hache-paille), en morceaux réguliers de 1 ou 2 cm et nous la mélangions à des betteraves fourragères, coupées elles aussi au coupe-racines. Avant l’électricité, nous effectuions le travail à la main et plus tard, seulement, des moteurs actionnaient ces machines. Les betteraves que l’on donnait aux bêtes étaient des demi-sucrières, elles avaient un meilleur rendement et étaient plus nourrissantes. La paille n’avait pas beaucoup de goût, mais la betterave lui apportait saveur et richesse alimentaire.
Je me rappelle aussi que je nourrissais les cochons. Pour ceux-ci, c’était différent car ils restaient toute l’année à l’écurie et il fallait donc les nourrir tous les jours. J’étais chargé de leur préparer la cabolèye : une bouillie épaisse cuite dans le caboleû et qui se composait de pommes de terre, d’épluchures, de betteraves et parfois d’orties. On disait de ces dernières qu’elles apportaient un complément alimentaire. Le caboleû, qui se trouvait à l’écurie, comportait plusieurs parties : un foyer sur lequel s’ajustait un grand chaudron avec un couvercle. Le tout était en fonte. L’entrée du foyer se situait devant et à l’arrière se trouvait une buse par laquelle s’échappait la fumée. Lorsque le chaudron était prêt, je remplissais le foyer de coches (branches coupées) que je prenais hors d’un fagot et j’y mettais le feu. Les flammes léchaient la marmite et la fumée sortait par la buse. Je devais alimenter le feu régulièrement et surveiller qu’il ne déborde pas hors du foyer. Ce travail représentait un plaisir car je pouvais m’amuser à faire du feu. Je devais toutefois être prudent pour ne pas provoquer un incendie. Parfois, quand je surveillais la cuisson, je m’enfermais dans l’écurie avec des livres et personne ne venait me déranger. Je me sentais bien, j’étais tranquille.
|
|
Jean Haust, Li Pan dè bon Diu, Recueil complet des poèmes wallons de Henri Simon, ULg, 1935
Li Pan dè bon Diu
Panem nostrum…
I Li tchèrwèdje
Lès-awouts sont finis, lès d’vêres ont stu rintrés, èt, pidjote a midjote, li pauve tére èst tote nowe. So lès håyes come è bwès, totes lès foyes sont djènèyes èt gotèt djus dès cohes, eune à eune, — come lès låmes dè l’ bèle såhon qui s’ sint d’cwèli. Dès lonkès hièdes d’ oûhês passèt tot s’ èhåstant po r’gangnî l’ tchaud payis èt, là, drî lès nûlêyes qui corèt totès basses dizos l’ vint qui lès tchèsse, c’ è-st-a hipe s’ on-z-advène li solo, tot pèneûs di n’ nos poleûr pus rèhandi.
Mins s’ tot nos qwite, moûrt ou s’èdwème, l’ ome èst là qui n’ pièd’ nin corèdje. Li tére lî d’meûre. Ås-êres de djoû, plin d’ èhowe, i s’ mèt’ à l’ ovrèdje. È l’ grande siteûle, là, so l’ pindêye, èl vèyez-ve avou sès deûs dj’vås ? I vint d’ èdjibler si-atèlèdje. Li hî, qu’ èst tèyant come ine fås, d’ on plin côp mousse è coûr dè l’ tére, qui, bin påhûle dispôy in-an, ni s’ sovenéve quåsî pus d’ l’ èrére… Volà ‘ne rôye tapêye è mitan : on dîreût ‘ne plåye faîte à l’ djouhîre… Mins ç’ n’ èst qu’ l’ amwèce : sins måy låker, l’ èrére vint rinde si côp d’ acîr à l’ tére qui djèmih tot s’ drovant.
I fåt portant qu’ lès dj’vås soflèsse : l’ ome arèstêye sès deûs bayårds èt, dismètant qu’ i toûne li tièsse po loukî l’ ovrèdje abatou, volà qu’ d’ å fî fond dè l’ brouheûr tote grîse, qui rafûle li campagne, aspite ine nûlêye di cwèrbås; èt, come si ‘ne saquî l’zî dèrisse qui, por zèls, l’ eûrêye èst là prète, vo-lès-là plonkîs, tot brèyant, å mitan dè tchèrwé qui fome ; èt, so lès roukes come è l’ arôye, c’ è-st-on disdut, c’ è-st-on sam’rou di neûrès-éles èt d’ vigreûs bètch ramèhenant tot l’ måva bisteû qui l’ èrére vint d’ abouter foû.
Ossu, qwand l’ ome veût leû-z-èhowe, i s’ sint tot honteûs dè n’ rin fé, ca, d’ on côp, dispièrtant ses dj’vås, volà qu’ i ratake à tchèrwer. Èt, si longue qui l’ djoûrnêye sèrè, tot come l’ arègne qui tèh si teûle, l’ èrére va tant toûrner dès côps qu’ i n’ dimeûr’rè rin dè l’ siteûle.
II Li sèmèdje
Li djouhîre èst tchèrwêye. L’ èrére si pout r’pwèser. Ossu, l’ ome èl lêt là po prinde ine aute ustèye. (p.21) C’ èst d’ abôrd l’ îpe, qui drèsse vès l’ cîr sès bètchous dints, prète à-z-agridjî l’ tére. L’ ome l’ a dèdja r’toûrné; lès dj’vås sont-st-atèlés, li prumîre plène tapêye; èt, d’zos l’ ustèye qui fait dès hopes tot k’tèyant lès rôyes dè tchèrwé, lès cwâres èt lès roukes si fondèt, li tére si brîhe, si strûle èt håle. Mins, come i d’meûre co dès groubiotes qui l’ îpe roûvèye, li pèsante wèle passe tot wîgnant so l’ tére tote hole èt v’s-èl sipate tot come on dègn.
L’ ome tchåsse li blanc sèmeû, vis-èl rimplih à make èt, d’ on djèsse todi l’ min.me, d’ on grand djèsse qui v’s-a l’ aîr dè voleûr acoyî tot çou qu’ il a d’vant lu, — d’ on djèsse qui nos rapinse li ci qu’ fèt lès priyèsses tot tapant l’ bèneûte êwe è l’ grande påhûlisté qui djaumih è l’èglîse, — i sème, èl keûhisté dè l’ campagne qui fruzih à l’ prumîre blanke rålêye. Lès hos d’ ôr, tot gruselant foû dè l’ min qui lès hène, s’ abatèt tot spitant so l’ tére, qui lès rawåde èt trèfèle dè ravu lès-èfants qu’èle pwèrta…
On côp d’ îpe lès rafûle, on côp d’ îpe lès-ètére : is n’ ont pus qu’ à djèrmi.
III Li sûrdèdje
Èt l’ ome a rèminé sès-ustèyes èt sès dj’vås, èt v’là l’ sèmé d’manou tot fî seû so l’ campagne. Portant, d’zos li spèheûr dè l’ tére qu’ avise d’ èsse mwète, on rèsse di vèye djaumih, ine fwèce catchèye oûveûre. L’ ameûr fait hoûser l’ ho, qui sclate è deûs bokèts. (p.22) Ine pitite rècinète, on rin, crèh è baheûr, Tot fant qu’ on djèt s’ èlîve èt trawe li dègn di d’zeûr. Èt volà tot d’ on côp, so l’ sèmé qu’ èsteût nou, qui dès mèyes èt dès mèyes di bètchètes sititchèt, totès fènes, totès dreûtes, qui v’ dîrîz dès-awèyes. Li tére candje di coleûr, lès djètons s’ dirôlèt, s’ acouvetèt, s’ abohenèt, s’ èmontèt, vèrdihèt, d’ on bê vért qui r’glatih plin d’ ameûr èt d’ djon.nèsse.
Qui l’ iviér vinse asteûre ! Li grin, fwért èt vigreûs, pout ratinde, sins crankî, lès djalêyes èt lès freûds.
IV L’iviér
Volà l’ iviér vinou : so lès téres disseûlêyes, pus rin, ni djins ni bièsses. Lès r’lûhantès-èréres, rètraukelêyes è tchèri, s’ arènihèt dèdjà, èt l’ bisteû, tot foû d’ lu dè vèy qu’ on l’ mèt’ è sère, beûrlêye divins lès stås. Ine cwahante bîhe sofèle, lès sûrs sont dèdjà pris : i djale à finde lès pîres, èt l’ pauve pitit djon.ne grin, qu’ aviséve si virlih, si racrampih di freûd. L’ ome, lu, qu’ è-st-è l’ coulêye, tûze à çou qu’ advinreût si l’ djalêye duréve trop’ : «Adiu lès bês-awouts, lès tchårs qu’ on tchèdje à make èt lès cinas trop streûts! C’ èst mutwèt tot-à hipe s’ i pôrè ramèhener çou qu’ il a sèmé d’ grin ! » Mins, là qu’ i s’ lårmèn’têye so l’ histou què l’ rascråwe, li tins candje tot d’ on côp; ca vola dès flotchètes qui passèt totès blankes å-d’-divant dè l’ finièsse… (p.23) L’ ome èst dèdja so l’ soû : « Awè ! c’est bin l’ nîvaye ! Èl vèyez-ve, là d’å lon acori so nos-autes, come on djônê qui same? èl vèyez-ve s’ ètèsser ? » Ossu, so må pô d’ timps, li tére ni sèrè pus qu’ ine grande blanke sitårêye, qui lès håyes èt lès bwès, lès-åbes èt lès bouhons markèt d’ ine tètche blouwisse. Asteûre i pout djaler : volà l’ grin qu’ èst foû sogne. I va houri, påhûle, tant qui l’ solo d’ avri lî dèye tot l’ disfûlant : « Ti pous crèhe à t’ sonlant ! »
V Avri
Li spitant meûs d’ avri fait d’djà sclater so l’ håye tos lès p’tits-oûy tinrûles qui l’ frudeûr èdwèrma; èt, dismètant qu’ èl wêde li wazon radjon.nih èt stitche vès l’ tchaud solo sès djètons si fråhûles, li bwès, qu’ on veût d’ å lon, s’ èwalpêye d’ ine brouheûr d’ on rodje sètchant so l’ vért, qui rapinse li fouyèdje. Lès-oûhês sont rimenous : on-z-ôt d’vins lès bouhons tos lès måyes, qui r’cwèrdèt leûs pus doûzès tchansons po l’ frumèle qui cotèye èt qwîrt à mète sès-oûs. C’ èst l’ prétimps. Tot ravike ! èt l’ pauve grin, qui l’ djalêye aveût tant rascråwé, si r’lîve, come on malåde qui k’mince à s’ rihaper d’ ine tènisse maladèye. Mins l’ mateûr lî faît fåte : ossu l’ Ci qu’ èst là-d’zeûr a d’djà compris s’ misére èt, come s’ i fahe on sène, là, dè costé d’ bon vint, lès nûlêyes acorèt èt l’ plêve tome, doûce èt tchaude, inte deûs-êres di solo, L’ êwe èt l’ feû s’ acoplèt po rinde dè l’ fwèce à l’ tére ; li séve monte, li grin crèh, vèrdih èt s’ abohenêye. (p.24) Èt volà d’ on plin côp, so l’ campagne qui s’ loukîve come faîte d’ ine seûle grande pèce, qui lès tchamps s’ pårtihèt, tot l’ kitèyant à vérts bokèts.
Ossu, qwand l’ ome vinrè po vèy çou qu’ è-st-avenou dè grin qu’ il a sèmé, lès promèsses dè prétims lî f’ront roûvî lès hisses qui l’^iviér lî a d’né.
VI Li florihåye
Èt qwand l’ tchaud solo dè meûs d’ djun monta l’ prumî côp drî lès tiérs, so l’ campagne qui r’dohîve d’ ameûr i trova l’ djon.ne grin qui drèssîve tote ine årmêye d’ aw’hiantès pontes, dizeû lès bleûvès cåyes èt lès rotchès tonîres. Èt, sins tårdjî, come c’ èst l’ moumint qui tot crèh sot, qui tot brotche foû, lès fleûrs aspitèt so lès potes, clintchèyes inte zèles come po s’ båhî.
Li tins d’ florihåye, c’ èst l’ såhon d’ l’ amoûr, qu’ èst maîsse divins tot, disqu’à d’vins lès fleûrs, divenowes come dès nids là qu’ li p’tit tinre ho va trover s’ djîse prèt’ po crèhe èt maw’ri. On doûs vint sofèle èt, si lon qu’ on veûse, li campagne si ståre èt rôle sès vérts flots, qui, tot fî parèy ås cis dè l’ grande mér, crèhèt, pwis morèt, sins jamåy fali. Ine poûssîre, si fène qu’on nè l’ sét vèyî, s’ èlîve èt s’ kissème à chake flot qui passe, èt là, d’zos l’ solo, è l’ pâhûlisté dè l’ tére qui frudjèye, — lès grins sont mariés.
VII Awout
Li tcholeûr èssopetêye li tére. Rin ni s’ rimowe, i n’ coûrt nou vint. On n’ ôt nou brut : c’ èst tot-a hipe si l’ tchant dè l’ cwaye, catchèye è grin, vis faît pinser qu’ ine saqwè vike. C’ èst l’ timps d’ awout, là qui l’ solo done à l’ tére si dièrin côp d’ min, po fé frudjî çou qu’ èle pwèrta èt payî l’ ome di totes sès panes. Lès fènèsses, nawêre dreûtes èt fîres, falihèt dè suteni lès pôtes totès riglêyes di pèsants hos; èt, bin doûcemint, l’ campagne djènih, télemint qu’ volà come on drap d’ ôr tot r’glatihant stindou sor lèy. Ossu l’ cinsî, sins pus wêster, braît : « C’ èst l’ awout ! » Rade on s’ aglidje : lès fås pindowes divins lès heûres sont d’mantchèyes èrî d’ leûs fâmins, èt volà qui, d’vins totes lès cinses, lès coûrs s’ implihèt d’ on brut d’ fôdje qui s’ mèt’ à hileter djoyeûsemint. C’ èst lès tèyants dès fås qu’on r’drèsse à côps d’ martê so lès batemints.
VIII Li soyèdje
Et volà lès soyeûs qui s’ pårtihèt l’ campagne, îr èco si påhûle, oûy plinte d’on monde di djins s’ aglidjant chake al mîs po l’ dispouyî d’ sès d’vêres. (p.26) Adon, è plin solo blamant d’ tos sès pus reûds, L’ ovrèdje kimince, deûr èt sins r’pwès.
Come dès balands tofér èn-alèdje, lès aw’hiantès fås moussèt d’vins lès grins. Li r’lûhant dè fiér passe come l’ aloumîre. Ine saqwè djèmih èt, d’zos lès tèyants, lès pèsantès pautes, prîses come d’ on toûbion, s’ abatèt so l’ tére qui lès-a pwèrté; èt, drî lès soyeûs, lès bates si stårèt à lonkès hièrtchèyes, qui lès racôyerèsses d’ on vigreûs côp d’ séye mètèt-st-à djavês.
Ossu, so quékès-eûres, on n’ rik’noh pus l’ payis. Li campagne, atakêye di traze èt traze costés, si droûve divant lès fås ; èt dès lonkès-alêyes, si loukant totès vètes so l’ coleûr d’ ôr dès grins, mostrèt l’ovrèdje qu’ èst faît. « Qu’ on-z-atake à loyî ! » braît l’ maîsse. Èt lès djavês divenèt d’ on côp dès djåbes, èt lès djåbes dès tèssês, qui s’ drèssèt so lès steûles à lonkès riguilites. Vos dîrîz-st-ine årmêye abrotchant foû dè l’ tére; mins c’ èst l’årmêye dè l’ påy. Èle nos-apwète li vèye : l’ome s’ènnè va tchèvi.
IX Li tchèrièdje
Vola dèdja ‘ne hapêye qu’ on-z-a drèssî lès djåbes. Èlle ont sûr faît leû r’djèt, ca vochal lès tchèrètes qui d’hindèt dè viyèdje èt moussèt d’vins lès téres. Li campagne, qu’ aveût stu påhûle dispôy quékes djoûs, si r’peûpèle èco ‘ne fèye. Tos lès brès’ sont-st-èn oûve, èt lès longowès fotches, atakant lès tèssês, lès d’molèt djâbe à djâbe, po tchèrdjî lès hauts tchårs d’ on grin bin sètch èt qui hiletêye là qu’ on l’è tèsse. Totes lès vôyes dè viyèdje sont rimplèyes d’ atèlèdjes, qui montèt, qui d’hindèt, onk à l’ vûde, l’ aute à tchèdje. (p.27) Lès rudions, lès èssis, lès corîhes èt lès djins hiletèt, crînèt, clakèt, brèyèt. C’ è-st-on disdut sins parèy. On veût l’ djôye markêye so lès visèdjes, ca l’ timps siève à sohaît. Divins lès cinses, lès pwètes sont tapêyes tot-å lådje èt lès tchårs moussèt d’vins, tot fant rèsdondi l’ coûr dès pèsants pas dès dj’vås. Èt, là qu’ lès hauts cinas s’ implihèt disqu’å teût èt qui l’ plèce måke po l’ rèsse, rade dès pîces si lèvèt so l’ campagne, èt lès môyes s’ èmontèt come dès toûrs so l’ cîr riglatihant dè l’ loumîre dè solo, qui s’ lêt rider, bin påhûlemint, là, drî lès tiérs.
|
|
Joseph Houziaux, Li vikaîrîye d’on gamin d’ Cêle, 1964
(p.106-107) Dès samwin.nes au long, lès payisans rèculotès dispôy li Tossint s’ ont rafyi do r’moussi dins lès cortis. Ossi sont-i binaujes d’ alè r’qwêr o forni paules, hawes èt rèstias. Is roûjèt l’ cisia èt is raboketèt l’ cwardia. C’ è-st-on vrai ravikadje ! Po Djan-Pière, ci n’ èst nin one pitite afère . I va falu sèrè l’ fwadje ! Gn-a-t-i dès paletéyes èt lèyi là l’ vanwâre, Dieu sét combin d’ timps, à r’toûrnè dins s’ grand djârdin ! Èt d’vant tot ça, i faurè r’nèti l’ prè, ciselè lès hayes èt tonde lès bwardures di paukî, stopè lès traus dins lès clotures, rèmantchi lès baurîres totes dishotéyes, riloyi lès grûsalîs avou dès wèsîres, pèltè lès wazons, wîdi l’ poutrîye èt minè l’ ansène dès bèrbis. I n’ faurè nin co rovyi do hukè Kakat, po tayi lès pwârîs d’ èspaliers. Quand l’ djârdin sèrè r’toûrnè, i faurè co mète è tère lès timprus canadas, aprètè l’ tèrin po r’pikè lès cabus èt lès célèris èt surtout, sèmè lès p’ titès s’ minces.
Li sèmadje ! c ‘èst ça qu’ n’ èst nin rin ! Tos l’s-ans, c’ èst l’min.me pantomine èt lès min.mes mèssadjes ! Djan-Pière vout sèmè laudje. Po z-awè pus d’ place po sauclè, dist-i. Quékefîye ossi po z-awè pus rade faît ! Marîye, todi spaurgnante, boudje li cwardia èt rastrind lès rôyes. Zèls qui s’ ètindèt si bin tote l’anéye, il ont tos côps lès min.mes kigne-kagnes, rapôrt au djârdin .
Po lès fleûrs, ça n’ va wêre mia. Djan-Pière ènn’ a d’ cure èt, sins fè lès cwanses di rin, i tape dès côps d’ hawe didins. Marîye, lèye, vout awè sès plates-bindes po sèmè dès solias èt dès rôses d’ Éjipe èt po r’ pikè lès bohéyes qu’ èle rapwaterè do grand djârdin d’ Véve. Èle sondje surtout aus fosses di sès djins, qu’ èle duverè raprôpriyi po lès Florîyès Paukes.
Josèf èt Omèr s’ acostumèt tot djônes au djârdinadje. A l’ intréye do corti, dès deûs costès d’ l’ uch di drî, il ont leû p’ tit djârdin da zèls èt il î fièt v’nu dès pinséyes di totes lès coleûrs : dès blankes, dès bleûwes, dès djanes tapinéyes di nwâr èt dès caflorîyes di totes lès sôtes. Il î crét co saquants bohéyes di sâbes èt dès grandès blankès fleûrs, qui florichèt à môde di boukèts tot faîts po l’ porcèssion do quinze d’ awous’. Tote li campagne, li djârdin va d’nè d’ l’ ovradje à blame à tot l’ monde. I faurè sauclè, racléri, rawè, r’pikè, arosè, pèletè lès pasias.
Mais ossi, qué plaiji po Marîye do trouvè d’zos l’ mwin tot ç’ qu’ i lî faut po l’ cûjène, dispôy lès preumîrès salades èt lès canadas rauyis à tinrijon jusqu’aus porias èt aus-orèyes di lîves, qui n’ bambièt nin po l’ djaléye, sins rovyi lès-ièbes qu’ on vint coude tote l’ anéye po fè l’ sope. À l’ saîson dès grûsales, Josèf èt Omèr vont chaurpyi lès grossès vètes : en lès machant avou l’ rubârbe, Marîye è fait dès copotes à s’ ralètchi. Lès p’titès rodjes toûneront à jèléye èt on mètrè lès nwâres dins dès botèyes avou do pèkèt po fè do cassis’ : rin d’ mèyeû po l’ dijèssion ! Aus meurs do l’ maujon, pa-d’vant èt padrî, Djan-Pière a faît montè dès-èspaliers d’ Durondeau. Is d’nèt dès si fondantès pwâres qui c’ èst quausu pètchi d’ lès mougni. Maîs il èst bin râre qu’ on z-è saye one : lès pwârîs n’ pwartèt wêre. Marîye sotint qu’ c’ èst do l’ faute da Kakat, qui vint tos l’ s-ans tayi lès-aubes… èt lès fruts do min.me côp. Mais Djan-Pière, qui n’ faît nin voltî dol pwin.ne à one djin, ni vout nin candji d’ djârdinî. Èt on z-è va todi come ça…
I faut dîre ossi qu’ il è-st-one miète tièstu èt Marîye a co bin dès rûses avou li. Si on-aube li jin.ne avaur-là, i profite qu’ èlle èst vôye à on-ètèrmint po fè a s’ tièsse. Quand èle rarive, èle lève dès grands brès, maîs il èst trop taurd : li côp èst faît. I gn-a ieû longtimps addé l’ ri on grand démon d’ mérabèlî qui d’neut à make. Mais il è tchèyeut bèl èt bin o ri. On bia djoû, en rintrant d’ one passéye, èle l’ a trouvè soyi à wôteû d’ ome. Au pègnon do stauve, Djan-Pière a plantè on p’tit drole d’ aube qui done dès bèlès djanès pwâres, totes rascouviéyes di sôye. Mais ni v’s-avisoz nin do crochi d’dins, vos-è f’rîz one di chinéye ! C’est lès pwâres di cwing po fè do l’ jèléye. |
|
Roger Viroux (29/10/2001), Scrît tot sondjant à « De ballade van de boer », da Werumeus Buning
Fis d’ payisan
Dji so fis d’ payisan, 1′ aurzîye clape à mès s’mèles … Pa-d’vant mi, l’ mér dès tchamps, pa-d’zeû mi, l’ mér dès stwèles, C’ èst ç’ qui m’ rivint tofêr, quand dji sondje à ç’ qu’ a stî, À l’ paujêreté d’ adon, quand on ‘nn’ aleûve à pîds, Aus gros tch’vaus atraîtîs, aus r’lûjantès tchèreuwes Au mârtia bâtant l’ fau, aus djavèles ricoudeuwes, Aus pautes qui fyin.n one crèsse aus dîjas alignîs – Skèpiadje di binaujeté dins li r’gârd do cinsî -, À l’ musike dès flayas clatchant su l’ aîre dè l’ grègne, Au molin èt au for, au pwin d’ cinse qui l’ man sègne Divant qui s’ grand coutia côpe dès guitches po tortos, Po l’ famile spale à spale èt po lès pôves èto ! Mins ça s’ néye è l’ breuweû dès-anéyes èvoléyes, Dès-histwêres di macrales èt d’ leups dès chîjes trawéyes, Dès mau-d’-acôrds, po dès bonîs, dins d’s-èritances, Dè l’ paumougne dès timps d’ guêre, di doûs èt d’ disbautchances ! Asteûre, tot a candjî, gn-a pupont d’ djaubes o mafe, Èt, quand l’ timps sièt, l’ awous’ èst scrotéye su one rafe ! Lès tch’vaus n’ ont pont d’ awin.ne, is n’ bèvenut pus qu’ do fuel Èt on sût l’ grin qu’ meûrit avou l’ grosse sipritchoule ! Gn-a pupont d’ mougneûs d’ rukes, gn-a pupont d’ pètronîs … On dôse, rascoud télemint, qu’ on laît couru à trî ! Lès chîjes qui l’ man fileûve, qu’ on fèsseûve dès tchènas, C’ èst 1′ bièsse bwèsse à umaudjes, qu’ a ètchèssî tot ça ! Mins ç’ qui n’ a nin candjî : l’ payisan tint à s’ têre ! Quand i l’ travaye, qu’ i sème, i vike on timps d’ èspwêr Come lès cias qu’ ont viké d’vant li, do min.me mèstî, Qu’ ont arbêté sins lauke, pièrdu, racomincî ! … Dji n’ so nin payisan, mi, dji n’ a qui m’ corti, Mins dj’ fouye, dji sème, saukèle, ripike mèes célèris, Mès poûrias, mès scaroles, mès djotes èt mès cabus … Dissus m’ tauve, c’ èst m’ ritchèsse èt dji n’ dimande rin d’ pus !
Vocabulaîre tofêr : chake côp qu’ ça s’ présinte li skèpiadje 1 1′ arivéye au monde ; 2 (vêci) li mètadje au monde on dîja : on moncia d’ dîs djaubes astampéyes sègnî : fé l’ sine dè l’ crwès su one guitche : one sipèsse taye di pwin one breuweû : on lèdjêr brouliârd li paumougne : li fwin sins awè rin à mindjî on mafe : one pârtîye dè l’ grègne po mète lès djaubes su one rafe = d’ one rafe on mougneû d’ rukes : on pôve payisan li pètronî : li p’tit cinsî dôser : mète di l’ engraîs à make lèyî couru à trî : ni nin cultiver on trèsse one banse, on fèsse on tchèna arbêter : travayî deur sins lauke : sins lachî
|
|
in : C. Grenson, BSLW, T7, 1966, /en Hesbaye/
1. Le fumier est mené de la ferme aux champs sur un char garni de planches (houches) au lieu d’échelles : arrivé à la terre, on enlève la planche d’un côté du char : celui-ci parcourt lentement le champ, et un varlèt fait tomber de pas en pas, à l’aide d’une fourche courbe à deux dents (hé), des mottes de fumier. Un autre domestique (c’est d’ordinaire une servante) suit et, au moyen d’une fourche droite à trois dents (trèyin), étend, répartit également le fumier (stârer l’ ansène). Alors on laboure le champ; le laboureur est suivi d’un aide, la plupart du temps un gamin, un enfant, qui pousse le fumier dans la ligne (bouter l’ansène è l’ rôye), de façon que la charrue le recouvre de la terre que le soc (hî) soulève et couche à côté (Hesbaye). On arrache le chanvre.
En Hesbaye, les pommes de terre plantées en rase campagne sont arrachées au moyen d’une charrue (aîrîre) qui ouvre les mottes, celles-ci étant toujours disposées suivant des lignes droites très-régulières. Dans l’intervalle creux des lignes de mottes (dans les jardins, mais non en rase campagne), on plante en Hesbaye des betteraves et aux environs de Liège des choux verts : cela fait donner au même terrain en même temps deux récoltes de produits divers. La culture du lin est peu répandue en Hesbaye : on le fauche. Les marchands de lin (lintîs) achètent aux cultivateurs la récolte sur pied, la fauchent et la battent eux-mêmes. Leur instrument (p.19) de battage est un plateau de bois porté au bout d’un manche de moyenne longueur et strié sur la face qui doit frapper le lin.
2. Le blé est fauché. Les moissonneurs sont généralement des Flamands qui, à l’époque de la moisson, parcourent la Belgique (ils vont même jusque dans les départements du nord de la France) et viennent se louer aux fermiers : ceux-ci traitent avec eux à forfait, à autant le bonnier pour toute la récolte. On les nomme les piqueurs (piketeûs) : de la main gauche ils tiennent un crochet (pic) avec un manche de moyenne longueur, et, de la main droite une faux emmanchée très-court. L’ouvrier saisit (pike) avec le crochet une certaine quantité d’épis, et, au même instant, la faux décrit une courbe, s’abat et tranche l’audain, la poignée d’épis saisie. C’est un très-beau spectacle que Je mouvement rapide, régulier et cadencé du crochet et de la faux de 5 ou 6 bons piqueurs rangés en ligne dans un champ de blé. Les piketeûs laissent le chaume beaucoup moins grand que les faucheurs ordinaires : ils font plus de paille. Le foin est toujours fauché avec la faux ordinaire, dont le long manche a deux poignées. Pour aiguiser la faux, l’ouvrier emploie une sorte de forme lame en bois de hêtre.
On laisse le blé, jusqu’à ce qu’il soit sec, tel qu’il a été fauché, c’est-à-dire en javelles couchées en lignes par terre. Si le temps menace, on en fait des marionnettes ou copales : en d’autres termes, ou lie les javelles à la tête, près de l’épi, et on les dresse par 4 l’une contre l’autre : 4 javelles font une gerbe. Quand on va venir charger le blé pour le mener à la grange (grègne, heûre), l’engranger (rimète li grin, rintrer l’ grin), on met, pour plus de facilité, les gerbes en dizaux, par dix (dihê) rangés en lignes : le char, dont les 4 coins portent une pointe de bois ou de fer servant à fixer les gerbes des angles, le char (garni d’échelle, hâle, ridèle) passe dans les lignes, et recueille les gerbes, qu’un ouvrier armé d’une fourche pas;e à un autre (l’entasseur) qui est sur le char et les dispose par lits (léts) : c’est (p.20) un talent de bien faire une charrée. On met sur un char environ 200 gerbes, rarement plus. Dans la grange on distingue plusieurs parties : d’abord li dègn, le sol, fait en terre battue et pétrie à pieds nus : puis les mafes, endroit où s’entasse le grain; enfin, le béraudi, grenier planchéié de perches et formant une sorte de soupente au-dessus du dègn. Quand les épis sont droits, le faucheur tourne le dos au vent. Quand ils sont abattus, couchés par le vent, la pluie, l’orage, etc. (versés, flahî), le faucheur prend les épis dans le sens de la couchure, comme ils se présentent.
3. Pour lier la gerbe, le moissonneur est accompagné d’une femme qui a toujours prête une botte de liens (on fa di loyin) ; d’ordinaire, la femme étend à terre le lien, l’homme y pose les javelles ; la femme présente un bout du lien à l’homme qui tient l’autre bout : celui-ci donne à la gerbe un coup de genou, serre, et noue en tordant. A cause de leurs jupons, les femmes ne peuvent bien faire cette opération. — Les liens se font dans la grange, le dimanche avant la moisson. Avant de s’en servir, on les mouille peur qu’ils ne cassent pas. Le dimanche des Rameaux, les ouvriers vont planter dans les champs des branches de Pâques (buis, pâkî) ; puis ils reviennent à la ferme, où le maître leur donne à dîner; l’après-midi, ils mènent le maître au cabaret, et ce sont eux qui lui payent à boire : le plus ordinairement on mange aussi des œufs durs. La même cérémonie se répète surtout à l’époque de la moisson, et la bergerie se nomme alors li trimpèdje des fâs (tremper les faux). On mêle à la semence de la chaux, ou bien, surtout depuis quelques années, du sulfate de cuivre (couperose bleue, vitriol vitriol bleu) pour empêcher la rouille et l’ergot (cf n° 25).
5 Nous ne connaissons pas d’usages superstitieux relatifs au champ de blé; mais nous garantissons authentique le fait suivant ; Un fermier hesbignon se plaignait, devant un mendiant (p.21) annuel il avait accordé l’hospitalité, des chenilles et des limaçons qui dévoraient son jardin. Le mendiant, qui avait probablement le secret d’une drogue quelconque, offrit de débarrasser le jardin et voici comment il s’y prit : dans un coin du clos, à un fort buisson de groseillers, il attacha des bribes de laine rouge en marmottant des paroles qui le firent prendre pour un nécromant : quoiqu’il en soit, le lendemain, le buisson et le sol tout autour étaient criblés de chenilles et de limaçons morts.
7. Les moissonneurs avertissent le maître du jour où ils commenceront la moisson; le maître (li cinsî) va les trouver au champ, et ils lui offrent un bouquet ; le fermier répond au présent en faisant distribuer à boire : cela s’appelle ramouyî l’ boukèt (mouiller le bouquet).
8. Celui du village qui a le premier fait sa récolte porte le mai (pwarter l’ may) : c’est un jeune arbre (ou une forte branche d’arbre) enrubanné et planté au sommet de la dernière charrée : quelques ouvriers le soutiennent, deux ou trois sont couchés autour, sur le char même; les autres ouvriers, les femmes, les enfants, portant leurs outils, suivent joyeusement ; tous boivent et poussent des vivats. On rentre en triomphe à la ferme. On appelle aussi cela fé l’cok (faire le coq). (cf n° 30). Il y a banquet à la ferme, avec dorèyes, gosâs, rondès tâtes, etc. Il existe chez les moissonneurs une vieille coutume qui est le contre-pied de celle qui précède : il s’agit de railler celui qui est le dernier à faire sa moisson. En dépit de la surveillance rigoureuse qu’il exerce, on s’efforce d’attacher à sa dernière charrée (et c’est parfois très difficile) un mannequin formé de deux morceaux de bois mis en croix et affublé d’une blouse ou d’un paletot et d’un chapeau ; le mannequin se nomme Dj’han l’ nâhi (Jean le fatigué). Quand on est parvenu à le planter dans la charretée, on l’accompagne en criant.
9 En Hesbaye, on laisse glaner (mwèhener) les pauvres du village. Il faut souvent toute l’énergie du garde-champêtre et du (p.22) fermier armé d’un fouet pour tenir l’ordre et empêcher les glaneuses qui sont Assises au bord de la terre de se précipiter sur le grain avant que le maître ait donné le signal. L’on ne peut commencer à glaner que quand la dernière gerbe est enlevée, et l’on ne peut glaner que les épis qui sont à terre. Ce glanage n’est qu’une tolérance et non un droit : mais cet usage est tellement enraciné dans les campagnes que des fermiers qui l’avaient banni de leurs terres se sont empressés d’y revenir, pour s’éviter les désagréments et échapper aux malheurs de tout genre qu’ils n’auraient pas manqué d’essuyer de la part des glaneurs, population dangereuse, vindicative, pillarde et aussi peu scrupuleuse que possible sur le tien et le mien.
14. Aux Rogations (deuxième semaine du mois de mai), on fait une procession à travers la campagne, que le curé bénit, suivi de toute la population priant et chantant.
15. Le semeur, en entrant dans le champ, jette toujours une forte poignée en disant : po les mohions (pour les moineaux). C’est la poignée des moineaux. Le paysan est convaincu que le champ dont l’ensemencement est ainsi commencé n’aura pas à souffrir des moineaux, lesquels ne manqueraient pas de piller le grain quand il serait mûr, si le semeur n’avait pensé à eux en leur donnant leur poignée. Saint Eloi est particulièrement révéré en Hesbaye comme le patron et le protecteur des campagnes.
23. En Hesbaye, la même sentence existe, avec cette seule différence qu’elle se dit d’une caye et non d’une corneille.
24 Il est des campagnards qui jettent quelques gouttes d’eau bénite sur le morceau d’étamine qu’on emploie à bien fermer la bande du tonneau qui sert de barate, et à l’intérieur duquel une roue à palets bat et agite le lait.
23. En Hesbaye, l’ergot est appelé dint-d’-leûp (dent de loup.) Il s’attaque surtout au seigle. Le froment a une maladie analogue qui se nomme la rouille en français, et en wallon neûr-cou (cul noir). Elle exhale une odeur de sulfide hydrique, et, comme (p.23) l’ergot de seigle, c’est un champignon. La rouille n’atteint guère que la tige du grain ; quand elle attaque l’épi, ce qui est le dernier degré de gravité, on dit poûri grin (grain pourri). Comme remède à ces maladies qui rendent dangereux le pain fait avec le grain qu’elles infectent, on chaule la semence, ou bien on la mêle d’une certaine quantité de sulfate de cuivre ; cela se fait en arrosant le tas de grin di s’mince (grain de semence) avec une eau saturée de sulfate de cuivre qu’on y a fait bouillir à outrance , dans une grande cuve placée au milieu même du grain , afin que le liquide lancé par l’ébullition ne soit pas perdu (cf n° 4).
28. En Hesbaye , la Grande Ourse se nomme li Tchâr-Pôcèt (le char Pousset) et la Voie lactée li Tchâssèye romin.ne la (chaussée romaine), qui est, pour les campagnes de Hesbaye où l’on en rencontre de très-grands tronçons en parfait état, le type du bon et du beau chemin) ; dans certains villages , on l’appelle li vôye-sint-Djâke (la voie saint Jacques). Quand la sécheresse est trop forte et trop longue, on chante un Te Deum et une messe spéciale.
En été, on voit souvent se former des nuages d’une forme particulière : c’est une sorte d’immense gerbe ou faisceau, d’où rayonnent en éventail des nuées longues et aux bords vagues; le paysan hesbignon a donné à ce météore le nom d’ åbe-Abraham (arbre Abraham) : quand le pied se trouve au S.-O., c’est-à-dire quand l’arbre émerge de l’horizon au S.-O., c’est signe de pluie, et le paysan dit : l’ åbe-Abraham a lès pîds è l’ êwe, i ploûrè (l’arbre Abraham a les pieds dans l’eau, il pleuvra !)
29. Pour avoir de l’argent, soit aux champs, soit à la grange, les ouvriers essayent la poussière des souliers du visiteur1 avec leur casquette.
30. Cette coutume des moissonneurs a dû exister en Hesbaye (quand? on ne saurait fixer d’époque). En effet, comme nous l’avons dit au n° 8, finir la moisson se dit fé l’ cok, ce qui signifie faire le coq. Cet usage subsiste pourtant encore en ce que, à la fête du village, un des jeux habituels consiste à décapiter un coq.
|
|
Le Folklore musical et poétique de la région salmienne, p.46-61, in : Glain et Salm Haute Ardenne, 5, 1976
(p.54) IV LA VIE SOCIALE
1 Chansons de métier
Il y a d’abord à noter les cris du charretier : pour Vielsalm, mes notes ne contiennent qu’une notation du cri pour faire tourner un attelage à gauche : à hâr ! Selon M. Gaston Remacle, on disait aussi hâr hâr ! en on accompagnait souvent ce cri d’une traction sur la lignète ou bride, qui est une corde attachée à l’animal. Pour tourner à droite, on criait hote hote ! en accompagnant le cri de tractions saccadées sur la lignette. Aller de droite et de gauche se dit alî hâr et hôte. Selon Grégoire Fraikin 49, on encourage les chevaux de labour en leur criant : Allez, les p’tits ! ou : Hay, lès p’tits ! Selon le même encore 50, on dit aux chevaux quand on chasse les mouches qui les tourmentent : Mohes, o, mes dj’vês ! « [Ce sont des] Mouches, o, mes chevaux ! » On aimerait pouvoir compléter la série des cris propres au langage du roulier. Plus intéressant est le cri noté à Vielsalm pour chasser ou éloigner les chèvres : à gade ! à gade ! Celui-ci d’après une note adressée à la Société de Littérature wallonne vers 1910 51. Comme ladite Société a reçu de nombreuses notations de ce cri, donnons-les ici, afin d’en circonscrire l’aire d’emploi et, par induction, celle de l’élevage de cet animal peut-être selon un mode qu’il conviendrait de définir par quelque recherche. On retrouve donc le cri, simple ou double, à Villettes (Bra), arrondissement de Verviers ; à Erezée, arrondissement de Marche ; à Bovigny et Houffalize, arrondissement de Bastogne; à Awenne, Offagne, Ucimont, Thibessart (Mellier), arrondissement de Neufchâteau ; à Rossignol et à Bulles (ici : à gade ou à la gade .’), à Tintigny (à la gaye) et à Saint-Léger (à la gâye), arrondissement de Virton. A Grand-Halleux, j’ai noté en 1949 que pour exciter un chien à mordre, on lui crie : apice ! (= saisis !). Mais il est probable qu’il y a d’autres cris ou commandements au chien. La formulette suivante, notée par Eugène Polain, folkloriste liégeois, vers 1890,
49 Grégoire FRAIKIN, Rimes d’ on savâdje, Liège, Lambotte-Stémar, s.d. [entre 1930 et 19401, pp. 4-5. 50 Ibidem, p. 122. 51 Il trouva son écho dans le Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne, t. 6, 1911, p. 30, dans laquelle on supprime la répétition du cri.
(p.55) déjà publiée par moi 52 : Rallalay, wice sont nos vatches ? Rallalay, è pré sâvadje. Rallalay, qui est-ce qui lès wêde ? Rallalay c’est nosse sièrvante. Rallalay, qui fêt-èle là ? Rallalay, èle keûse on drap. Rallalay, po qwè ‘nn’ èst-ce fé ? Rallalay, po sofler s’ nez. Traduction : Rallalay, où sont nos vaches ? — Au pré sauvage. — Qui les garde ? — C’est notre servante. — Que fait-elle là ? — Elle coud un drap. — Pour quoi en faire ? — Pour souffler son nez (= se moucher). Cette notation de Grand-Halleux est confirmée par celle que je fis en 1949 de la même formulette, à quelques détails près, à Rochelinval (Wanne). L’étude de cette enfantine — c’est sa fonction à Rochelinval, alors que Polain en faisait un dialogue de pâtres — couvre les pp. 45 à 47 de l’étude citée ; elle sera bientôt complétée dans la même revue par l’autres notations. Le travail de couture suggéré pour la servante était très réel. En Gaume — et ceci recoupe ce que nous apprend le cri étudié plus haut — il est question de veiller sur un troupeau de chèvres dans la notation de Châtillon. Finissons sur une chanson de barattage, qui reprend un vieux lazzi à propos de mariage, lequel est très répandu en Wallonie. Ce document a été noté par M. Gaston Remacle à Vielsalm et vaut pour le début du siècle ; j’ai tenté une transposition sur portées musicales de la notation sommaire de la mélodie fournie par le notateur : (…). Traduction : Marie-toi, ne te marie pas — II faut toujours (= tout de même) que tu tournes à rien — Et puis voilà le beurre, marionnette ! — Et puis voilà le beurre, marions-nous ! Le pays de Malmedy connaît une autre formulette du barattage 53.
52 Cfr ma Contribution à l’étude du folklore poético-musical des pâtres en Wallonie, dans Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, t. 10, 1963, n°* 109-112, p. 48. 53 Voir ma Nouvelle Lyre Malmédienne, dans Folklore Stavelot-Malmedy, t. 13, 1949, p. 60 et dans Le Pays de saint Remacle, t. 2, 1963, pp. 154-157.
(p.56) Je ne sais quel crédit il faut accorder au chant suivant des faucheurs de foin, car un poète a toujours le droit d’inventer ce qui convient le mieux à son évocation : mais selon Grégoire Fraikin, on chantait autrefois s4 : Dèr hine, dèr hane, Dè four di fagne, Dè blanc mossè t Po lès p’tits-ognès. Traduction : …… — Du foin de fagne (marécage), — De la blanche mousse — Pour les petits agneaux. On ne peut non plus assurer que le cri des chasseurs : Tayaut ! tayaut ! est vraiment autochtone : il peut être emprunté à la langue des littérateurs S5. J’ajoute d’habitude aux cris et chants de métiers certains cris de la vie sociale, comme le suivant : à feu ! à l’êwe ! ” « Au feu ! à l’eau ! », qui se profère en cas d’incendie.
|
|
Abbé Gustave Lambiotte, Roger Delchambre, Aisemont à travers les âges, 1972
Le tissage
Au lieu-dit Inzès-Bas-Monts, existe toujours une maison isolée en ruines, présentement propriété de M. et Mme Emile Denis-Duculot. Autrefois, les propriétaires qui étaient à l’époque les membres de la famille Villers y exerçaient, outre la culture et un peu d’élevage, un artisanat familial assez spécial : le tissage. Sur un métier primitif, les dames et demoiselles de la maison tissaient de la toile dite « de tchène » (de chanvre). Cette toile était d’excellente qualité, car, outre (p.127) son utilisation pour les besoins locaux, elle était aussi vendue dans les villages limitrophes. Cet artisanat et ce commerce paraissent avoir donné sa dénomination au proche lieu-dit du Bazin-Wéz.
Le chanvre était cultivé dans la localité ; en effet, dans les jardins des Pairois (sous la maison de l’auteur), une parcelle de terrain propriété de M. Alphonse Michaux, porte le nom de « Têre à l’ Tchène » (terre au chanvre).
|
|
Joseph Durbuy
Lès Hèsbignones Lès-ovrîres di cinse hèsbignones, C’ èst lès fleûrs dès tchamps, soûrs dès grins. Leûs coleûrs, li solo l’zî done Tot come âs rôses di nos djârdins. Èles n’ ont ciète nin l’ vèye d’ ine barone, Fât qu’ èles grètèsse è tére sovint, Mins ‘le sont hêtèyes, èles sont lurones, ) Bis’ turtos In.mèt d’ rîre èt riyèt frankemint. ) èssonle
Bèrtine L’ â-matin, po lès hièrdâs-vôyes, Èlle ènnè vont qu’ tot 1′ monde dwème co Vès lès pétrâtes, vès lès-arôyes, Avou ‘ne lèdjîre cote, dès sabots ! À l’ campagne, mây nole ni s’ anôye, Leû vwès sone come on djeû d’ clabots Èt l’ romance qui l’ vint pwète èvôye, ) Bis’ turtos Monte lèdjîre èt peûre vès l’ solo ! ) èssonle
|
|
Laurent Dabe (Vèskèvèye / Vesqueville), L’Ardenne entre bruyère et myrtille, 2003
(p.27) Traditionnellement, les Vesquevillois font leur “paurt deu gnèsses“(part de genêts) en juillet après “l’ fènau” (la fenaison). Par la même occasion, ils coupent herbes, fougères, chiendent, bruyères et laissent faner l’ensemble. Une fois sec, ils ramènent le tout ligoté en fagots et en érige une “môye” (meule) devant leur maison. “Avu lès gnésses, on stièrnichét lès bièsses èt avu lès gros brostons, on f’jét do fû o caboleû. Ça sièrvét ossu à fé des ramons”. Lorsque le genêt ne suffit pas, la commune demande à pouvoir arracher des myrtillers. De plus, les bois doivent encore, à la charnière des deux siècles, subir quelques parcours de troupeaux. Sous la garde des enfants, ils paissent notamment dans les bois du côté du “Vèvî Colasse”. Cette pratique agonise cependant et la commune propose d’ailleurs en 1901 de céder son droit de pâturage dans le bois domanial de Vesqueville au gouvernement pour la somme de 900 francs”. A l’automne, la vaine pâture permet encore aux vaches d’envahir les terres cultivées sauf, bien sûr, les semis. “Après lu preumî d’ nôvembe, on tape” dit-on. Les dernières vagues de cet usage ne viennent mourir que sur les rivages des années 1950 et les édiles communaux ne se décident à le supprimer de commun accord qu’en 1954. Grappillage aussi que de couper “l’ ourlét” (‘ourlet, le bord),
NB (p.54) On plantait le ‘bangâr’ : avertissement sous forme de genêts coupés lorsque l’on enfreint une limite.
(p.136) Les cueilleurs de myrtilles (lès frambaujeûs)
Tout Ardennais connaît la myrtille, cette baie globuleuse d’un bleu noirâtre à la saveur nuancée, sucrée et légèrement acidulée dont le seul tort, aux yeux de certains coquets, est de teinter tenacement doigts et bouches. Pourvu que la forêt soit haute et claire -qu’elle se compose de conifères ou de feuillus – les “myrtillers” forment dès lors un tapis végétal parfois très dense d’une hauteur moyenne de 20 à 60 centimètres. Jusqu’au siècle dernier, ce délectable fruit sauvage ne sert guère qu’à quelques galopins, hilares devant les tachetures qu’il occasionne au souffre-douleur de leur choix. Renards et mustélidés ne le dédaignent pas, les coqs de bruyères s’en gavent et les insectes des sous-bois, telles les guêpes en fin de saison, en prélèvent une maigre quote-part. Par contre, cerfs et biches, mangent la plante entière. Le berger la consomme sur place, le bûcheron en rapporte parfois un plein pot pour sa famille et l’indigent récolte,
NB La “machine” ou “peigne”
II s’agit d’une boîte ouverte, à poignée, nantie à son extrémité de dents de fer rondes. Sa fabrication demeure artisanale et les rayons d’une roue de vélo conviennent parfaitement pour en constituer les dents, recourbées vers le haut à 2 cm de leur extrémité. Une poignée cylindrique en occupe le centre. Il en existe également pour enfants, de dimensions forcément moindres : 20 x 13 x 6. La petitesse de l’engin en exclut la poignée qui empêcherait de passer la main pour le nettoyage. L’on tient donc la machine pas son bord avec le désagrément de rapidement ressentir une douleur à la main, principalement entre le pouce et l’index ! Certains modèles de “peigne” remplacent le fond de bois par les mêmes tiges de fer ronds, prolongement des dents. Les promoteurs de ce modèle pensaient faciliter le nettoyage ; les saletés tombant par les interstices. Cela se révèle en partie justifié, cependant aux dépens de la fraîcheur. En effet, lors du nettoyage, les myrtilles se coincent entre les tiges et s’écrasent facilement, mouillant ainsi les autres. Le résultat, surtout en fin de saison lorsque les fruits présentent un mûrissement avancé, s’apparente plutôt à de la marmelade qu’à une cueillette soignée. Ne retenons donc que la première machine dont nous avons parlé comme seul appareil fiable. Pour notre part, l’idéal demeure cette antique machine aux 80 ans bien sonnés qu’utilisait feu notre grand-mère. Humble outil patiné par le temps, bleui par des milliers de kilos de myrtilles et usé par un labeur incessant. Ses dimensions représentent une référence : 27×19,5×8 avec 26 dents de 7 cm.
(p.137) (…) l’essor économique, qui fait de la Belgique de Léopold II l’une des principales puissances économiques du monde, sort la myrtille de l’ombre. Les villes drainent dès lors les produits de la campagne et la modeste baie ardennaise découvre les tables bourgeoises. La cueillette à la main ne pouvant suffire à satisfaire la demande, l’on voit aussitôt apparaître le “peigne” appelé, à Vesqueville, “machine à myrtilles” ou plus simplement “machine”. Cette activité saisonnière prend rapidement de l’essor au sein d’une population trop heureuse de profiter d’un revenu supplémentaire, ô combien utile ! Alors, la commune tente même de louer par adjudication les myrtilles de ses bois. En 1901, la location est adjugée à 2 jeunes Vesquevillois : Léon Peraux et Jules Rézette pour 2,75 francs’31. Cet essai ne dure que peu d’années car les villageois considèrent – depuis toujours – la forêt comme leur propriété, faisant fi des limites. Dès lors, les récoltes affluent chez Deleau ou Rézette, les épiciers, qui les prennent à 3 sous les 2 kilos. Du moins en principe car le système qui prévaut à l’époque correspond plutôt au troc. Le commerçant note, jour après jour, la cueillette de chacun et totalise à la fin de la saison. A ce moment-là, les gens constituent leurs provisions hivernales avec l’argent gagné. Ce sont par centaines et bientôt par milliers de kilos que les délicieuses baies gagnent les tonneaux de bois des marchands. Elles sont destinées à devenir du vin de myrtilles ou, plus souvent, elles traversent la Manche pour être converties par l’industrie britannique en produits pharmaceutiques ou en teintures. Manne providentielle pour les familles laborieuses, elle l’est tout autant pour les commerçants du village dont aucun, jusqu’en 1979, n’obtient le monopole de la myrtille. De quelques centimes au kilo, leur prix ne cesse d’augmenter. Le voici à 1 franc bientôt, ensuite à 1,25 franc durant la dernière guerre. Dans les années 50, “l’industrie myrtillère” représente une activité primordiale des jeunes filles de Vesqueville. A 6 francs le kilo, cela leur permet de se constituer un beau trousseau, du moins pour celles qui ne rendent pas tout à leurs parents, heureux de payer leurs engrais avec ces revenus. Il n’est pas rare de voir le curé se lever à 5 heures du matin pour leur donner la communion avant qu’elles ne se rendent au bois pour une longue journée ! Arrive la crise pétrolière des années 70 avec ses flambées de prix : 50 francs le kilo en 75, 80 francs en 76. Les prix fluctuent d’ailleurs au cours de la saison qui débute ces années-là vers le 14 juillet. Il arrive bien souvent que les cueilleurs éreintés aillent s’enquérir du cours du jour chez Remy Godenir puis chez Rosé Peraux après avoir téléphoné au “Fin bec” à Saint-Hubert ! La récolte va au plus offrant. En 80, les prix fluctuent au cours de la saison entre 80 et 130 francs le kilo avec une moyenne finale de 96 francsIS1. Un grossiste en prend livraison en camionnette tous les 2 jours et monte sur Bruxelles pour les vendre au marché (p.138) ou dans les restaurants. Cela prend fin en 1982 et pourtant l’on peut mieux se rendre compte des tonnes de myrtilles qui sortent de nos sous-bois lorsque l’on sait qu’en un seul jour – au plus fort d’une excellente saison – 500 kilos sont acheminés vers l’épicerie villageoise'”. Las, l’industrie confiturière ne peut plus dépendre des aléas climatiques et préfère se tourner vers des fruits cultivés ou vers des pays où la récolte ne coûte pas grand-chose, comme la Pologne. Les citadins également se laissent attirer par les grosses et superbes myrtilles cultivées malgré leur pauvre goût. En ces années 1980, quelques (p.139) irréductibles se liguent par la suite pour livrer la précieuse marchandise jusqu’à Léglise puis dans une épicerie “borkine…… Mais l’on assiste bien au chant du cygne de cette précieuse activité qui, durant des décennies, apporta de nombreuses bouffées d’oxygène à notre monde rural. Aujourd’hui, seuls quelques friands de confitures et de fruits naturels ou bien encore des approvisionneurs de pâtissiers s’adonnent encore à cette cueillette pour un prix variant aux alentours de 6 ou 7 euros le kilo.
Attardons-nous aux cueilleurs ou plutôt aux cueilleuses car, entre fenaison et moisson, c’est plutôt le chef de famille qui vaque aux occupations quotidiennes de la ferme pendant que sa femme et ses filles se rendent au bois. Vêtues de leurs plus laids atours, elles partent en bande, par famille ou avec les voisines, dès l’aurore. Elles font silence dans le village pour éviter d’être suivies, par peur que des “concurrents” ne découvrent la “catche” (cache), c’est-à-dire l’eldorado bleuté qui fait leur fortune de la journée. Le trajet s’effectue à pied. Pendouillent, à bout de bras, “dès tchènas et dès grandès banses d’ ôsîr” (des paniers et des grandes mannes d’osier). Sur le dos, en bandoulière, le casse-croûte de la journée épouse le balancement régulier des hanches. Si, sur le chemin partiellement humide de rosée ou de pluie, les pas se marquent, certaines vont jusqu’à marcher un temps à reculons pour tromper d’autres groupes ! Après seulement, des voix claires et joyeuses s’élèvent dans la fraîcheur matinale, chantant l’espoir si ce n’est d’une cueillette miraculeuse, du moins celui de soulager leurs familles par l’apport de quelques francs bienvenus. “On se tait au bois” répètent les chefs d’expédition et les plus jeunes devinent l’appréhension des aînés de voir découverte et pillée par d’autres “leû tatche“(leur tache) : image du bleu des nombreuses myrtilles faisant tache dans la verdeur de la forêt. Chaque famille envoie au moins un représentant au bois. Ainsi, voit-on ce spectacle de gens courbés à angle droit, mal vêtus, du grand matin jusqu’à bien tard le soir. Activité de plein air par excellence, la cueillette des myrtilles ne bénéficie pas toujours de conditions climatiques optimales. Lors d’averses prolongées, à l’abri d’une ramure imposante, ces joyeuses compagnies se divertissent comme elles le peuvent et notamment en s’adonnant “à l’ gade”. Lorsque le soir s’annonce, des bois de Vesqueville, de “Sètch ruche”, de la “Voye do d’zeû”, de la “Voye do d’zos”, mais aussi des bois de Tonny ou de Bonnerue, des bandes au pas pesant convergent vers Vesqueville. Plus personne ne chante car la récolte, bien souvent, regagne le village à bout de bras. Parfois, un voiturier part à leur rencontre ou le père gagne le bois avec le cheval pour soulager sa famille de quelques dizaines de kilos. Une anecdote vivace chez les filles Deleau marquée par un chiffre rond retrace bien ces épopées. Joseph Deleau, dans les années 50, rejoint sa femme et ses filles au bois avec son cheval pour charger la récolte qui, pesée, arrive à 99,600 kilos. Le commerçant leur arrondit ce chiffre à 100 kilos ! Imaginons-nous aujourd’hui telle journée et repartir le soir vers Bras ou Saint-Hubert pour une vente de quelques sous de plus !
La cueillette à la main, si elle ne nécessite aucun nettoyage, demande une infinie patience. Elle ne se pratique d’ailleurs que pour des quantités restreintes. La manipulation d’une “machine” requiert par contre une certaine habileté. Il s’agit de glisser les dents du peigne entre les rameaux anguleux, normalement dressés mais souvent ployés sous le poids des baies. Pas de précipitation ! Le mouvement, imprimé de bas en haut, détache alors sans les écraser les fruits bleutés qui roulent dans le réservoir en bois. Il s’agit du premier geste à assimiler, le second réside dans le nettoyage de la “machinée” qui, idéalement, pèse environ 150 grammes. A l’époque où la cueillette est destinée aux tonneaux en bois, le tri s’avère fort sommaire
I. Notes personnelles de l’auteur : à Léglise en 1984, à 130 francs de moyenne et en 1985, à 123 francs de moyenne. A Saint-Hubert en 86, à 150 francs le kilo et en 1987 à 160.
(p.140) et le gain de temps conséquent. Ne nous étonnons donc pas des dires des anciens du village qui évoquent des cueillettes journalières de 30 à 35 kilos ! Cependant lorsque les souvenirs font monter ces chiffres à 40 kilos et plus, peut-être ne faut-il y voir qu’un exploit unique ou ce que les décennies se sont chargées d’embellir. Mais quand le produit se vend pour la consommation directe ou les pâtisseries, le nettoyage doit être impeccable. L’on penche alors la “machine” vers l’avant. Les myrtilles roulent et au passage, toutes les feuilles et brindilles diverses sont soufflées à l’extérieur. Ensuite, les doigts sont utilisés pour ôter les fruits blancs, rouges ou pourris par une gelée tardive. Reste à éliminer la faune des sous-bois que, sur une saison, la forêt nous permet de passer en revue : les araignées de toutes tailles, les chenilles aux couleurs variées, les mouchettes et mouches, une coccinelle de temps à autre et toute une variété d’insectes bien malaisés à identifier. Le plus caractéristique reste la punaise, suceuse de sève, que l’on repère d’abord par son odeur âcre et repoussante. Alors seulement, la “machinée” est vidée dans le “poçon” (récipient, pot) noué à même le ventre pour éviter qu’il ne pendouille car les myrtilles, délicates, se tasseraient et s’écrabouille-raient12‘. En pratiquant ce nettoyage optimal, une récolte journalière de 8 heures donne une quinzaine de kilos pour un cueilleur moyen lors d’une bonne saison. Un “myrtilleur” émérite, durant une saison exceptionnelle, peut atteindre la vingtaine de kilos. Encore faut-il disposer d’une santé et d’un dos solide pour transformer ce chiffre en moyenne !
1. NB Un “poçon” est un récipient de récupération : botte de conserve métallique, boîte de cacao ou autre, petit panier, etc., de 800 à 1500 grammes de moyenne.
(p.141) (NB Devant les affirmations chiffrées dont les aînés nous ont abreuvé, nous avons profité de l’exceptionnelle année 1987 pour tenter l’expérience de cueillir toute une grande journée comme eux. Le mercredi 19 août, de 7 à 19 h., nous avons ainsi récolté – seul – 24,200 kilos de myrtilles nettoyées impeccablement. Dès lors, sans l’obligation de les trier plus que cela, nous voulons bien croire à des cueillettes de 30 à 40 kilos. Quant à tenir cette moyenne !)
L’acheteur repère aisément les fruits issus d’une cueillette soignée à la buée recouvrant la peau. Il convient de se montrer méfiant face à des marchands peu scrupuleux qui prennent les myrtilles à des cueilleurs qui le sont encore moins en appliquant certaines techniques catastrophiques pour la qualité de la baie ! Une cueillette soignée ne s’obtient que sur place, dans la forêt, lorsque le fruit se trouve dans la “machine”. Ce procédé permet le moins de manipulations : condition sine qua non de la préservation d’un produit délicat. Malheureusement, certains cueilleurs, attirés par l’appât d’un gain de temps bien illusoire, appliquent des méthodes peu orthodoxes. Dans tous les cas, ils ramènent les fruits non nettoyés à domicile. Là, ils enlèvent les déchets, poignées après poignées. Le résultat ne se fait guère attendre : des myrtilles s’écrasent et mouillent les autres. D’autres encore croient avantageux de vider les “frambaujes” dans un grand récipient d’eau de manière à éliminer aisément feuilles et brindilles qui flottent en surface. Que reste-t-il de la fraîcheur du fruit engorgé et bientôt flasque ? Certes, l’eau dont il s’imbibe lui permet de gagner en poids mais la texture inconsistante de la chair détruit la myrtille elle-même. Nos grands-parents, pour qui un sou était un sou, voyaient d’un bon œil un jour pluvieux car les “frambaujes” étaient plus pesantes ! Ils omettaient volontairement d’ôter quelques baies blanches pour gagner quelques grammes. Gagne-petit, ils ne gâchaient pourtant en rien la qualité du fruit. La myrtille, avec la framboise et la mûre, forment un trio de ce que la forêt ardennaise offre de plus savoureux comme fruits sauvages. Nos ménagères savent toujours en tirer le maximum : tartes délectables nappées de 800 grammes à 1 kilo de myrtilles, chapeautées par de la crème fraîche, confitures appétissantes ou en dessert, simplement écrasées avec du sucre. Les maris optent pour la confection de sirops rafraîchissants, de vin qui se montre parfois assez pétillant que pour faire sauter les bouchons par temps orageux, sans parler de l’alcool. Autant de façons d’exploiter la richesse de la myrtille en sucres, en acides organiques et en tanins, en vitamines A et C et en pigments organiques. Nos aïeux séchaient la myrtille pour la mâcher en remède à la diarrhée. Son jus comme sa compote combattent efficacement les inflammations de la bouche et du larynx. De plus, elle possède des vertus hypoglycémiantes, toniques et antiseptiques. Enfin, récemment, l’on a constaté que l’épiderme de notre “frambauje” contient une substance propre à renforcer la puissance visuelle, notamment la nuit ! Les excellentes raisons ne manquent donc pas pour extirper du grenier, vieux vêtements, (p.142) “machines” à myrtilles, “poçons” et paniers en osier. Ceux-ci seront préférés aux seaux en plastique puisqu’ils permettent aux fruits de “respirer” ! Si fait, profitons d’une journée en pleine forêt et faisons fi d’un petit mal de dos ou de doigts noircis dont d’ailleurs l’eau de Javel vient facilement à bout.
(p.142) Les Ardennais bon teint vous rappelleront, un sourire en coin, l’homélie du brave curé de Redu. Celui-ci voyait d’un mauvais œil ces rassemblements de jeunes gens dans la forêt. Il ne pouvait les surveiller sur place et il se décide donc de les haranguer le dimanche du haut de sa chaire à prêcher ! “Mes biens chers frères, méfiez-vous car on se salit tout aux myrtilles. Non seulement les mains et la bouche mais encore autre chose !” Les paroissiens, face à cette façon maladroite de présenter les choses, pensèrent à une autre partie de leur anatomie, moins glorieuse ! Des sourires éclairèrent les visages et quelques rires étouffés firent rapidement prendre conscience au curé de son lapsus. /Il se reprit : (…) on se salit l’âme./
|
|
Architecture rurale de Wallonie, Pays de Herve, 1987
(p.176) La culture du chardon
(19e s) Le chardon à foulon*, ou des bonnetiers, Dipsacus fullonum, si utile pour les manufactures de draps et casimirs de Verviers, d’Eupen, Ensival, Dolhain, … était cultivé dans cette région. Séchés en gerbes dans des séchoirs (avec un pignon pervé d’une multitude de baies de ventilation) (il existe encore à Soiron-Pépinster, ferme du château)
* =’cardere’, utilisé dans l’industrie textile au cours de l’opération de lainage destinée à faire réapparaître un duvet moelleux sur le drap; on le frottait au moyen de brosses garnies de chardons; exploitation abandonnées à la fin du 19e s avec l’apparition des cardes métalliques.
(p.182) prairies encloses dès le 15e s: fauchage: des faucheurs ardennais et de la vallée de la Meuse. (au 19e s., en gén., chaque ferme de 10 ha a 2000 m de clôture à entretenir grâce à la mitoyenneté (sinon 4000 m!).
|
